(Fr) Shen Teng est un acteur, réalisateur et scénariste chinois. Après avoir rejoint la compagnie Mahua FunAge en 2003, il s’impose rapidement comme une figure incontournable de nombreux films et pièces de théâtre, à la fois en tant que comédien, auteur ou metteur en scène. Son talent s’est également fait remarquer à plusieurs reprises lors du Gala de la Fête du Printemps avec son interprétation de saynètes abordant, sous forme comique, des problématiques sociales brûlantes. Son humour engagé et son style unique lui valent une grande popularité auprès du public. En 2015, il incarne le rôle principal dans Goodbye Mr. Loser, un film qui connaît un grand succès au box-office chinois. Il enchaîne ensuite les réussites avec des films tels que Pegasus 1 et 2, Full River Red, Moon Man, Successor, et bien d’autres. À ce jour, le box-office cumulé des films dans lesquels il tient le premier rôle dépasse les 36,9 milliards de yuans, faisant de lui l’acteur ayant le plus grand succès commercial de l’histoire du cinéma chinois.
Pourquoi avez-vous accepté d’être le parrain du festival Croisements 2025 ? Quelle relation entretenez-vous avec la culture française ?
C’est un grand honneur d’être le parrain du festival Croisements 2025. La Chine et la France ont toutes deux un riche patrimoine culturel. Le cinéma, l’art et la culture sont des passerelles qui dépassent les frontières et les langues, permettant aux publics de se rencontrer et de partager des émotions communes. Le festival Croisements en est la parfaite incarnation.
On oublie souvent que la France est aussi l’un des berceaux de la comédie. Du théâtre au cinéma, l’humour français prend des formes variées, mais il touche toujours au cœur. Il invite à rire tout en offrant un regard sur le monde. À travers les échanges culturels entre la Chine et la France, j’aimerais partager cette sensibilité et permettre aux spectateurs des deux pays de découvrir des œuvres à la fois drôles, humaines et profondes.
En tant qu’acteur et réalisateur, quel rôle attribuez-vous au théâtre et au cinéma dans les échanges culturels ?
Le théâtre et le cinéma sont des expressions artistiques qui créent du lien entre les cultures. À travers un regard, une mise en scène ou un simple geste, ils nous font découvrir d’autres sensibilités et révèlent ce que nous avons en commun. Prenons l’exemple de la comédie : peu importe la langue, ou même si l’on s’exprime uniquement par le corps, tant que le public rit, le message passe et l’échange est réussi. C’est ce qui fait la force de cinéastes comme Jacques Tati ou Charlie Chaplin : leurs films, presque sans dialogues, sont compris et aimés partout dans le monde.
Pourriez-vous nous citer une pièce ou un film français que vous affectionnez particulièrement ?
Je recommande vivement Les Amants du Pont-Neuf de Leos Carax. Ce qui m’a le plus touché dans ce film, c’est que le réalisateur a montré, avec son angle unique, l’envie et la quête de l’amour de deux artistes en marge de la société. Plusieurs scènes, que ce soit celle de la déclaration d’affection en peinture, ou celle de la course éclairée par le feu d’artifice, incarnent l’amour dans sa forme la plus frénétique et pure, dégageant un romantisme extrême.
En tant que parrain du festival Croisements, quelles sont vos attentes pour cette édition ?
J’attends avec impatience cette nouvelle édition du festival Croisements, avec encore plus de diversité artistique et de rencontres enrichissantes. J’espère que le public pourra découvrir des œuvres marquantes et ressentir toute la richesse de nos échanges culturels et de la culture française.
J’espère aussi que ce festival inspirera les artistes et favorisera de nouvelles collaborations entre créateurs chinois et français. Les rencontres artistiques sont toujours une source d’innovation, et j’ai hâte de voir naître de nouveaux projets qui feront rayonner nos deux cultures.
(Fr)

Ces dernières années, j’ai souvent entendu mes proches se réjouir de l’amélioration de l’environnement et de la qualité de l’air. Je partage pleinement ce constat : enfant, je me souviens que Pékin était chaque printemps recouvert d’un voile de sable jaune. Aujourd’hui, ces scènes appartiennent presque au passé, et je savoure d’autant plus le plaisir simple de me promener dans les parcs ou le long des rivières, portée par la brise printanière.
Ces changements nous rappellent que la protection de l’environnement repose sur l’implication de chacun. Planter un arbre, réduire l’usage des sacs plastiques, privilégier des transports verts, ou encore donner une seconde vie aux objets : autant de gestes simples mais qui contribuent concrètement à bâtir un environnement plus sain et durable.
Le thème de cette édition du Mois franco-chinois de l’environnement, « Horizons bleus, défis verts », résonne particulièrement aujourd’hui. Nous partageons tous une même « planète bleue » qui fait face à des défis immenses : changement climatique, dégradation des écosystèmes, perte de biodiversité… Individuellement, nous ne sommes pas responsables de tous ces problèmes, mais collectivement, nous détenons une part essentielle de la solution. Protéger l’environnement, préserver la Terre qui nous fait vivre, transmettre aux générations futures un monde sain et plein de vie : telles sont les missions qui nous incombent aujourd’hui.
Assumons avec courage cette responsabilité. Engageons-nous ensemble, chacun à notre échelle, à travers des gestes concrets au quotidien. C’est ainsi seulement que nous pourrons continuer à contempler cet « horizon bleu » et construire un avenir plus vert et plus vivant.
(Fr) Isabelle Huppert est l’une des actrices françaises les plus reconnues à l’international. Elle a travaillé avec les plus grands réalisateurs et a remporté à deux reprises le prestigieux Prix d’interprétation féminine à Cannes, pour ses rôles dans Violette Nozière et La Pianiste. Parallèlement à sa carrière au cinéma, Isabelle Huppert est également une grande comédienne de théâtre. Ce printemps, elle sera en Chine pour une tournée de La Cerisaie, une pièce d’Anton Tchekhov mise en scène par Tiago Rodrigues.
Vous avez eu l’occasion de venir en Chine à plusieurs reprises au cours de votre carrière. Qu’est-ce qui vous frappe le plus dans la manière dont la culture française est reçue et vécue par le public chinois ?
J’ai déjà pu constater à quel point la culture française est bien accueillie en Chine, notamment il y a quelques années lors d’une lecture de L’Amant de Marguerite Duras qui m’a conduite à Pékin, Shanghai et Canton, ma première expérience de scène en Chine. J’avais été frappée et enthousiasmée par la ferveur du public. Ce même sentiment s’est renouvelé lors de ma venue en décembre 2024 avec La Ménagerie de Verre. Bien que cette œuvre soit américaine, montée et interprétée par une compagnie française, là encore, j’ai été touchée par la chaleur de l’accueil qui nous a été réservé.
En tant qu’actrice, comment naviguez-vous entre différentes sensibilités culturelles tout en restant fidèle à votre style ?
Je voyage beaucoup avec mes spectacles. Actuellement, j’ai quatre pièces en tournée à travers le monde, dont La Cerisaie, qui sera présentée en Chine. Plus récemment, j’ai joué La Ménagerie de Verre et Bérénice dans une mise en scène de Roméo Castellucci, dont j’espère qu’elle pourra être produite en Chine après notre tournée européenne. Tout comme Mary Said What She Said, ce monologue sur la vie de Mary Stuart, mis en scène par Robert Wilson, que je me réjouis de reprendre bientôt à New York. C’est une coïncidence que ces quatre spectacles se jouent en même temps ; cela impose une véritable gymnastique de la mémoire. Quels que soient les lieux où ces pièces sont jouées, le public les accueille toujours avec curiosité et enthousiasme : il se montre attentif aux choix des metteurs en scène, même lorsqu’il s’agit de propositions esthétiques audacieuses. Je suis convaincue que La Cerisaie, dans l’approche originale et inattendue de Tiago Rodrigues, sera tout aussi bien reçue en Chine.
Pouvez-vous parler de votre relation avec la Chine et la culture chinoise ? Avez-vous un souvenir marquant ?
Oui, quand je suis venue pour cette exposition de photographie qui m’était consacrée au centre artistique UCCA, dans le quartier 798 de Pékin, ou encore ma présidence du jury du festival de cinéma de Hainan, dont la programmation était passionnante. Ma première venue en Chine remonte à il y’a quelques temps déjà. J’avais répondu à l’invitation de l’ambassadeur de France de l’époque, Claude Martin, pour présenter plusieurs de mes films, notamment Une Affaire de Femmes. Je garde un souvenir marquant du master class autour de ce film à l’université de cinéma de Pékin. J’avais été frappée par la manière dont les étudiants comprenaient immédiatement les enjeux du film. Plus tard, j’ai eu l’occasion de donner une autre master class avec le réalisateur Jia Zhangke, un moment tout aussi passionnant. Même si je n’ai encore jamais tourné en Chine, il y a plusieurs cinéastes chinois avec lesquels j’aimerais beaucoup travailler.
Quels sont vos envies de cinéma ? Y a-t-il un rôle en particulier que vous souhaiteriez jouer ?
Je n’ai jamais eu l’envie de jouer un rôle en particulier, mais plutôt celle de travailler avec des cinéastes. En Chine, de nombreux réalisateurs ont émergé ces dernières années, tels que Bi Gan et Diao Yinan, dont je suis le travail et que j’ai eu la chance de rencontrer, sans oublier les figures majeures du cinéma comme Chen Kaige, Zhang Yimou et Jia Zhangke pour ne citer qu’eux.
Auriez-vous un message à transmettre au public chinois du festival Croisements ?
Toute la compagnie de La Cerisaie, Tiago Rodrigues et moi-même, sommes impatients de venir jouer en Chine. Je suis certaine que le public chinois y retrouvera toute la profondeur de l’humour et du génie de Tchekhov.
(Fr) Je suis Laure Shang, musicienne, et je suis très honorée d’être la marraine de l’édition 2025 du Mois de la francophonie.
En tant que musicienne et passionnée de la langue française depuis de nombreuses années, j’entretiens une relation profonde avec cette langue. Le français n’est pas seulement un moyen d’expression, mais aussi une véritable fenêtre ouverte sur le monde.
À l’université, j’ai choisi le français comme spécialité, me plongeant dans l’apprentissage de cette langue élégante, ce qui m’a également permis de bénéficier d’un séjour d’échange en France. Du statut de débutante à celui de personne capable de communiquer couramment en français, cette expérience m’a révélé tout le charme de l’apprentissage des langues. Ce n’est pas simplement une affaire de vocabulaire et de grammaire, mais une immersion et une intégration dans la culture d’un autre pays.
Dans mon parcours musical et professionnel, la culture francophone m’a constamment inspirée et nourrie. J’ai composé de nombreuses chansons en français dans l’espoir de faire découvrir au plus grand nombre le charme unique de la musique francophone. Tout comme la musique, une langue porte des émotions. Et le français, avec sa mélodie propre et sa richesse sonore, donne une profondeur et une subtilité inégalées à l’expression.
Le thème du Mois de la francophonie 2025, « La francophonie au féminin », invite à réfléchir sur notre rapport à la langue tout en célébrant la force et la créativité des femmes dans le monde francophone. Cela m’évoque à la fois des pratiques linguistiques, comme les subtilités de la conjugaison française, et des figures féminines d’exception qui ont marqué la culture et la pensée à travers la littérature, la musique, le cinéma et bien d’autres formes d’art. De George Sand à Fatou Diome, d’Isabelle Adjani à Christine Lagarde, de Céline Dion à Angèle, les femmes du monde francophone ont joué un rôle essentiel dans la construction de la culture, des idées et des avancées sociales. Leurs parcours sont non seulement une partie intégrante de la culture francophone, mais ils inspirent également des générations de femmes à travers le monde à poursuivre leurs rêves avec courage.
Dans notre monde contemporain, le français reste un outil précieux de communication, de diplomatie et de culture, facilitant les échanges internationaux et ouvrant des portes dans de nombreux domaines, de l’économie à la littérature, en passant par la science et l’art. En tant que marraine du Mois de la francophonie, j’espère que mon expérience personnelle permettra à davantage de personnes de ressentir le charme unique de la langue française. Je souhaite également encourager plus de femmes à s’exprimer avec confiance et audace. Puissent les femmes du monde francophone continuer à écrire de magnifiques chapitres à l’intersection de la langue et de la culture !
(Fr)
Zhao Lusi est une actrice chinoise. Elle a commencé sa carrière cinématographique et télévisée en 2017. Depuis, Zhao Lusi a joué dans plus de 20 films et séries télévisées très populaires, tels que The Romance of Tiger and Rose, Love Like the Galaxy, Hidden Love, dont certains ont aussi été diffusés à l’étranger. Son style d’interprétation naturel est très apprécié du public.
Le 18 mai 2024, Zhao Lusi, en tant que représentante des jeunes acteurs chinois, a participé au relais de la flamme des Jeux Olympiques de Paris 2024 dans le département du Gers en France.
Zhao Lusi met depuis plusieurs années sa notoriété au service de plusieurs causes d’intérêt public en particulier dans le domaine de la protection de l’environnement, de la lutte contre la pauvreté – notamment en milieu rural, de la lutte contre les maladies rares et du sauvetage des animaux errants. Depuis 2022, elle est la marraine du programme Chunteng, initié par China Social Assistance Foundation en faveur de l’éducation en milieu rural.
(Fr) Michelle Yeoh, actrice et productrice oscarisée reconnue de l’Asie à Hollywood, et Jean Todt, figure mondiale du sport automobile, forment un couple engagé en soutien de multiples causes humanitaires, notamment auprès des Nations Unies depuis une dizaine d’années.
Célèbre pour avoir joué dans plus de 60 films dont Tigre et Dragon, The Lady, James Bond – Demain ne meurt jamais, ou encore récemment Everything Everywhere All At Once, Michelle Yeoh est désormais ambassadrice pour le programme onusien de sensibilisation aux objectifs de développement durable. Fort de sa carrière débutée en rallye puis consacrée à diriger l’écurie de Formule 1 Ferrari ainsi que la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), Jean Todt assure pour sa part la mission d’envoyé spécial des Nations Unies pour la sécurité routière tout en siégeant au comité directeur de l’Institut international de la Paix.
En parallèle, le couple est également engagé dans plusieurs associations caritatives intervenant dans la recherche médicale. Tous deux sont particulièrement investis au sein de l’Institut du Cerveau et de la Moëlle épinière (ICM).
(Fr)
Je suis Sun Yiwen, escrimeuse. Je suis très honorée d’être la marraine du Mois de la francophonie, à la veille des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.
Mon lien avec la langue française s’est tissé grâce à l’escrime, sport que je pratique avec passion. Originaire d’Europe et s’étant développée en France, l’escrime est une discipline arbitrée en français dans toutes les compétitions internationales. Je pense pouvoir dire que le français retentit là où l’art de l’escrime rayonne.
En tant qu’escrimeuse professionnelle, je suis imprégnée par cette langue. En effet, les escrimeuses et escrimeurs apprennent tous un peu de français, non seulement pour son usage à l’entraînement et en compétition, mais aussi pour à la fois mieux connaître ce sport et découvrir la culture de cette langue. Plus qu’une langue, le français représente le lien solide qui me relie à l’escrime, à mes rêves et au monde.
Cette année le Mois de la francophonie a pour thème « La francophonie en forme Olympique ! », en écho aux JOP de Paris. Cet été, je me rendrai sur les bords de la Seine pour mon troisième voyage olympique. Je me réjouis déjà de voir, sous la flamme olympique, davantage de personnes découvrir le charme du français, langue officielle des JOP, ainsi que le courage et la sagesse, valeurs transmises par l’escrime et le sport.


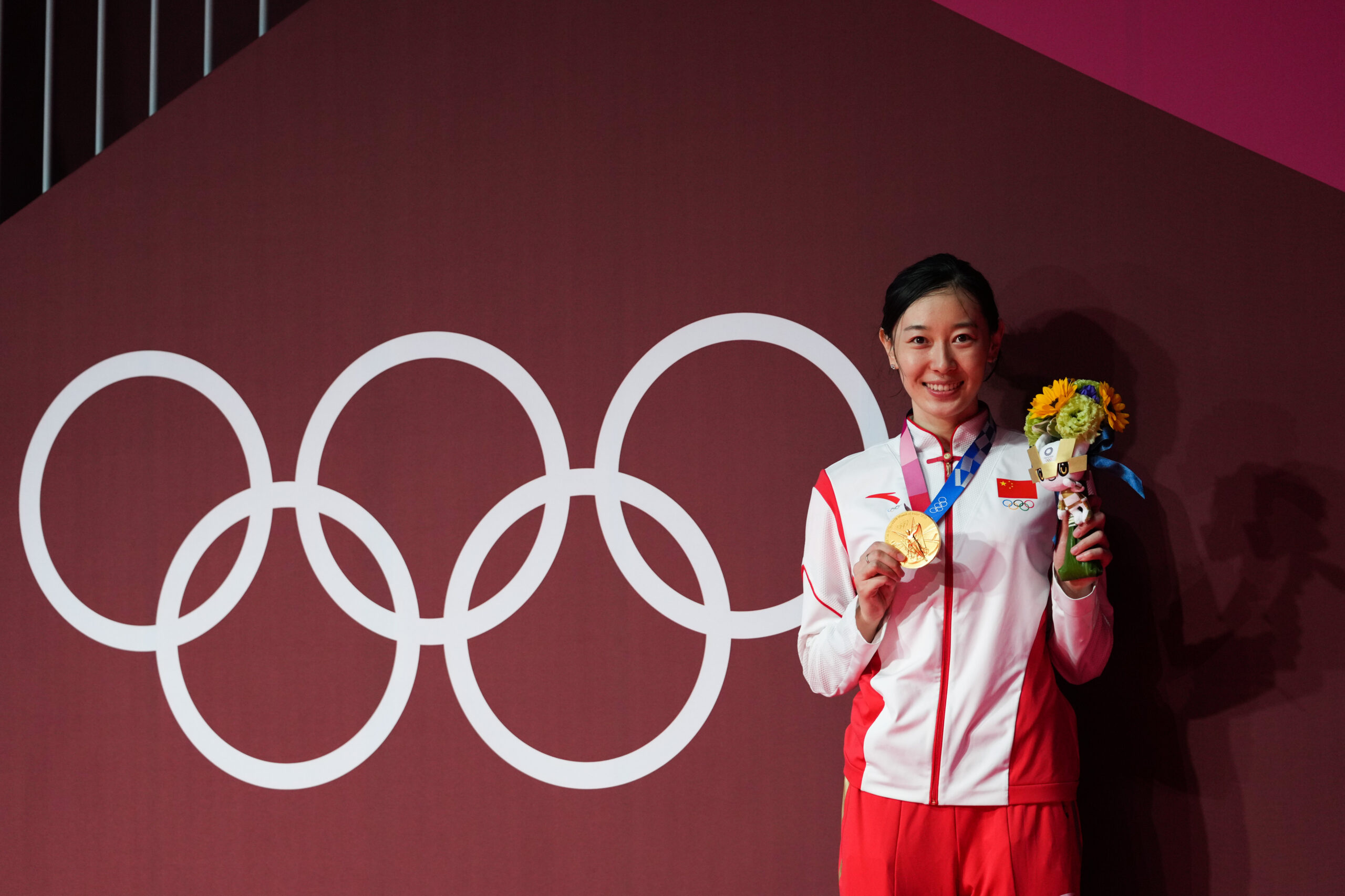
(Fr) Actrice chinoise, Tan Zhuo a commencé sa carrière en interprétant le rôle principal dans le film Nuits d’ivresse printanière du réalisateur Lou Ye en 2009, une prestation qui lui a valu une nomination de meilleure actrice à la 62e édition du festival de Cannes. Elle a joué depuis dans plus de 40 films et séries télévisées chinoises, sélectionnées dans de nombreux festivals internationaux. Tan Zhuo jouit d’une très bonne réputation auprès du grand public grâce à ses talents de comédienne et sa capacité à interpréter des rôles variés.
Tan Zhuo s’engage également dans la création artistique. En tant qu’artiste, elle explore à travers ses œuvres le lien entre l’être humain, l’environnement et l’univers. Ses trois œuvres d’art contemporaines Infinitely Possible BAGUETTE, Afternoon tea, Revelation ont été exposées dès 2020 à Shanghai Exhibition Center, à TANK Shanghai et à l’occasion de Beijing Biennale.
Tan Zhuo s’investit depuis de nombreuses années dans la protection de l’environnement. Outre sa participation à des activités organisées par des institutions telles que la WWF (World Wildlife Fund), elle s’applique à promouvoir la conscience environnementale et le bien-être social dans la vie quotidienne. Elle s’intéresse en particulier à l’éducation de la prochaine génération, en commençant par son propre enfant avec qui elle ramasse des déchets lors de ses randonnées en montagne ou qu’elle encourage à placer des bacs de recyclage dans son quartier afin de permettre à tous d’adopter comportements respectueux de l’environnement.
(Fr) Dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance du célèbre couturier Pierre Cardin, le “ Concours des jeunes créateurs Pierre Cardin ” en Chine sera ouvert aux étudiants des grandes écoles de mode chinoises.
Le concours offre au lauréat un stage au siège parisien et la possibilité de rejoindre une équipe de création, dans le but de sélectionner des designers pour une collaboration à long terme.
(Fr) Professeur à l’école des sciences urbaines et environnementales de l’université de Pékin, Dr. Piao Shilong est élu en 2021 membre de l’Académie des sciences de Chine, au département de sciences de la terre. Il a fait un séjour postdoctoral entre 2004 et 2007 au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE, UMR 8212, CEA-CNRS-UVSQ), avant de rejoindre l’université de Pékin où il avait effectué ses études universitaires jusqu’à l’obtention d’un doctorat.
Sa recherche concerne essentiellement le changement de la planète et les interactions des écosystèmes terrestres. Membre de Comité de rédaction des revues scientifiques telles que Global Change Biology et Agricultural and Forest Meteorology, il a été également membre du comité de pilotage scientifique du Global Carbon Project, et auteur principal des 5e et 6e rapports d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU.
Message à la fête de la science française :
《Je souhaite que la Fête de la science française suscite davantage d’attention en Chine, et incite les jeunes français et chinois à s’impliquer dans la science et se mobiliser ensemble pour relever les défis du changement climatique.》
(Fr)
« Le réchauffement climatique fragilise l’océan et rompt l’équilibre de la diversité marine. Alors que la biodiversité est menacée par la pollution plastique, les rejets d’eaux usées et autres pollutions environnementales, qui déstabilisent encore davantage l’équilibre des écosystèmes et affectent nos vies.
Je suis très honoré d’être le parrain de cette édition du Mois franco-chinois de l’environnement. En tant que personnalité publique, j’ai la responsabilité et le devoir de faire connaître et de participer à de telles activités en lien avec la protection de l’environnement. J’espère que par ma voix, davantage de gens pourront accroître leur sensibilisation à la protection de l’environnement.
Dans ma vie personnelle, je commence par des petits gestes. Par exemple, quand je voyage, que je fais de la randonnée ou du camping, j’amène toujours des sacs poubelles avec moi et ramasse les déchets laissés à l’extérieur. Je participe également à des activités d’intérêt général liées à la protection de l’environnement.. Lors de la Journée mondiale des océans cette année, j’ai effectué le doublage en chinois d’une vidéo produite par WildAid appelant à protéger tous ensemble la biodiversité marine.
Cette année, le Mois franco-chinois de l’environnement présentera des documentaires et des films liés à la protection de l’environnement. Je suis convaincu que ces films inspireront beaucoup de gens et je les attends moi-même avec impatience. »
Huang Xuan, né à Lanzhou en 1985 et diplômé de l’académie de danse à Pékin, est un acteur chinois. Il a débuté sa carrière d’acteur en 2007, en jouant le rôle principal du film The Shaft. En 2014, Huang Xuan a remporté le prix du meilleur acteur au 15e Festival du film de Las Palmas et le prix du nouvel acteur au 10e Forum vidéo de la jeunesse chinoise pour son film Blind Massage. De plus, les séries télévisées dans lesquelles il joue le rôle principal – telles que Red Sorghum, Légende de Mi Yue, Les Interprètes, Minning Town, et bien d’autres – ont obtenu un grand succès. En 2021, il a été nominé pour le prix Magnolia du meilleur acteur pour sa série télévisée Minning Town. Dans la même année, Huang Xuan a remporté le Golden Crane Award du meilleur acteur au 34e Festival international du film de Tokyo en jouant l’un des rôles principaux dans le film 1921.
Dès le début de sa carrière, Huang Xuan s’engage très activement pour défendre des causes humanitaires et des œuvres caritatives. Il a été parrain du programme national de Lutte contre le tabagisme et de SEE (Society of Entrepreneurs & Ecology) pour promouvoir la protection de l’environnement et a également parrainé le projet Love Cinema-Barrier-Free Movie Viewing, ayant pour objectif d’aider les personnes malvoyantes à entrer dans les cinémas. Il a participé au projet d’aide sociale Poverty Alleviation- Starlight Action. Depuis 2017, il est parrain de Wild Aid et s’est exprimé à plusieurs reprises pour sensibiliser à la protection de la biodiversité. Pour la journée mondiale de l’océan du 8 juin 2022, il a effectué le doublage en chinois de la vidéo réalisée par WildAid, intitulée Making the promise of Marine Protected Areas Real, diffusée largement en ligne et sur les réseaux chinois.
(Fr) Huang Bo est acteur, réalisateur et vice-président de l’Association du cinéma chinois. Il a interprété au cours des 20 dernières années de nombreux rôles populaires à l’écran, qui lui ont valu la reconnaissance de ses pairs et du public.
Étant l’un des acteurs chinois contemporains les plus emblématiques, Huang Bo a reçu plusieurs récompenses pour son travail en Chine et à l’étranger, comme le prix du meilleur acteur au Festival international du film de Shanghai et aux Golden Horse Awards, ou celui du meilleur acteur dans un second rôle aux Asian Film Awards. Ses principales œuvres comprennent : Crazy Stone, Cow, Lost in Thailand, Dearest, Mojin: The Lost Legend, The Island.
Huang Bo participe depuis très longtemps aux évènements d’échanges cinématographiques franco-chinois. Il était présent en 2010 à la 7e édition du Panorama du cinéma français pour recommander des films français au public chinois et au 3e Festival du film chinois en France en 2013 à Paris, pour promouvoir le cinéma chinois auprès du public français. Huang Bo était également au Festival de Cannes en 2015, où il a présenté le film Mojin: The Lost Legend, . Huang Bo cherche à explorer de nouvelles pistes de création artistique et à développer de nouvelles collaborations avec des artistes français, pour contribuer au renforcement des coopérations culturelles et artistiques entre nos deux pays.
Le 2 mars, la résidence consulaire de France villa Basset a accueilli l’ouverture du 27e Mois de la francophonie à Shanghai, organisé par le service universitaire du consulat et coordonné par l’Institut français de Chine partenariat avec les ambassades et les représentations diplomatiques et consulaires francophones. L’objectif de ce festival est de promouvoir la francophonie auprès d’un public le plus large possible à travers la culture, le sport et la paix.
Cette année, le Mois de la francophonie a pour thème « Participer ». Il s’inscrit ainsi dans l’esprit de la devise olympique, rendu célèbre par Pierre de Coubertin : « L’important c’est de participer ».
Dans son discours, M. Joan Valadou a rappelé ce qu’était francophonie : « La francophonie [..], c’est bien sûr une pratique et un amour en commun de la langue française. Mais c’est bien plus que cela. Ce sont des valeurs partagées de diversité linguistique et culturelle, d’échange et de respect mutuel. Dans le monde actuel, ces valeurs sont plus que jamais essentielles ».
La programmation des événements du Mois de la francophonie, coordonnée par le service universitaire du consulat, a été faite avec les consulats de Belgique, de Suisse, du Luxembourg, de Roumanie, du Canada et le Bureau du Québec à Shanghai.
Pendant le mois de mars, la francophonie sera donc célébrée dans toute la Chine, et dans la circonscription à Shanghai, notamment à travers des projections de films, des rencontres littéraires, des conférences, des ateliers de cuisine, des événements sportifs, etc. A cela, il convient d’ajouter les concours récurrents de déclamation de poésie et de chanson francophones, organisés par l’Alliance française de Shanghai. Comme l’année dernière, Shanghai accueillera la finale du concours de la chanson francophone le 1er avril, événement qui clôturera le Mois de la francophonie.
La francophonie se porte bien à Shanghai et dans le delta du Yangzi, grâce notamment aux 27 facultés ou départements de français des universités de la région, mais aussi aux écoles, collèges et lycées qui, de plus en plus nombreux, ont ouvert des filières de français. Le renforcement de l’enseignement du français dans le secondaire est en effet une priorité de l’ambassade de France.
La pandémie nous a contraints d’annuler toute la programmation du Mois de la francophonie l'année dernière. Avec la fin de la pandémie, nous sommes heureux de pouvoir de nouveau organiser des événements en présentiel et impatients d’aller à la rencontre du public chinois.
Le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes et dans le cadre du Mois de la francophonie, le consulat général de France à Shanghai a organisé une rencontre littéraire sur l'écrivaine Maryse Condé, une grande voix de la littérature française et francophone féministe, à la résidence consulaire.
M. Joan Valadou, consul général de France à Shanghai, a ouvert l’événement en indiquant l’importance de la Journée internationale des droits des femmes. En France, M. Emmanuel Macron, président de la République, a fait de l’égalité femmes-hommes la grande cause de son premier et de son second mandats.
Il souhaite en effet que cette grande cause remplisse pleinement sa fonction, celle de faire de la société française une société plus égalitaire, plus juste. Le consul général a cité l’exemple du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, où les femmes sont désormais davantage représentées et occupent de plus en plus de postes à responsabilités. Le Quai d’Orsay compte aujourd’hui 30 % d’ambassadrices contre 11 % il y a dix ans.
De plus, le gouvernement a adopté une "diplomatie féministe". Depuis 2019, cela se traduit par un volontarisme certain dans la mise à l'agenda des droits des femmes lors de sommets internationaux et le lancement d'initiatives spécifiques. Toutefois, la France doit poursuivre ses efforts pour l’égalité entre les femmes et les hommes, pour les droits des femmes et dans la lutte contre les violences conjugales. L’égalité femmes-hommes est un combat de tous les jours qui doit être mené dans tous les domaines (législatif, éducatif, social, économique, etc.). Le consul général a conclu son allocution en saluant la présence des hommes à l’événement littéraire car dans ce combat au long cours pour l’égalité les hommes sont indispensables.
L’intervenant était M. Maxime Philippe, professeur associé en langue et littérature françaises à l’Université de Shanghai. Titulaire d’une thèse de doctorat sur le théâtre d’Antonin Artaud de l’Université Mc Gill (Canada), il s’intéresse entre autres aux écrivains d’expression française, notamment antillais tels que Edouard Glissant et Maryse Condé.
M. Maxime Philippe a commencé son intervention en retraçant la vie de l’écrivaine guadeloupéenne. Née en 1937 à Point-à-Pitre, Marise Condé a grandi dans une famille bourgeoise noire et a baigné dans la culture française dès son enfance. Enseignante, elle a vécu aux Antilles, en France, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Ghana et aux Etats-Unis avant de s’installer définitivement en France et de se consacrer exclusivement à l’écriture. L’intervenant a ensuite présenté son œuvre, une œuvre riche et multiple qui traverse les genres littéraires et les continents et qui regroupe romans, essais, nouvelles, pièces de théâtre et livres pour enfants. Enfin, la troisième partie de la présentation de M. Maxime Philippe portait sur le féminisme dans son œuvre. Il s’est attardé sur ses ouvrages qui parlent des femmes ou qui leur sont consacrés. C’est ainsi le cas de La Parole des femmes, un ouvrage qui étudie les œuvres de plusieurs romancières des Caraïbes de langue française afin de découvrir le regard qu’elles portent sur elles-mêmes, sur leur pays et leur société et d’appréhender les problèmes qu’elles affrontent. Il a appuyé ses propos par la lecture d’extraits de Parole des femmes et Victoire, les saveurs et les mots. Si Maryse Condé ne se revendique pas elle-même féministe, dans ses livres elle questionne la place des femmes dans nos sociétés.
La rencontre, proposée par le service universitaire, était animée par Mme Séverine Boué, attachée de coopération scolaire et universitaire au consulat général de France à Shanghai. La rencontre s’est poursuivie par des échanges avec le public composé d’enseignants-chercheurs et d’étudiants de langue et de littérature françaises des universités de Shanghai, d’élèves du Lycée français de Shanghai, de membres de l’Alliance française, de représentants des consulats de plusieurs pays francophones, etc.
Maryse Congé a publié une trentaine de romans couronnés par de nombreuses récompenses telles que le grand prix littéraire de la Femme en 1986, celui de l’Académie française en 1988 pour son livre La Vie scélérate, récit autobiographique de son enfance, le prix Marguerite-Yourcenar en 1999 et le Nouveau prix académique de littérature (Nobel dit « alternatif ») en 2018.
La Fémis, École nationale supérieure des métiers de l’Image et du Son, organise, comme chaque année, son université d’été.
L’Université d’été de La Fémis est une réelle opportunité de rencontre et de pratique du cinéma dans un cadre d’expertise reconnu mondialement. Le ou la candidat.e sélectionné.e par la Fémis pourra bénéficier d’une bourse de la part de l’ambassade de France en Chine, couvrant l’hébergement en France, le billet d’avion aller-retour, et les frais de scolarité.
Conditions:
La pratique courante de la langue française écrite, parlée, lue est obligatoire.
Les candidats doivent être âgés de moins de 27 ans au 1er janvier 2023.
Le candidat doit actuellement résider en Chine continentale et avoir la nationalité chinoise.
3 avril 2023
Mi-mai 2023
11 juillet 2023
12 juillet 2023
8 septembre 2023
9 septembre 2023



Une pop à la fois fraiche et puissante

Angèle, jeune chanteuse pop belge, vient de remporter le prix de la meilleure artiste féminine aux Victoires de la musique 2023. Née dans une famille de musiciens, son père est le chanteur francophone Marka, et son frère le rappeur Roméo Elvis. Malgré une image très douce, Angèle est une artiste très engagée sur les questions féministes. Dans Balance ton quoi, le sixième single de son premier album Brol, elle dénonce le sexisme. Le titre fait référence au mouvement #BalanceTonPorc.

Deux fois gagnante du prix de la meilleure artiste féminine de l’année en 2020 et 2022 aux Victoires de la musique, Clara Luciani, est, à 30 ans une femme de son époque : forte, pétillante, mais aussi profonde. Depuis qu’elle a lancé sa Grenade en 2018, l’artiste partie de rien est désormais partout. Pour elle, « chanteuse populaire, c’est le plus beau compliment qu’on puisse me faire ».

Un flow irrésistible


Gims (anciennement Maître Gims) est un rappeur congolais. Après avoir été membre du groupe de hip-hop Sexion d’Assaut, il poursuit une carrière individuelle sous le nom de Maître Gims. En 2013, il sort son premier album, Subliminal, qui se vend à plus d'un million d'exemplaires et culmine à la deuxième place du classement des albums français.

Un son électro inclassable



Pour approfondir votre exploration des sons de la francophonie, nous vous invitons à découvrir tous ces artistes francophones, et bien d’autres encore, grâce à la playlist What The France sur Netease Cloud Music Pardon My Chanson :


Vers la décarbonation du transport aérien en Chine
Le forum sur les carburants d’aviation durables, coorganisé avec Airbus dans le cadre du Mois franco-chinois de l’environnement, se tiendra à Pékin le 1er mars 2023 entre 14h30 et 17h00.
En tant que leader mondial de l’aviation civile, Airbus travaille activement avec ses partenaires mondiaux pour promouvoir la décarbonation de l'aviation civile et développer en particulier des carburants aéronautiques durables, afin de lutter contre le changement climatique et mettre en œuvre les objectifs de l'Accord de Paris.
Des entreprises, institutions et experts chinois et français concernés par ce domaine interviendront aux côtés d’Airbus afin de partager leurs expériences et savoirs faire. Ce forum permettra aux auditeurs de mieux comprendre les enjeux et l’utilité des carburants aéronautiques durables, de mesurer les tendances de l'industrie dans ce domaine et de mieux connaître les coopérations franco-chinoises afférentes.
03.01 14:30-17:00
Evènement en ligne, disponible en chinois. Vous pourrez suivre le live-streaming sur la plateforme Weibo de Faguowenhua.

Programme
14:30-14:35
Discours d'ouverture : Nicolas Pillerel, Ministre Conseiller pour les affaires culturelles, éducatives et scientifiques
Discours d'ouverture : Michel Tran Van, COO d'Airbus Chine
14:40—14:52
Stratégie et pratiques d'Airbus en matière de carburant aviation durable par Cui Lin, représentante nationale pour le développement durable et l'environnement d'Airbus Chine.
14:52—15:04
Construction et perspectives du marché du carbone en Chine par Zhang Xiliang, directeur de l'Institut de l'économie de l'énergie et de l'environnement de l'Université Tsinghua
15:04—15:16
Développement et exploration de Sinopec dans le champ SAF par Wang Lijuan, directrice générale adjointe, département Science et Technologie de Sinopec
15:16—15:28
Technologie de carburants d'aviation renouvelables à partir de la biomasse lignocellulosique par Li Zhenglong, professeur et directeur de thèse à l'Université du Zhejiang
15:28—15:40
Stratégie et pratiques de Cathay Pacific en matière de carburants d'aviation durables (SAF) par Xing Ziheng, directeur du Changement climatique du département des Affaires d’entreprise, Cathay Pacific Airways
16:00—16:25
Table ronde - Aviation civile double carbone
16:25—16:50
Table ronde - Énergie Double Carbone
17:00—17:04
Discours de clôture : Cyril de Mesmay, conseiller Aviation civile, Aéronautique et Spatial à l'ambassade de France en Chine
Discours de clôture : Zhang Xuan, présidente des Affaires publiques et Affaires générales d'Airbus Chine
Intervenants
Cui Lin

Diplômée en ingénierie environnementale de l'Université d'aéronautique et d'astronautique de Pékin, Cui Lin a obtenu un double Master en ingénierie environnementale et en gestion d'entreprise à l'Imperial College of Technology, au Royaume-Uni. Elle est actuellement la représentante nationale pour le développement durable et l'environnement chez Airbus China.
Zhang Xiliang

Zhang Xiliang est docteur en ingénierie des systèmes à l’Université Tsinghua et professeur à l'Institut de l'énergie nucléaire et des nouvelles technologies énergétiques de l’Université Tsinghua. Il est directeur de l'Institut d’économie de l'énergie et de l'environnement de l’Université Tsinghua, scientifique en chef du Centre de gouvernance climatique et de financement du carbone de l’Institut de recherche neutre en carbone de l'Université Tsinghua, membre du Comité national d'experts sur le changement climatique. Il a dirigé des projets majeurs de la Fondation nationale des sciences naturelles de Chine, du Programme national clé de recherche et de développement de la Fondation nationale des sciences sociales de Chine dans le domaine du changement climatique. Il a publié plus de 200 articles dans des revues universitaires nationales et internationales telles que Nature Energy, Nature Climate Change et Management World. Depuis 2015, il est à la tête du groupe d'experts techniques pour la conception globale du marché national du carbone. En 2020, il a reçu du ministère de l'Éducation le prix de la meilleure réalisation exceptionnelle en recherche scientifique (sciences humaines et sociales) des établissements d'enseignement supérieur. La même année, le ministère de l'écologie et de l'environnement lui a décerné le titre de « talent professionnel national en matière de protection de l'environnement écologique » dans le domaine du changement climatique.
Wang Lijuan

Wang Lijuan a obtenu une licence en génie chimique à l'Université Tsinghua en 1993 et une maîtrise en biochimie en 1996 à l'Université Tsinghua. Elle est actuellement directrice générale adjointe du département scientifique et technologique de Sinopec et ingénieur principal du corps professoral. Elle est engagée dans la gestion de la recherche pétrochimique depuis de nombreuses années et possède une riche expérience dans la recherche et le développement, les droits de propriété intellectuelle et la gestion de la coopération internationale.
Xing Ziheng

Xing Ziheng est responsable de l'action climatique chez Cathay Pacific depuis avril 2022 et est chargé des affaires liées au changement climatique, y compris le marché du carbone et le carburant pour l'aviation durable. Avant de rejoindre Cathay Pacific, Xing Ziheng a travaillé pour Southern Airlines, où il a été responsable du commerce du carbone auprès de l'UE et du régime CORSIA. Il a également participé au groupe de travail sur le marché du carbone de la province de Guangdong et au groupe de travail national sur le marché du carbone pour le secteur de l'aviation civile. Il participe également à plusieurs groupes de travail du secteur consacrés aux questions de changement climatique, notamment ceux de l'Association internationale du transport aérien (IATA) et de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
LI Zhenglong

Li Zhenglong est professeur et directeur de thèse à l'Université du Zhejiang et Talent national de niveau international. Ses recherches portent sur la conversion de la biomasse en carburants liquides et en produits chimiques à haute valeur ajoutée, l'utilisation du biogaz, la conversion du dioxyde de carbone et la synthèse verte de l'ammoniac. Il a été chef de l'équipe de conversion par catalyse de la biomasse au Laboratoire national d'Oak Ridge sous l'égide du ministère américain de l'Énergie, membre du Comité directeur de la catalyse de la biomasse du ministère américain de l'Énergie (seuls deux scientifiques chinois ont été sélectionnés, 2017-2021) et chef académique de la conversion des petites molécules de la biomasse en carburant aviation (2016-2021).
(Fr) La richesse et la diversité de la langue française seront célébrées en Chine, tout au long du mois de mars, à l’occasion du 27e Mois de la francophonie, coordonné par l’Institut français de Chine en partenariat avec plusieurs ambassades et représentations diplomatiques. À quelques mois des Jeux Olympiques qui s’ouvriront à Paris en 2024, cette nouvelle édition aura pour thème « participer » et s’inscrit ainsi dans l’esprit de la devise olympique, rendue célèbre par Pierre de Coubertin : « l’important, c’est de participer ! ».
Le festival est parrainé cette année par Li Na qui portera la voix de la francophonie. Cette ancienne championne de tennis a remporté de nombreux tournois, ainsi que 2 titres de Grand Chelem dont celui de Roland Garros en France en 2011. Au cours de sa carrière, Li Na a eu l’occasion de voyager à l’étranger et de participer à de nombreuses compétitions internationales. Elle a ainsi pu se familiariser avec la langue française, qui est notamment l’une des langues officielles de grandes rencontres sportives comme les Jeux Olympiques. Elle espère que le Mois de la francophonie permettra de réunir le public pour célébrer la francophonie dans un cadre festif et sportif.



La conférence de presse s’est déroulée, jeudi 23 février à l’Institut français de Pékin, en présence de représentants du Gabon, de Belgique, du Cambodge, du Canada, de France, du Liban, de Maurice, du Québec, de Suisse, de Tunisie et de Wallonie-Bruxelles International.
Le Gabon préside cette année le Groupe des ambassadeurs francophones en Chine et c’est à cette occasion que le chargé d’affaires a.i. de l’ambassade du Gabon, Guy Arnaud Pambou Mavoungou, a officiellement lancé cet événement. Il a souhaité saisir cette occasion pour rappeler que le Mois de la francophonie s’articule autour des valeurs de partage et des liens d’amitié entre les peuples, pour célébrer la langue française et les cultures francophones à travers le monde.




Cette année, une quinzaine de projets sera organisée à travers la Chine à destination d’un large public. Que vous parliez le français ou non, vous aurez l’occasion de découvrir les multiples expressions de la francophonie. Evénements culturels, activités sportives et concours pluridisciplinaires… il y en aura pour tous les goûts !

Jeux Olympiques de Paris 2024 : J-500 !
À 500 jour avant l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’ambassade de France en Chine participe à l’initiative Relais autour du Monde. Le principe : organiser une activité sportive et passer le relais virtuellement à une ambassade française du fuseau horaire suivant qui organise une activité à son tour. Pour marquer cet événement mondial, l’Institut français de Chine organise avec Décathlon Chine sept rencontres sportives dans sept villes chinoises. Course, randonnée, vélo, natation, planche à roulettes et planche à rame, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.
3.14
Pékin / Shanghai / Chengdu / Canton / Dalian / Shenzhen / Wuhan

Rencontres du cinéma francophone
Véritable lieu de rencontre des artistes de langue française, le cinéma francophone est aujourd’hui le reflet des échanges qui font le cœur de la francophonie ! L’édition 2023 des Rencontres du cinéma francophone met en lumière ces films au croisement de différentes cultures, avec toujours la langue française en partage. De la langue de Balzac au verbe de NTM, des comédies québécoise et canadienne au thriller tunisien, en passant par l’animation roumaine et le documentaire gabonais, sans oublier les histoires au croisement de la Suisse, de la Belgique et de la France, partez à la découverte de celles et ceux qui mettent en scène la langue française d’aujourd’hui – parfois même jusqu’aux confins de la Chine !
3.01-31 – Toute la Chine
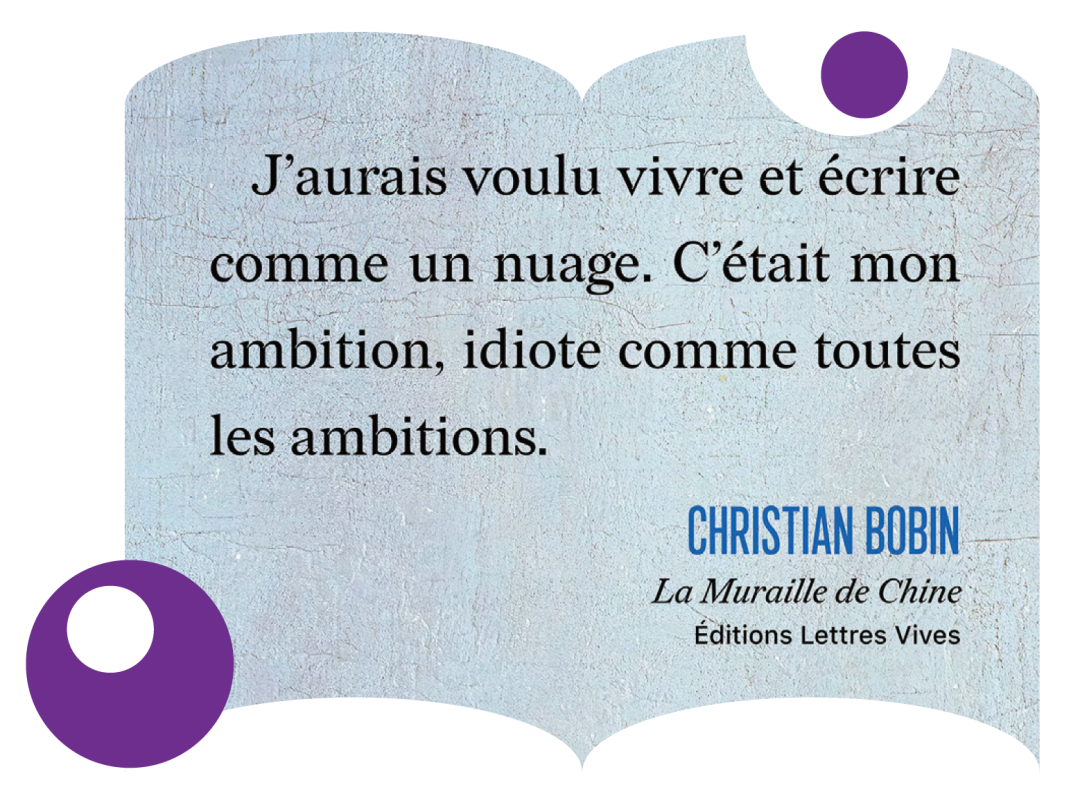
Le Printemps des Poètes
Pour sa 25e édition, le Printemps des Poètes célèbre les liens entre lecteurs et poètes que tissent les mots en adoptant la thématique « Frontières ». Le Printemps des Poètes se déploie à l’échelle de la Chine en une série de lectures à voix hautes et musicales de poètes contemporains venant de Chine, de France et de pays francophones. L’opération Visa Poème s’inscrit également dans cette édition en proposant aux apprenants de français de participer à une œuvre écrite collective. Ce recueil de poèmes prendra la forme d’un passeport et rassemblera des textes écrits pour franchir les frontières, à la manière d’un laissez-passer.
3.15 – Pékin
Institut français de Pékin
3.18 – Chengdu
White Night · Art Space
3.21 – Anshan
Musée d’art STEEL
3.25 – Foshan
Longtang, ancienne société des gens de lettres
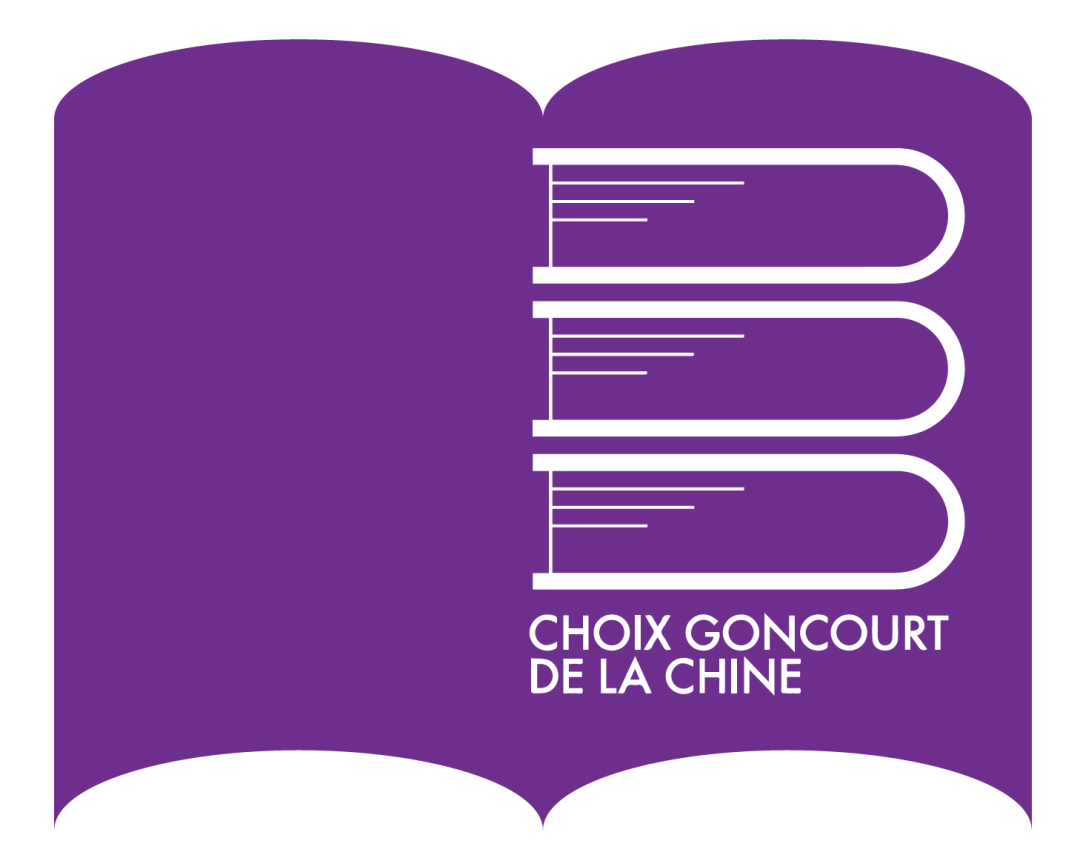
Le Choix Goncourt de la Chine
Le Choix Goncourt de la Chine, organisé en lien avec l’académie Goncourt, récompense chaque année depuis 2018 le meilleur livre de la sélection du Prix Goncourt selon les étudiants chinois. Cette année les étudiants de français en Master et en doctorat de dix universités partenaires ont choisi leur lauréat dont le nom sera révélé au cours d’une cérémonie à Pékin qui sera rediffusée en direct dans les villes des universités participantes. L’annonce du lauréat sera accompagnée d’une programmation célébrant la création littéraire contemporaine.
3.28 – Pékin
Cérémonie
Résidence de France
3.29 – Pékin
Rencontres littéraires
Institut français de Pékin

Gastronomie de la francophonie
Pendant le Mois de la francophonie, un dîner est organisé chaque semaine dans une ambassade francophone. Autour de la table de l’ambassadeur ou ambassadrice se réunissent des personnalités, des influenceurs et des journalistes pour couvrir l’événement. Chaque dîner emblématique propose une cuisine locale pour ravir les papilles de ses convives. Des recettes et vidéos seront partagées afin de faire découvrir les spécialités culinaires des pays de la francophonie.
3.01-31 – Pékin
Ambassades de Belgique, du Cambodge, du Canada et de France

Apéro des sciences
Le français est une langue d’échange entre nations scientifiques. Pour célébrer la langue française et la science, un apéro des sciences coordonné avec d’autres pays francophones réunira des intervenants du Canada, de Belgique, de Suisse, du Luxembourg et de France, pour présenter en français leurs projets et partager leur expertise sur le changement climatique. Chaque présentation d’une durée de cinq minutes sera suivie d’un échange avec le public. Cet événement national hybride sur invitation est un moment convivial placé sous le signe du partage.
3.23 – Pékin
Résidence de France

Déclamation de poèmes
3.26 – Jinan
Inscriptions jusqu’au 26 février.

Le réseau des Alliances Françaises de Chine, en collaboration avec l’Institut français de Chine, l’ambassade de Suisse, les représentations du Québec et de Wallonie-Bruxelles International en Chine sont heureux de vous annoncer l’édition 2023 du concours de la chanson francophone. 500 candidats tenteront leur chance cette année pour gagner un des nombreux lots offerts par nos sponsors et partenaires. Les gagnants des demi-finales, organisées dans les 14 Alliances Françaises, se verront offrir le déplacement à Shanghai et une nuit d’hôtel sur place pour participer à la finale. Le public pourra encourager le candidat de son choix en se connectant à la retransmission de la finale en direct!
4.01 – Shanghai
THE INLET

Rejouez les scènes !
Ce concours, ouvert aux francophones de tous niveaux et de tous âges, consiste à rejouer des scènes de films francophones cultes. Organisé en ligne, les meilleures performances seront partagées sur nos réseaux. Une liste de films est proposée pour inspirer les participants. À l’aide de costumes, d’un décor, d’un dialogue, d’un jeu d’acteur ou tout ça en même temps, les meilleures scènes du cinéma francophone reprennent vie. Recréer une chorale pour jouer Les Choristes, enfiler des patins à roulettes pour danser sur La Boum, interpréter les dialogues comiques d’Intouchables, tout devient possible en se laissant aller à la créativité. Et action !
3.01-31 – En ligne

3.20 – Pékin
CCI France Chine

Quiz francophonie
3.18 – En ligne
Ouverture des inscriptions le 1er mars. Plus d’informations prochainement sur Faguowenhua.
Pour plus d’informations sur les modalités de participation, suivez-nous sur Faguowenhua et les réseaux sociaux des Alliances Françaises de Chine !
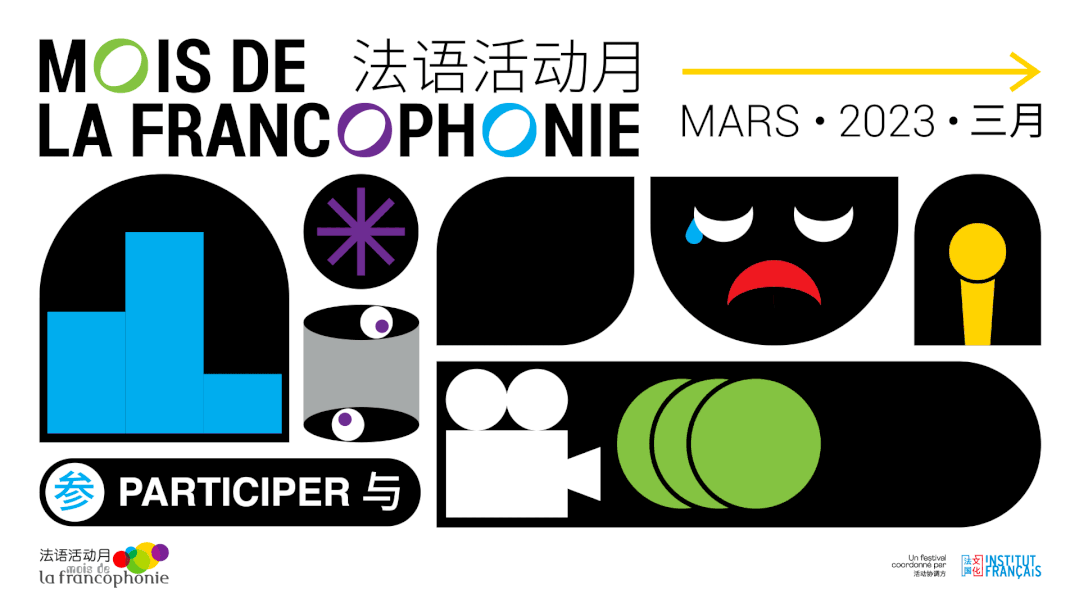
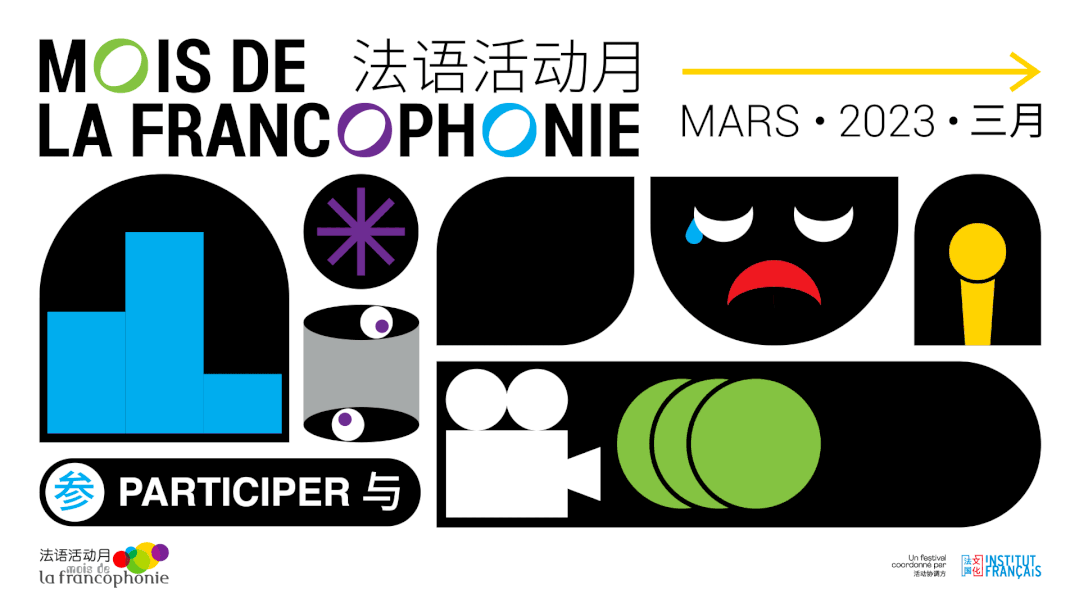

À travers l’Opération Coudrier,
le Printemps des Poètes propose en 2023 Visa Poème,
l’occasion pour tous les apprenants de français de composer leur poème !
Consigne
Composer un poème qui franchisse les frontières et tienne sur la page d’un passeport, qu’il soit en français et suffisamment singulier pour servir de laissez-passer face à tous les douaniers du monde.
Cette année le Printemps des Poètes a pour thème « Frontières ».
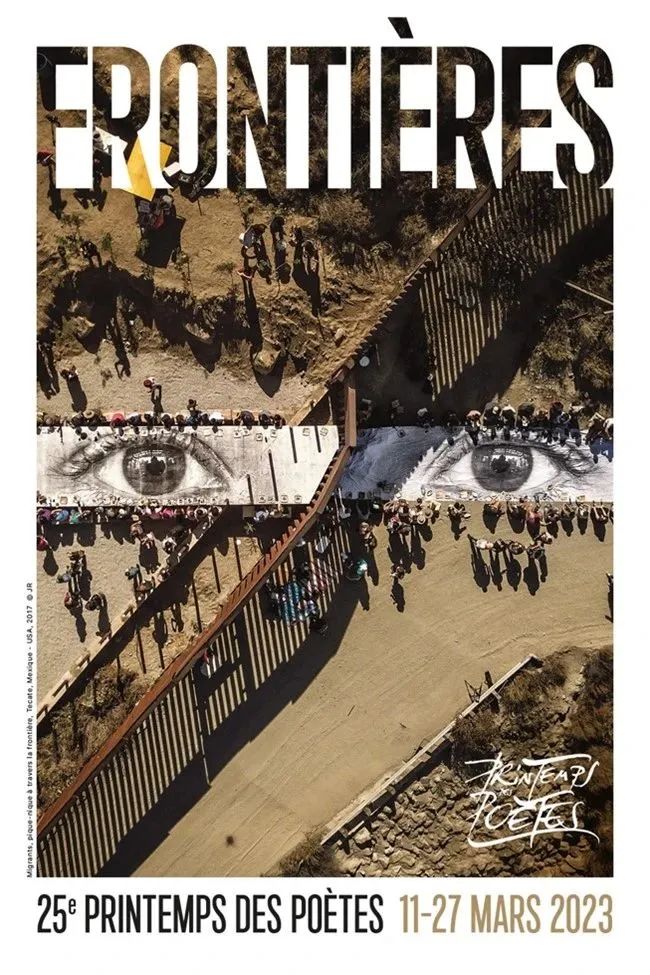
“
Qui peut participer ?
Tous les apprenants de français !
Du primaire à l’université, en passant par les écoles françaises, les Alliances Françaises et le LabelFrancÉducation, de tous niveaux, en Chine continentale.
“
Pourquoi participer ?
Pour travailler l’écrit en classe.
Pour avoir la chance de rencontrer un poète, lors d’un webinaire, pour une séance de travail et d’échange, organisé entre le 20 et le 26 mars 2023.
“
Quel format ?
Chaque classe participante propose un poème écrit en cours de français. Les œuvres ainsi produites seront rassemblées dans une œuvre écrite collective, qui tiendra sur un format passeport (125 x 88 mm), une page par poème et par classe (en édition numérique).
“
Modalités ?
Chaque enseignant complète, avant le 10 mars 2023, une fiche d’inscription disponible à la demande (activite.shenyang@institutfrancais-chine.com).
Chaque enseignant choisit jusqu’à 3 créneaux horaires possibles pour le webinaire, avant le 10 mars 2023, au lien suivant :
https://doodle.com/meeting/participate/id/bWPjRXnd
Chaque classe participante soumet un seul poème à renvoyer avant le 31 mars 2023 à l’adresse suivante :
activite.shenyang@institutfrancais-chine.com.
Le courriel devra également reprendre la fiche d’inscription remplie.
Le recueil complet sera diffusé aux participants et sur nos réseaux le 15 avril 2023.
Le Printemps des Poètes est une manifestation francophone créée en mars 1999. Il incite le plus grand nombre à célébrer la poésie, quelle que soit sa forme d'expression. Depuis 2001, chaque édition met en avant un sujet particulier sur lequel il est alors possible de composer selon son inspiration. Après « Le Désir » en 2021, « L’Éphémère » en 2022, « Frontières » est le thème retenu pour cette nouvelle édition.
L’Opération Coudrier est le fer de lance des actions d’éducation artistique et culturelle du Printemps des Poètes. Avec plus de 12 000 jeunes inscrits l’an dernier et 70 rencontres avec des poètes organisées dans toute la France, y compris l’outre-mer, l’Opération Coudrier, conjugue une exigence poétique affirmée et un déploiement de plus en plus vaste.
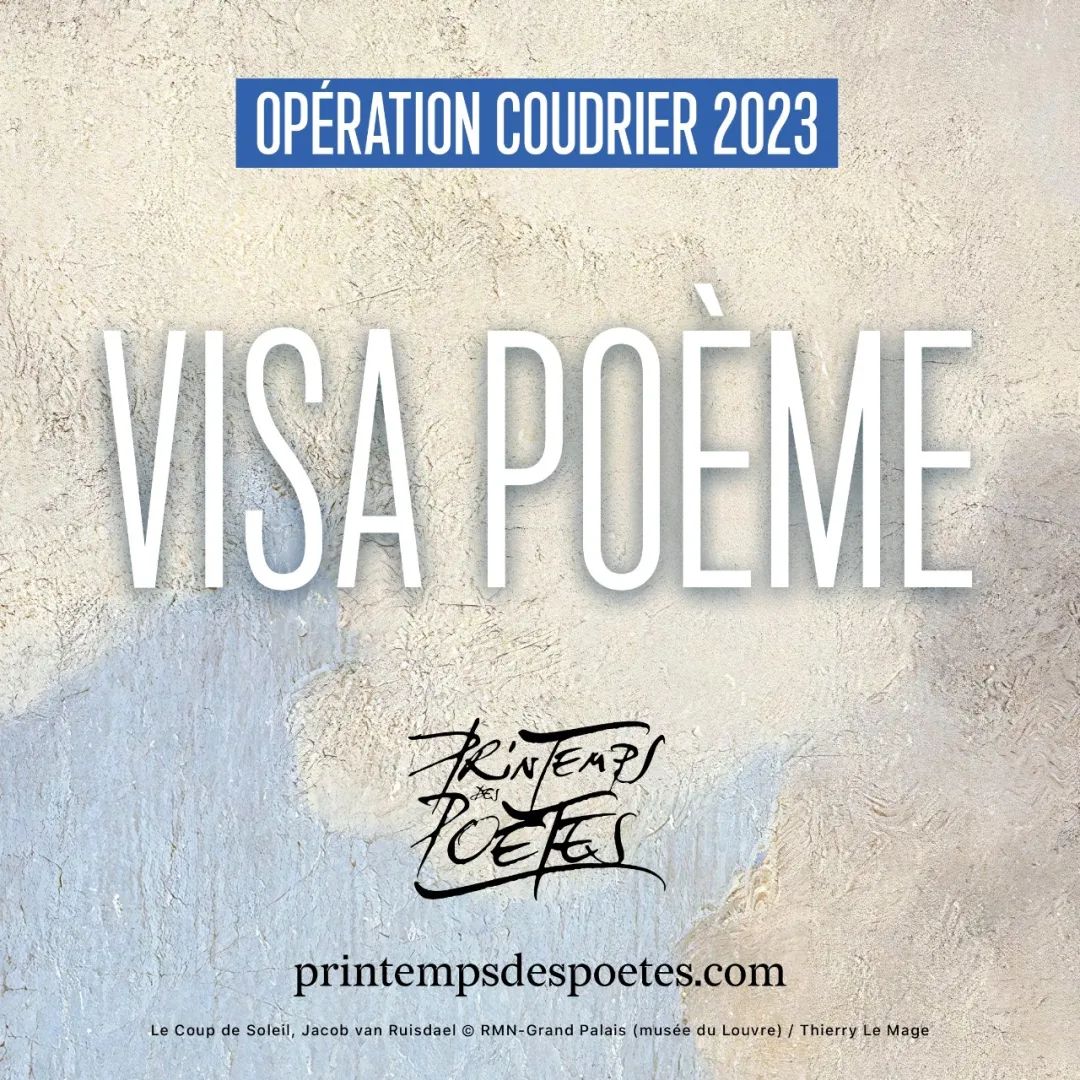
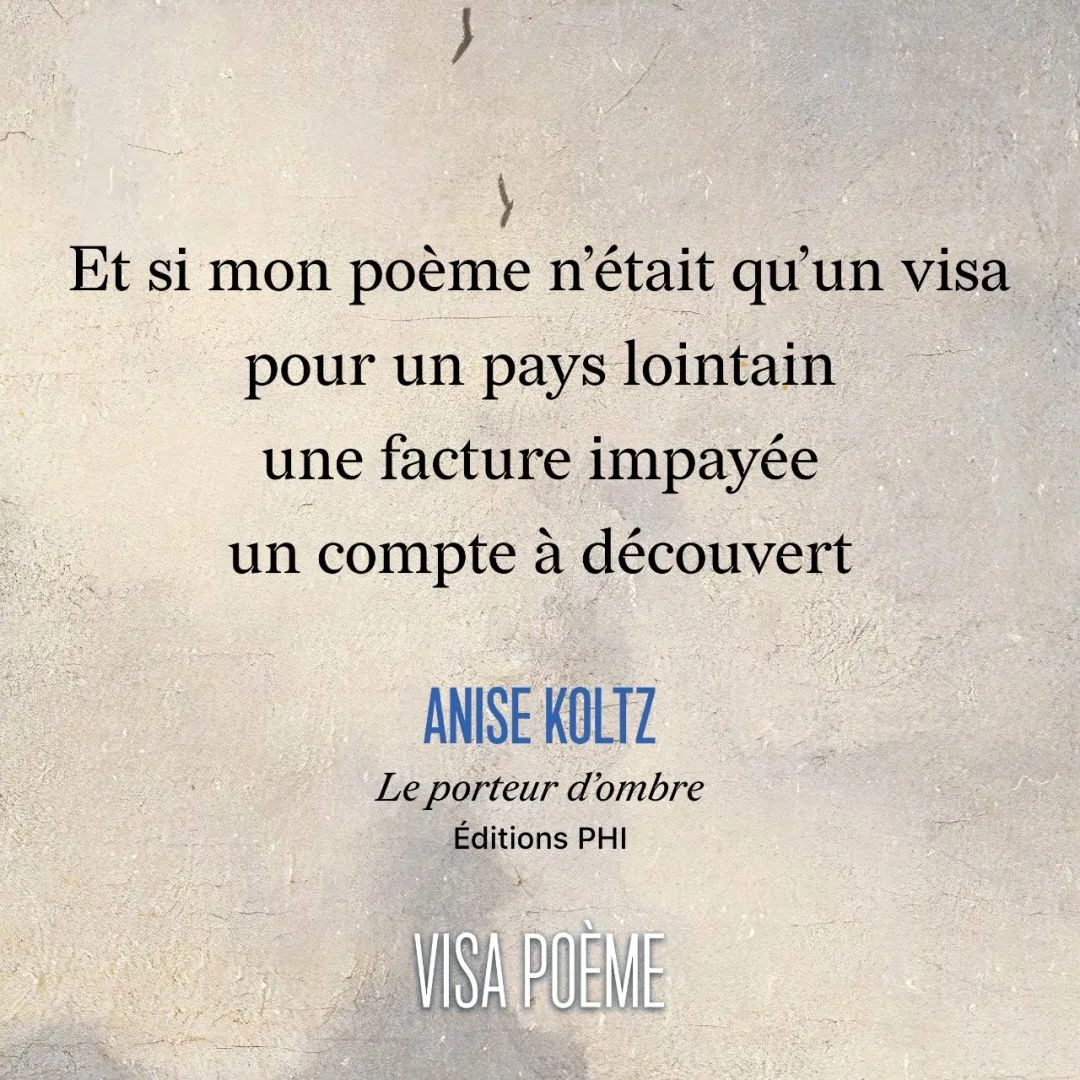
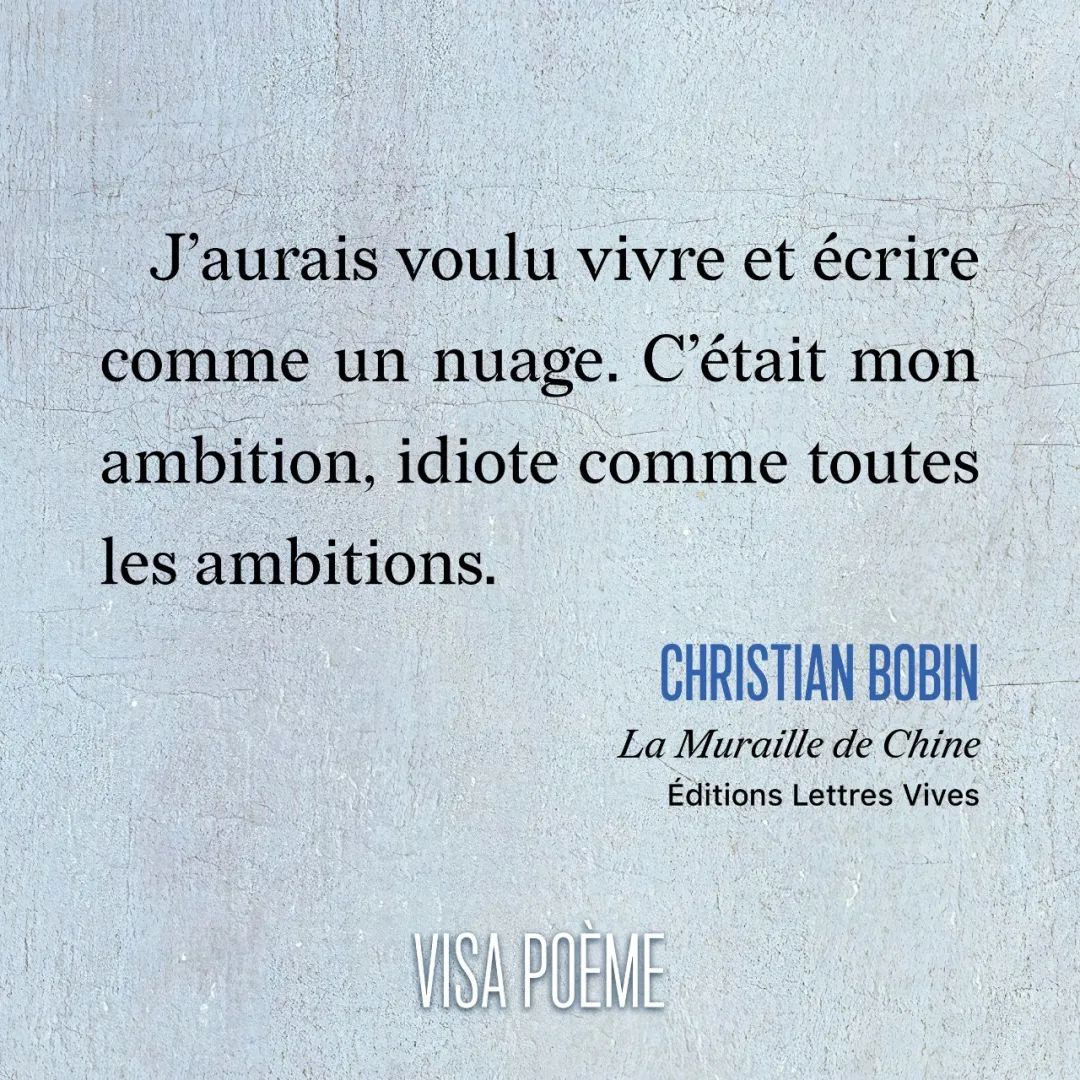
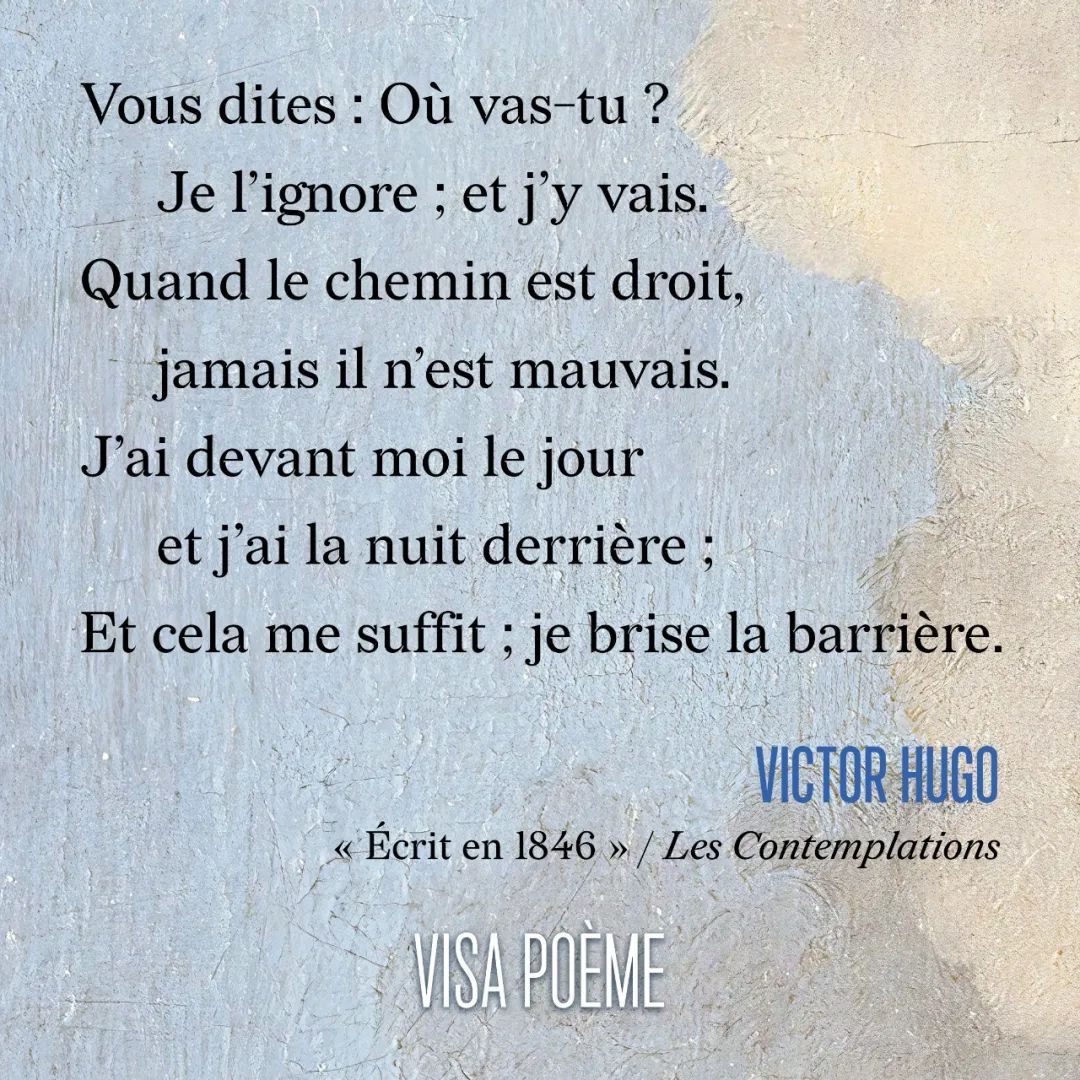
En Chine, les œufs à la tomate (西红柿炒鸡蛋) font partie des grands basiques de la cuisine familiale. Moins connue en France, l’omelette aux tomates est célébrée dans l’œuvre de Marcel Pagnol, qui pour cette nouvelle balade gustative et littéraire nous emmène dans sa terre natale, près d’Aubagne dans le sud de la France.
Amoureux de la Provence dont il est originaire, l’écrivain Marcel Pagnol a souvent rendu hommage dans ses livres et ses films à la cuisine régionale, colorée, parfumée et aux saveurs pleines de soleil. Les recettes sont traditionnelles et familiales, à l’image de son œuvre. La tomate apparaît très souvent dans la cuisine provençale, ainsi que les épices comme le basilic, le thym ou le romarin, qui en constituent la base. Ce sont ces épices que la mère de l’auteur utilise souvent en cuisine.
La famille du jeune Pagnol appartient à la classe moyenne du début du XXe siècle et sa mère est femme au foyer, comme c’est la coutume à l'époque. C’est donc elle qui a la charge de la cuisine. Dans plusieurs ouvrages, le narrateur mentionne l'omelette aux tomates de sa mère.
Ainsi, dans La Gloire de mon père, Augustine, la mère de Marcel Pagnol, prépare une omelette aux tomates pour le déjeuner des chasseurs. En effet, alors que son père lui avait promis qu’il pourrait les accompagner, le jeune Marcel découvre que lui et l’oncle Jules iront tous les deux chasser à l’aurore. Son petit frère, Paul a surveillé ce qu’il se passait en cuisine et va prévenir son frère qu’ils partiront sans lui le lendemain matin.


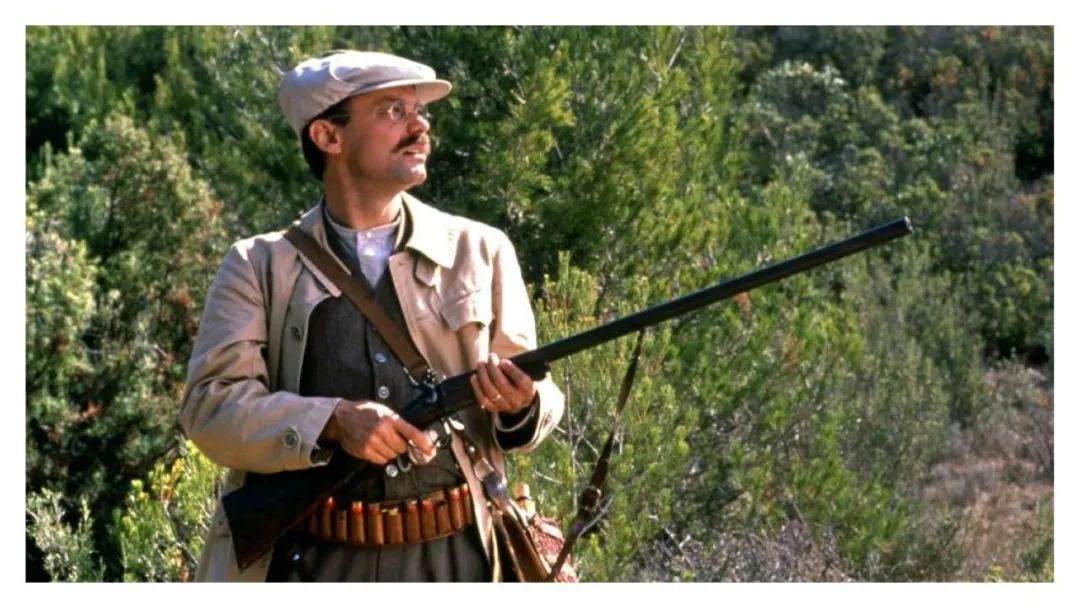
© Gaumont
Cet extrait est le début d’un passage qui s’avérera être un hymne à la désobéissance, puisque furieux, Marcel va quand même se lever et les suivre en catimini. Après s'être égaré, il finit par retrouver les chasseurs au son des coups de fusil. Il découvre que son père, qui « n'avait jamais tué ni poil ni plume », vient de réussir un « coup du roi » : il a abattu une paire de perdrix bartavelles en plein vol d'un seul coup de fusil. Ce doublé magnifique fait la renommée de Joseph Pagnol dans le village, pour la plus grande fierté de son fils, qui partage d'autant plus la gloire que c'est lui qui a retrouvé les puissants volatiles.
À propos de l’auteur
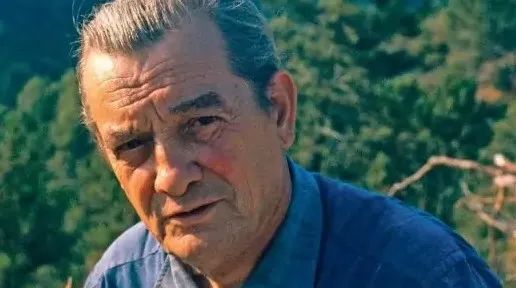

« Les plats se lisent et les livres se mangent », écrivait Marcel Proust. Pour poursuivre notre voyage gastronomique et littéraire, nous vous proposons cette semaine de rester dans l’univers de La recherche du temps perdu. Les odeurs appétissantes et les mets savoureux abondent dans toute l’œuvre de Marcel Proust. Ainsi, après la fameuse madeleine, la recette du bœuf mode en gelée, que Françoise mitonnait pour M. de Norpois ne devrait pas manquer de vous mettre l’eau à la bouche !

© Laurent Rouvrais
Découvert dès le Moyen-Âge, cette technique consistant à gélifier des aliments à l’aide d’un bouillon épaissi, permettait de conserver la fraîcheur de la viande cuite et de l'isoler de l'air et donc des bactéries. Tantôt présenté comme un plat anti-gaspillage en utilisant les restes d’un pot-au-feu, le bœuf en gelée gagne toutes ses lettres de noblesse, lorsqu’il est cuisiné par Françoise.

Achat par Françoise aux Halles des morceaux de bœuf
aquarelle par Bernard Soupre
Ainsi, dans À l’ombre des jeunes filles en fleurs, alors que le père du narrateur, diplomate distingué, a invité à déjeuner son supérieur hiérarchique, monsieur de Norpois, ancien ministre plénipotentiaire, Françoise, la fidèle cuisinière de la famille, a décidé de se surpasser en mettant au menu son fameux bœuf à la gelée. À la surprise générale, le marquis de Norpois, homme compassé, ennuyeux et peu enclin aux amabilités, ne tarit pas d’éloges envers la cuisinière.
À travers les mots de l’auteur, la technique du cuisinier est décrite comme l’exercice d’un art. On y découvre comment Françoise maîtrise avec précision et minutie l’art culinaire.
« Et depuis la veille, Françoise, heureuse de s’adonner à cet art de la cuisine pour lequel elle avait certainement un don, stimulée, d’ailleurs, par l’annonce d’un convive nouveau, et sachant qu’elle aurait à composer, selon des méthodes sues d’elle seule, du bœuf à la gelée, vivait dans l’effervescence de la création ; comme elle attachait une importance extrême à la qualité intrinsèque des matériaux qui devaient entrer dans la fabrication de son œuvre, elle allait elle-même aux Halles se faire donner les plus beaux carrés de romsteck, de jarret de bœuf, de pied de veau, comme Michel-Ange passant huit mois dans les montagnes de Carrare à choisir les blocs de marbre les plus parfaits pour le monument de Jules II. »
Extrait de À l’ombre des jeunes filles en fleurs,
deuxième tome d’À la recherche du temps perdu
On retrouve chez Proust un rapprochement permanent entre l’art et la pratique culinaire. L’auteur continue de jouer sur ce parallélisme dans la phase de dénouement de l’œuvre, qui se révèle être le récit d’une vocation ou de comment le narrateur devient un écrivain. Or ce que le narrateur réalise à la fin de l’œuvre, c’est qu’il écrira son livre de la même façon que Françoise faisait son bœuf mode en gelée ! C’est elle son modèle et son inspiration. Cette recette symbolise en quelques sortes toute l’œuvre de Proust.
« D’ailleurs, comme les individualités (humaines ou non) seraient dans ce livre faites d’impressions nombreuses, qui, prises de bien des jeunes filles, de bien des églises, de bien des sonates, serviraient à faire une seule sonate, une seule église, une seule jeune fille, ne ferais-je pas mon livre de la façon que Françoise faisait ce bœuf mode, apprécié par M. de Norpois, et dont tant de morceaux de viande ajoutés et choisis enrichissaient la gelée ? »
Extrait du Temps retrouvé,
septième et dernier tome d’À la recherche du temps perdu
À propos de l’œuvre
À la recherche du temps perdu est le titre de l’ensemble romanesque écrit par Marcel Proust, lu à travers le monde et sur lequel de nombreux chercheurs en littérature se penchent pour en déceler les ressorts narratifs et stylistiques. Cet ensemble de 2 400 pages traversé, de façon fugace ou prolongée, par plus de 2 500 personnages, fictifs ou réels, est composé de sept tomes : Du côté de chez Swann (1913), À l’ombre des jeunes filles en fleurs (1919, Prix Goncourt), Le Côté de Guermantes (1920), Sodome et Gomorrhe (1922), La Prisonnière (1923), Albertine disparue (1925) et Le Temps retrouvé (1927). Réflexion globale sur la littérature, l’amour, la mémoire et le temps, ce roman magistral a donné lieu à de nombreuses adaptations et continue d’inspirer dessinateurs, cinéastes et metteurs en scène du monde entier.
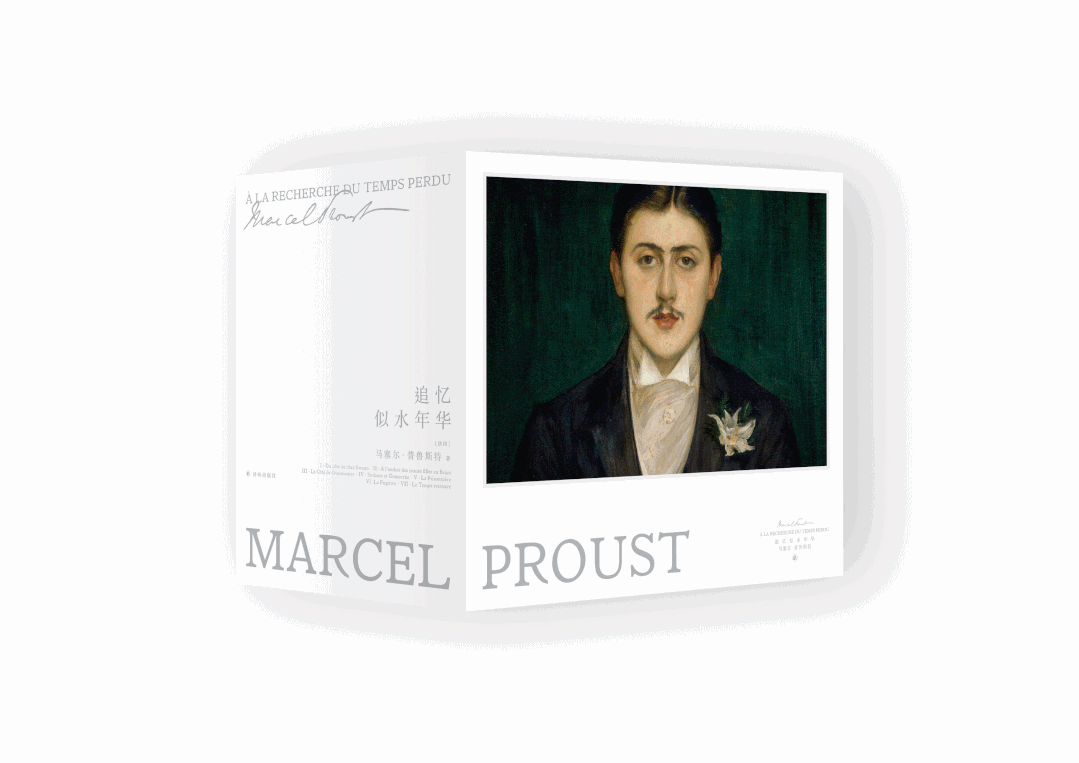
À vous fourneaux !
Faguowenhua vous propose cette recette de bœuf en mode gelée, inspirée de celle de Françoise.
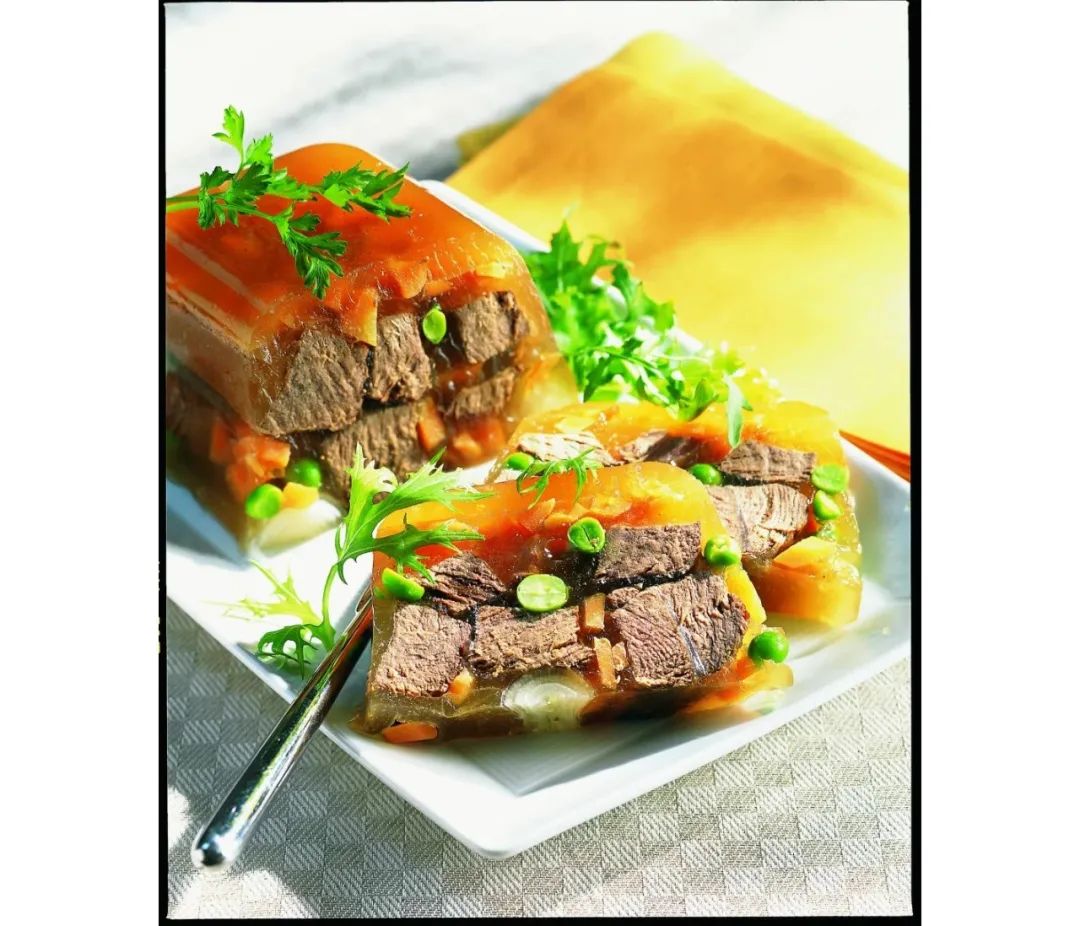
Pour 6 à 8 personnes
Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 3 heures
Temps de repos : 3 heures
Ingrédients
1 kg de pointe de culotte de bœuf
200 g de petits oignons grelots
200 g de carottes nouvelles
50 g de lard gras
1 pied de veau
4 blancs d'œufs
1 litre de vin blanc sec
Persil
Bouquet garni
Ail
Instructions
Faites rissoler les morceaux de bœuf dans un faitout puis mouillez-les à hauteur avec 1 litre de vin blanc sec.
Ajoutez les morceaux de pieds de veau dans le faitout, les lards de gras préalablement découpés. Salez et poivrez l’ensemble, rajoutez le persil et le bouquet garni. Couvrez et mettez à cuire durant 1h30 minimum.
Ajoutez les oignons grelots, l’ail et les carottes. Recouvrez et mettez de nouveau à cuire pendant 1h30.
La viande une fois cuite, égouttez-la. Passez le jus au chinois avant de l’amener à ébullition, ajoutez-y 4 blancs d’œufs battus et laissez le tout sur le feu pendant 5 minutes.
Coupez la viande en tranches de 5 mm d’épaisseur, déposez-les dans un plat creux, ajoutez dessus les carottes, les oignons et versez le jus de cuisson à mi-hauteur. Placez le plat dans le réfrigérateur durant 3 heure.
Le chef de la Résidence de France vous propose une adaptation savoureuse de cette recette traditionnelle, avec son carpaccio de bœuf en gelée. Découvrez-la en vidéo !
Le 11 novembre 2022, M. Nicolas Pillerel, ministre conseiller pour les affaires culturelles, éducatives et scientifiques, et Mme Séverine Boué, attachée de coopération scolaire et universitaire du consulat général de France à Shanghai, ont visité l’École secondaire des langues étrangères Ganquan de Shanghai.
Fondée en 1954, l’École secondaire des langues étrangères Ganquan de Shanghai est un établissement public qui comprend les cycles collège et lycée répartis en 43 classes. Elle compte 1 700 élèves environ et 230 employés. Spécialisée dans les langues étrangères, le japonais, le français, l’anglais, l’allemand et l’espagnol y sont enseignés en LV1, et le coréen, le thaï, le russe et l’italien en LV2.
Initialement connu pour son enseignement de japonais, Ganquan a fait le choix de l'enseignement du français en LV2 dès 1999, à une époque où peu d'établissements secondaires sortaient du schéma « anglais, russe, japonais ». Dans le cadre du développement de la politique d'enseignement multilingue de l'établissement, la classe bilingue (français en LV1) a ouvert en 2014. La filière de français compte 6 enseignants de FLE. Les élèves ont la possibilité de passer l’épreuve de français au Gaokao. En 2019, l’établissement a reçu le LabelFrancEducation, un label d’excellence attribué par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères aux écoles qui font le choix des filières bilingues franco-chinoises.
M. Pillerel et Mme Boué ont été chaleureusement accueillis par Mme Yang Yun, proviseure, et Mme Jiang Wenyi, directrice adjointe du département de développement, les professeurs de français et leurs élèves. Dans son discours, M. Pillerel a remercié la proviseure, les personnels et les élèves pour leur accueil. S’agissant de sa première visite à Shanghai, il s’est réjoui de visiter ce bel établissement, qui est spécialisé dans les langues et qui est détenteur du LabelFrancEducation. Il a salué l’engagement de l’école en faveur de l’éducation, de la langue et de la culture françaises, et l’a félicitée pour la reconduction du label en octobre 2022. Enfin, il s’est réjoui de participer à des activités organisées par le service universitaire du consulat et les élèves et leurs professeurs à l’occasion du Mois franco-chinois de l’environnement.
Mme Yang Yun a présenté son établissement et son développement depuis sa création. Elle a également présenté la filière de français indiquant qu’elle était une priorité. Elle a remercié les représentants du poste diplomatique pour leur visite et leur soutien. La pandémie empêchant les mobilités entre la France et la Chine et réduisant les déplacements en Chine, elle s’est félicitée de l’organisation régulière d’événements avec le consulat à l’occasion du Mois de la francophonie, du Mois franco-chinois de l’environnement, de la Journée internationale des professeurs de français, etc.
Après les discours, les activités du Mois franco-chinois de l’environnement se sont déroulées. Créé en 2014, ce festival pluridisciplinaire, créé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, a pour but de sensibiliser le public le plus large possible aux enjeux environnementaux. Le thème de l’édition 2022 est la planète bleue. Les élèves ont d’abord joué à un quizz sur les océans proposé par le service universitaire du consulat.
Puis, deux élèves ont présenté leurs exposés. Mao Weilin a fait une présentation sur les causes de la pollution marine et les petits gestes à effectuer pour la réduire. Quant à Shi Yunling, il en a fait une sur les coraux, les menaces auxquels ils sont confrontés et les solutions pour les protéger.
Les élèves ont visionné deux documentaires du Centre national de la recherche scientifique : Nanoplastique : une soupe au goût amer et La daurade royale face au changement climatique. Après chaque projection, Mme Séverine Boué a échangé avec les élèves sur le contenu du documentaire. A l’issue des activités du MFCE, M. Pillerel et Mme Boué ainsi que les élèves et les personnels de Ganquan ont discuté autour d’un goûter et pris des photos. Avant de se quitter, l’attachée universitaire a remis à chaque élève un sac contenant des fournitures scolaires offertes par Maped, une entreprise française spécialisée dans les fournitures scolaires. Engagée dans l’éducation et l’environnement, la marque française a souhaité apporter son soutien aux événements que le service universitaire du consulat organise dans le cadre du Mois franco-chinois de l’environnement.
La madeleine de Proust
Comment parler de « littérature délicieuse » sans mentionner la madeleine de Proust ? Ces petits gâteaux « courts et dodus », semblant « avoir été moulés dans la valve rainurée d’une coquille de Saint-Jacques », sont restés des pâtisseries très populaires aujourd’hui. Dans le roman À la recherche du temps perdu, lorsqu’un jour d’hiver, en rentrant à la maison, le narrateur accepte ces gâteaux proposés par sa mère. Une gorgée de thé mêlée aux miettes du gâteau le fait alors tressaillir de plaisir et le replonge dans le souvenir d’un rituel de son enfance.
Nous vous proposons d’abord de savourer le goût de la madeleine avec ce célébrissime passage dans Du côté de chez Swann, premier volume de l’œuvre.
« Et tout d'un coup le souvenir m'est apparu. Ce goût c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin, à Combray (parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe), quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté ; peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents ; peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé ; les formes – et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel, sous son plissage sévère et dévot – s'étaient abolies, ou, ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir.
Et dès que j’eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante (quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux), aussitôt la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre s’appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin, qu’on avait construit pour mes parents sur ses derrières (ce pan tronqué que seul j’avais revu jusque-là) ; et avec la maison, la ville, la Place où on m’envoyait avant déjeuner, les rues où j’allais faire des courses depuis le matin jusqu’au soir et par tous les temps, les chemins qu’on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les Japonais s’amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d’eau de petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés s’étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de même maintenant toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l’église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville et jardins, de ma tasse de thé. »
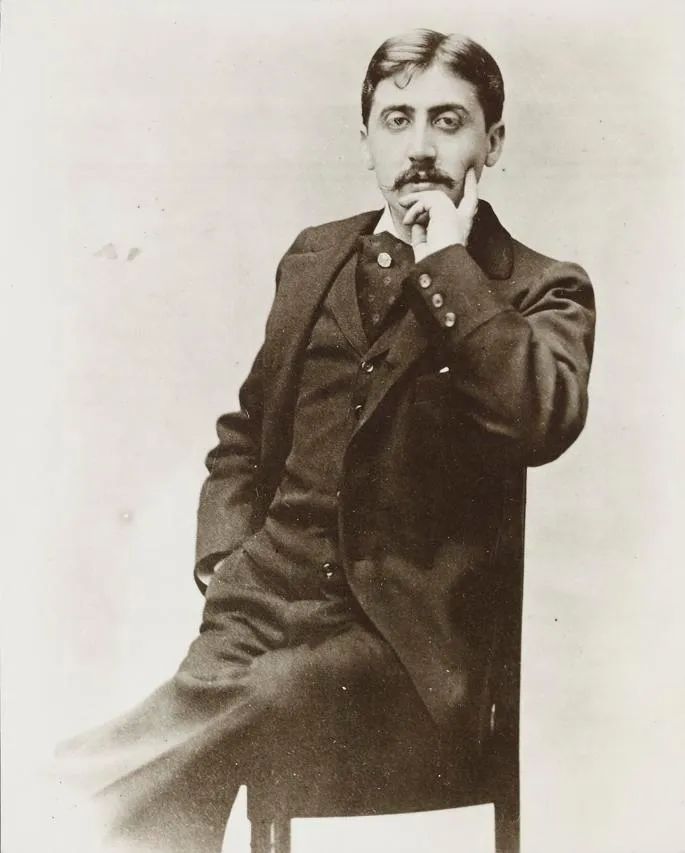
Un siècle après la parution du texte, la « madeleine de Proust » devient une expression qui désigne tout élément déclencheur de souvenir, sans que l’on ne cherche à s’en rappeler. D’autres objets que le gâteau de la madeleine ont provoqué le même phénomène de réminiscences chez le narrateur de Proust, tels que les pavés inégaux de la cour de l’hôtel de Guermantes, sur lesquels il pose ses pieds, comme décrit plus tard dans Le Temps retrouvé : « Et presque tout de suite, je le reconnus, c’était Venise, dont mes efforts pour la décrire et les prétendus instantanés pris par ma mémoire ne m’avaient jamais rien dit et que la sensation que j’avais ressentie jadis sur deux dalles inégales du baptistère de Saint-Marc m’avait rendue avec toutes les autres sensations jointes ce jour-là à cette sensation-là, et qui étaient restées dans l’attente, à leur rang, d’où un brusque hasard les avait impérieusement fait sortir, dans la série des jours oubliés. De même le goût de la petite madeleine m’avait rappelé Combray. »
À la recherche du temps perdu est le titre de l’ensemble romanesque écrit par Marcel Proust, lu à travers le monde et sur lequel de nombreux chercheurs en littérature se penchent pour en déceler les ressorts narratifs et stylistiques. Cet ensemble de 2400 pages traversé, de façon fugace ou prolongée, par plus de 2500 personnages, fictifs ou réels, est composé de sept tomes : Du côté de chez Swann (1913), À l’ombre des jeunes filles en fleurs (1919, Prix Goncourt), Le Côté de Guermantes (1920), Sodome et Gomorrhe (1922), La Prisonnière (1923), Albertine disparue (1925) et Le Temps retrouvé (1927). Réflexion globale sur la littérature, l’amour, la mémoire et le temps, ce roman magistral a donné lieu à de nombreuses adaptations et continue d’inspirer dessinateurs, cinéastes et metteurs en scène du monde entier.
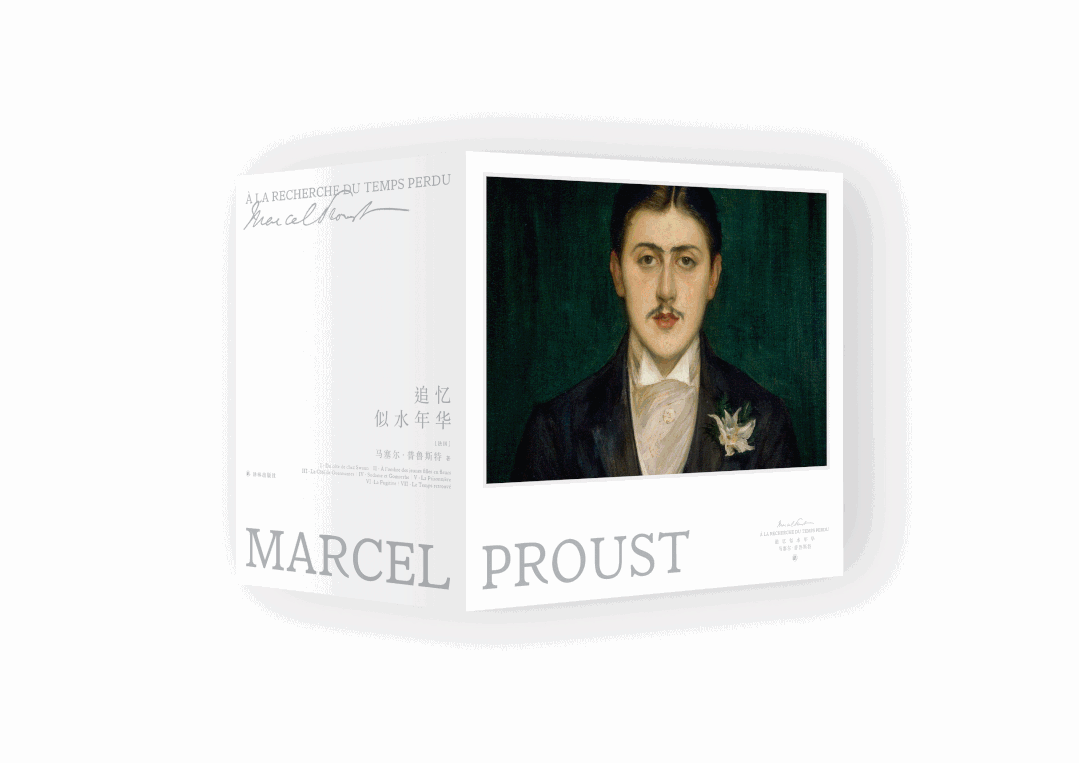
Revenons à nos gâteaux. Qui est donc à l’origine de cette pâtisserie en forme de coquillage ayant fait consommer tant d’encre au grand écrivain ? Selon une version communément admise, elle aurait été créée au XVIIIe siècle par une certaine Madeleine Paulmier, cuisinière du duc de Lorraine Stanislas Leszczyński, à l’occasion d’une réception à Commercy. Face à son succès, le duc baptisa le gâteau en hommage à sa créatrice.
Les vacances sont sans doute le meilleur moment pour confectionner vos madeleines et les faire goûter à vos proches. Faguowenhua vous propose cette recette simple.

Réalisation :
- Ajoutez délicatement en pluie la farine mélangée avec la levure. Continuez de fouetter en même temps, ça muscle !
- Quand le mélange devient bien homogène, ajoutez le beurre et terminez par les deux petites cuillères de vanille. Astuce : pour que des madeleines soient bien dodues, faites reposer la pâte au frigo pendant au moins 2 heures, voire toute une nuit.
- Après avoir beurré un peu les moules, remplissez-les à la petite cuillère aux deux tiers sans étaler la pâte.
- Préchauffez le four à 200 °C. Dès que les madeleines sont au four, baissez la température à 180 °C et faites-les cuire 10 à 15 minutes. Un creux se forme avant l’apparition de la bosse. À partir de ce moment, il faut les surveiller de près !
Pour les plus ambitieux, la cheffe pâtissière de la Résidence de France vous suggère une recette de madeleines accompagnées d'une crème onctueuse au chocolat, de riz soufflé au caramel et de granité de café !
Découvrez-la en vidéo !
Le 18 novembre, Mme Séverine Boué, attachée de coopération scolaire et universitaire au consulat général de France à Shanghai, était au Lycée Guangming de Shanghai pour participer à des activités dans le cadre de la 9e édition du Mois franco-chinois de l’environnement-MFCE dont le thème est « la planète bleue ».
Mme Séverine Boué a été accueillie par Mme Zhu Xiaowei, proviseure, M. Zhong Hao, proviseur adjoint, plusieurs professeurs de français et leurs élèves. Elle s’est d’abord entretenue avec la proviseure. Mme Séverine Boué et Mme Zhu Xiaowei ont fait le point sur la situation du français à Guangming (effectifs des élèves et des enseignants de FLE, recrutement des enseignants de FLE, mobilité des élèves en France après le Gaokao, LabelFrancEducation, passation du DALF-DELF au Lycée, etc.). La proviseure a remercié Mme Boué pour l’organisation régulière d’événements dans son établissement à l’occasion du Mois de la francophonie, du Mois franco-chinois de l’environnement, etc. et du soutien de l’ambassade et du consulat à l’enseignement et au développement du français au Lycée. Elle lui a présenté M. Helloïs Henry, enseignant français de FLE, qui a pris ses fonctions il y a quelques semaines.
Le Lycée Guangming a une relation ancienne et privilégiée avec la France puisqu’il fut créé en 1886 par des jésuites. Aussi est-il l’un des plus anciens établissements de Shanghai à y enseigner le français. Il compte actuellement 420 élèves qui apprennent le français et 9 enseignants de français. Il a des partenariats avec des lycées français pour des échanges d’élèves et d’enseignants et avec des établissements d’enseignement supérieur français permettant aux élèves diplômés de faire une partie de leurs études supérieures en France.
Dans le domaine de l’enseignement du français, le lycée Guangming fait figure d’établissement pionnier et pilote. En 2005, il fut l’un des trois premiers établissements nommés par le gouvernement de Shanghai pour expérimenter des classes bilingues en français et en anglais. En 2017, le Lycée fut le premier établissement scolaire à obtenir le LabelFrancEducation en Chine, un label d’excellence attribué par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères aux écoles qui font le choix des filières bilingues franco-chinoises. D’une durée de trois ans, le label a été renouvelé en 2020. Etablissement pilote, Guangming a organisé la première passation des examens du DALF-DELF dans son enceinte en 2021.
Après l’entretien, Mme Séverine Boué et Mme Zhu Xiaowei ont rejoint les élèves de terminale qui venant de regarder Océans, un très beau documentaire sur les océans réalisé par Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. Sorti en 2010, les réalisateurs et leurs équipes ont parcouru les océans, d’un pôle à l’autre, pour témoigner de la diversité et de la beauté de la vie marine, mais aussi de sa fragilité. Le film dénonce les activités anthropiques, qui sont responsables de la disparition de certaines espèces animales et végétales marines. Après le discours de la proviseure, les élèves se sont prêtés à une réunion fictive intitulée « Le parlement de l’environnement ». Dans cette simulation d’une séance de l’Assemblée nationale, les élèves, jouant le rôle de députés, posaient des questions à deux ministres français et deux ministres chinois de l’environnement. Ces derniers leur répondaient en indiquant les initiatives mises en place et les lois votées en France et en Chine pour réduire la pollution et protéger l’environnement.
Puis, les élèves ont joué à une simulation du célèbre jeu français Questions pour un championanimé par M. Helloïs Henry. Dans son discours, Mme Séverine Boué a remercié et félicité le Lycée Guangming pour le succès et le développement de sa filière bilingue de français. Puis, elle a présenté le Mois franco-chinois de l’environnement et le thème de l’édition 2022. Créé en 2014, le MFCE est le seul festival pluridisciplinaire dédié à l’environnement organisé en Chine par une ambassade sur l’ensemble du territoire. Il a pour objectif de sensibiliser le public le plus large possible aux enjeux environnementaux. Elle a présenté la 9e édition du MFCE consacré aux océans. Les océans, qui couvrent 71 % de la surface de la Terre, joue un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique. L’impact des activités humaines portent gravement atteinte à la santé des océans : 40 % des océans du globe sont durement touchés par les activités humaines. Aussi les pays doivent-ils impérativement et urgemment réduire leurs activités anthropiques sur les océans. Enfin, Mme Séverine Boué a animé un jeu de questions-réponses créé par le service universitaire du consulat sur les océans avec les élèves.
A la fin des activités, Mme Boué a remis à tous les élèves un sac contenant des fournitures scolaires offertes par l’entreprise française Maped. Engagée dans l’éducation et l’environnement, la marque française de fournitures scolaires a souhaité apporter son soutien aux événements que le service scolaire et universitaire du consulat organise dans le cadre du Mois franco-chinois de l’environnement. La visite s’est conclue dans une ambiance joyeuse par une photo de groupe. En partant, Mme Zhu Xiaowei a remis à Mme Boué une lettre des élèves de français à l’attention du président de la République, M. Emmanuel Macron. Dans ce courrier ils remercient le président de la République française d’avoir mentionné le Lycée Guangming dans son discours pour la stratégie de la langue française à l’Institut de France le 20 mars 2018 : « En dehors même de nos établissements, les filières bilingues francophones sont en effet très demandées à l’étranger, du Lafayette Academy de New York jusqu’au lycée Guangming de Shanghai en passant par le 18e lycée de Zagreb. Pour accompagner leur développement, la mission de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger en la matière sera renforcée. L’objectif est qu’en 2022, le réseau des écoles proposant des sections bilingues francophones de qualité portant le label France Education regroupe 500 établissements contre les quelque 209 actuellement ».
Le 17 novembre 2022, Mme Séverine Boué, attachée de coopération scolaire et universitaire au consulat général de France à Shanghai, a organisé une rencontre littéraire intitulée Jules Verne et Vingt mille lieues sous les mers à la Chambre de commerce et d’industrie française en Chine autour de deux universitaires : M. Gaultier Roux, maître de conférences en littérature française à l’Université Fudan, et Mme JIN Jufang, maîtresse de conférences en langue et littérature françaises à l’Université normale de la Chine de l’Est-ECNU et traductrice.
Cette rencontre littéraire s’inscrivait dans le cadre du Mois franco-chinois de l’environnement-MFCE, une initiative du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Créé en 2014, le MFCE est un festival pluridisciplinaire dédié à l’environnement organisé chaque année sur l’ensemble du territoire chinois. Il a pour objectif de sensibiliser le public le plus large possible aux enjeux environnementaux. La 9e édition du MFCE a pour thème « la planète bleue ». La mer était une passion pour Jules Verne et elle est l’héroïne de Vingt mille lieues sous les mers. Le sujet était donc tout trouvé pour organiser une rencontre littéraire dans le cadre du MFCE.
Jules Verne (1828-1905) est un écrivain majeur du XIXe siècle, dont les œuvres sont traduites dans de nombreuses langues : il est au deuxième rang des auteurs les plus traduits en langue étrangère, et en 2011, il a été l'auteur de langue française le plus traduit dans le monde. Il développe très tôt un goût pour l'écriture et grâce à sa rencontre avec Alexandre Dumas fils commence à publier des nouvelles. Après plusieurs romans, il publie en 1872 Le Tour du monde en 80 jours, roman qui connaît un grand succès. Une grande partie de son œuvre est consacrée à des romans d’aventures et de science-fiction. Il a inventé un genre littéraire : le « roman de la science ». Les grandes avancées scientifiques sont au cœur de ses romans. Voyage au centre de la terre en 1864, De la terre à la lune en 1865, Vingt mille lieues sous les mers en 1869 sont autant des succès de librairie que des chefs-d'oeuvre de littérature d'anticipation.
Paru en 1869-1870, Vingt mille lieues sous les mers est l’un de ses meilleurs et plus célèbres romans. C'est le cinquième livre le plus traduit au monde (174 langues). Il relate le voyage de trois naufragés capturés par le capitaine Nemo, mystérieux inventeur qui parcourt les fonds des mers à bord du Nautilus, un sous-marin très en avance sur les technologies de l'époque.
M. Gaultier Roux est maître de conférences spécialiste en littérature française des XIXe et XXe siècles et théorie de la littérature. Il a consacré sa thèse de doctorat à l’écrivain français Pierre Loti (Université Paris-Sorbonne, 2015). Il a de nombreuses publications à son actif dont : Pierre Loti, Les Derniers jours de Pékin (édition critique Gaultier Roux, avec une préface de G. Roux et Alain Quella-Villéger), Paris, Magellan & Cie, 2021 ; Jules Verne, Le Chancellor, édition critique par Gaultier Roux (préface, notes, dossier et glossaire), Paris, Magellan & Cie, à paraître au début de 2023.
Mme Jin Jufang a passé six ans en France où elle effectué son master 2 et sa thèse de doctorat à l’Université Paris 3. Sa thèse de doctorat, soutenue en 2010, portait sur l’étude comparative des œuvres de Claude Simon et de Yu Hua. Traductrice, Mme Jin Jufang a traduit de nombreux ouvrages, dont L’Acacia, de Claude Simon, Hunan Art and Literature Publishing House, 2016, pour lequel elle a reçu le prestigieux prix FU Lei de la traduction et de l’édition, dans la catégorie « littérature » en 2016. Mais aussi et surtout, Mme Jin Jufang a traduit deux romans de Jules Verne : Vingt mille lieues sous les mers, Citic Publishing House, 2019 ; Le Tour du monde en quatre-vingt jours, Citic Publishing House, 2022.
M. Gaultier Roux a d’abord parlé de l’importance de la mer dans l’œuvre de Jules Verne. Mme Jin Jufang a ensuite présenté la genèse du roman et rappelé son synopsis. Elle a retracé la réception de l’auteur français et du roman en Chine. Traduit il y a plus d’un siècle, l’écrivain est depuis lors très lu dans le pays. Les deux universitaires ont ensuite discuté des multiples facettes de la mer dans le roman. Elle représente ainsi pour le capitaine Nemo, qui a délibérément choisi de vivre en marge de la société, un espace de vie, de ressources, de pureté, de liberté et d’indépendance par opposition aux continents, synonymes de domination, de colonisation, de conflits et d’injustice. M. Roux et Mme Jin ont ensuite traité de la modernité du roman, et plus spécifiquement des innovations technologiques, qu’elles aient déjà existé alors ou que l’auteur les anticipe. Le sous-marin Nautilus, qui est l’élément central du roman, représente une prouesse d’ingénierie. La troisième partie de l’échange était consacrée à la richesse économique des océans. C’est un lieu fabuleux regorgeant de trésors naturels et de ressources diverses, un espace où l’autosuffisance est possible. Il représente même la possibilité d’une utopie sociale. Jules Verne est l'un des premiers romanciers à avoir introduit des préoccupations écologiques dans une œuvre de fiction. Cependant, la mer y est à l’image du monde : la rapacité de l’homme s’y exerce et Jules Verne met en lumière la surexploitation des ressources halieutiques qui caractérise déjà l’époque. Somme toute, l’œuvre s’est avérée déterminante dans la prise de conscience de la richesse et de la diversité des fonds marins, et a forgé l’imaginaire maritime de nombreuses générations de lecteurs.
A l’issue de leur présentation, les participants leur ont posé des questions sur leurs interventions mais aussi sur Jules Verne et son œuvre. Les échanges se sont poursuivis dans une ambiance conviviale autour d’un verre.
兔
年
说
兔
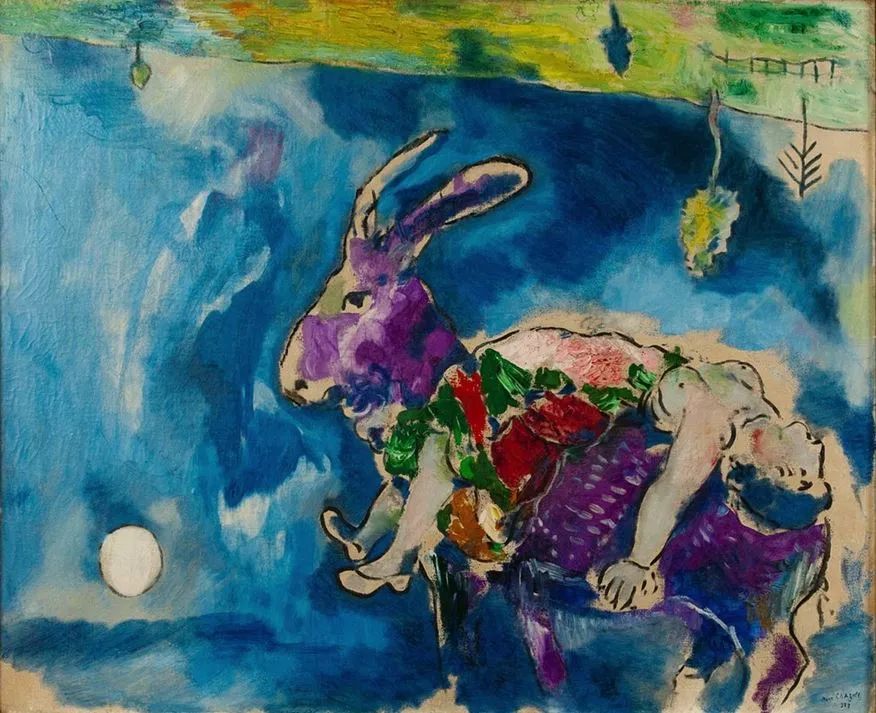
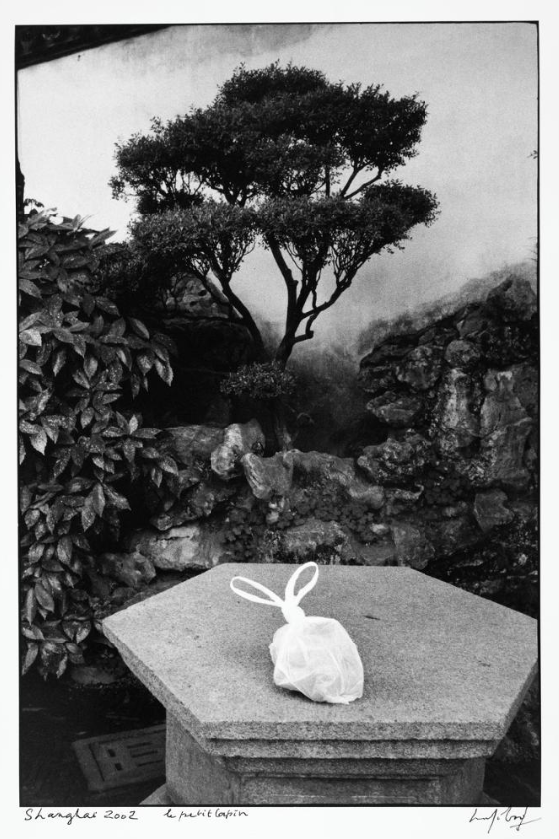
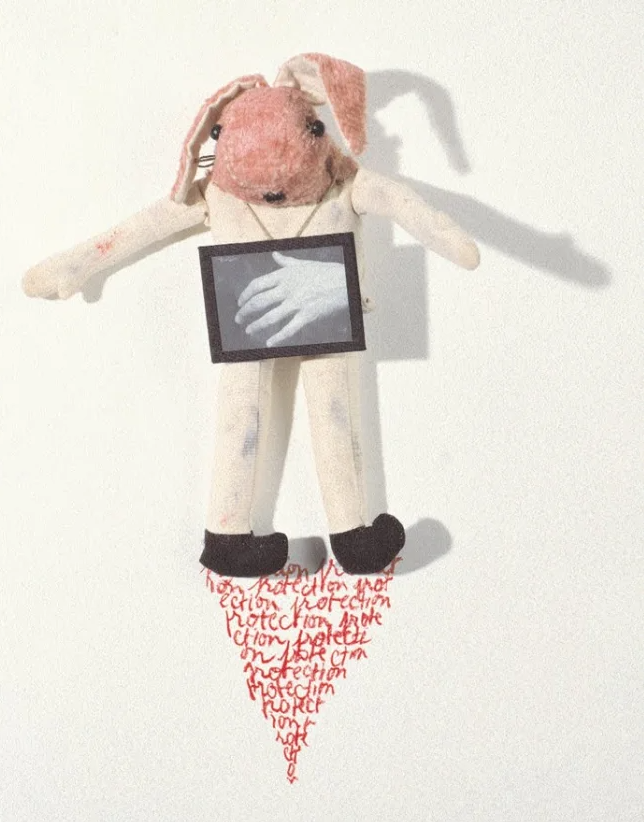
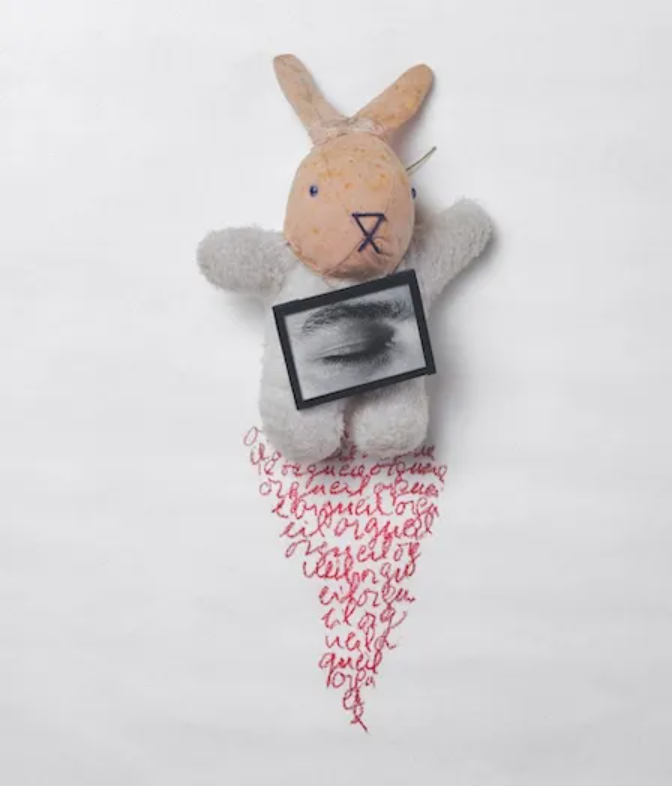


Joyeux nouvel an chinois et une bonne année du lapin ❤️
Bonne année du lapin d’eau ! Pour accompagner le grand moment de retrouvailles familiales que sont les vacances du Nouvel An chinois, Faguowenhua vous propose 8 films français à voir et à revoir en famille. Rires, émotions, aventures, découvertes… Du grand classique au dessin animé, en passant par la comédie familiale, il y en aura pour tous les goûts ! Transformez votre salon en salle de cinéma, et partagez des bons moments en famille !
//


//
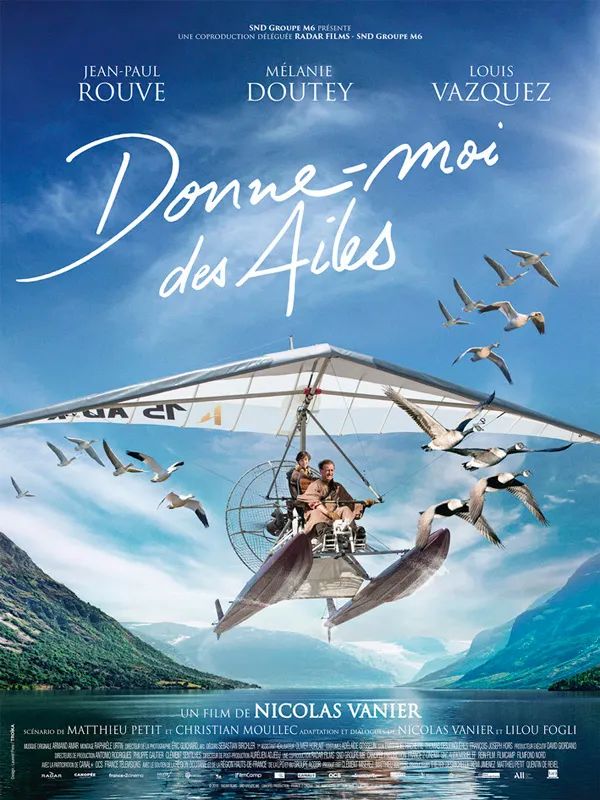

//

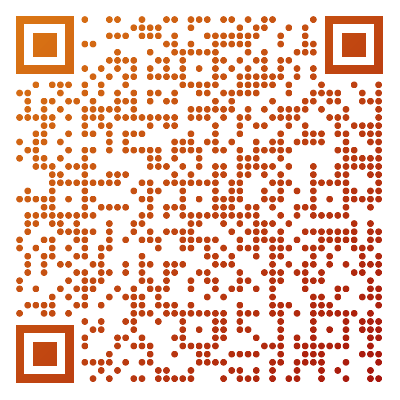
//
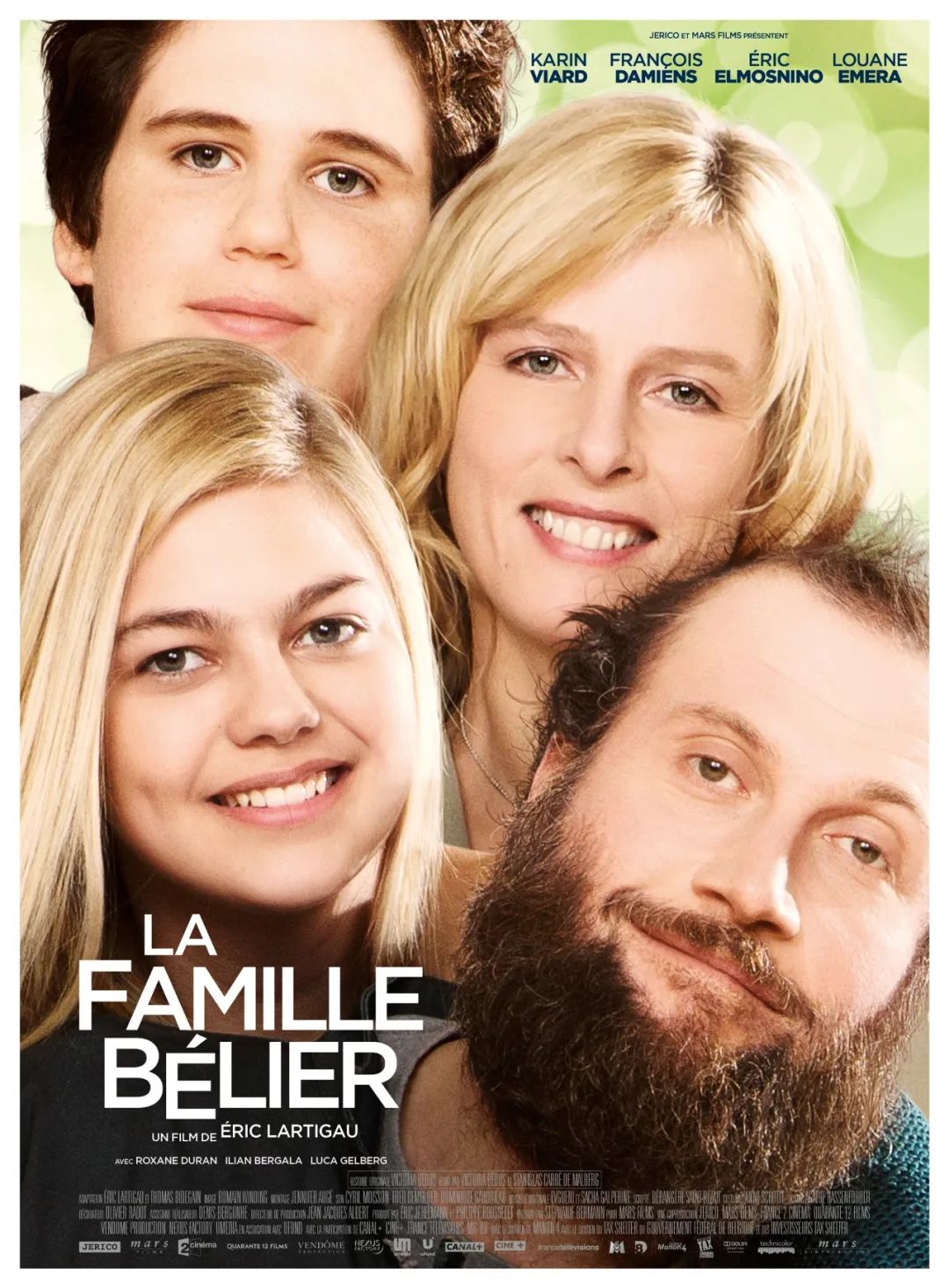
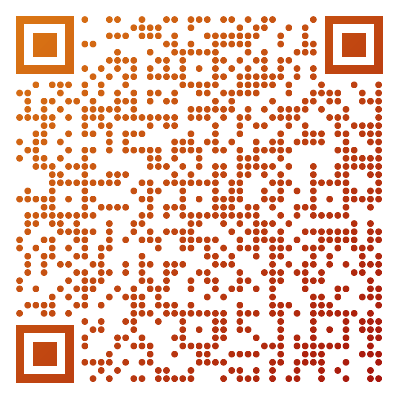
//


//
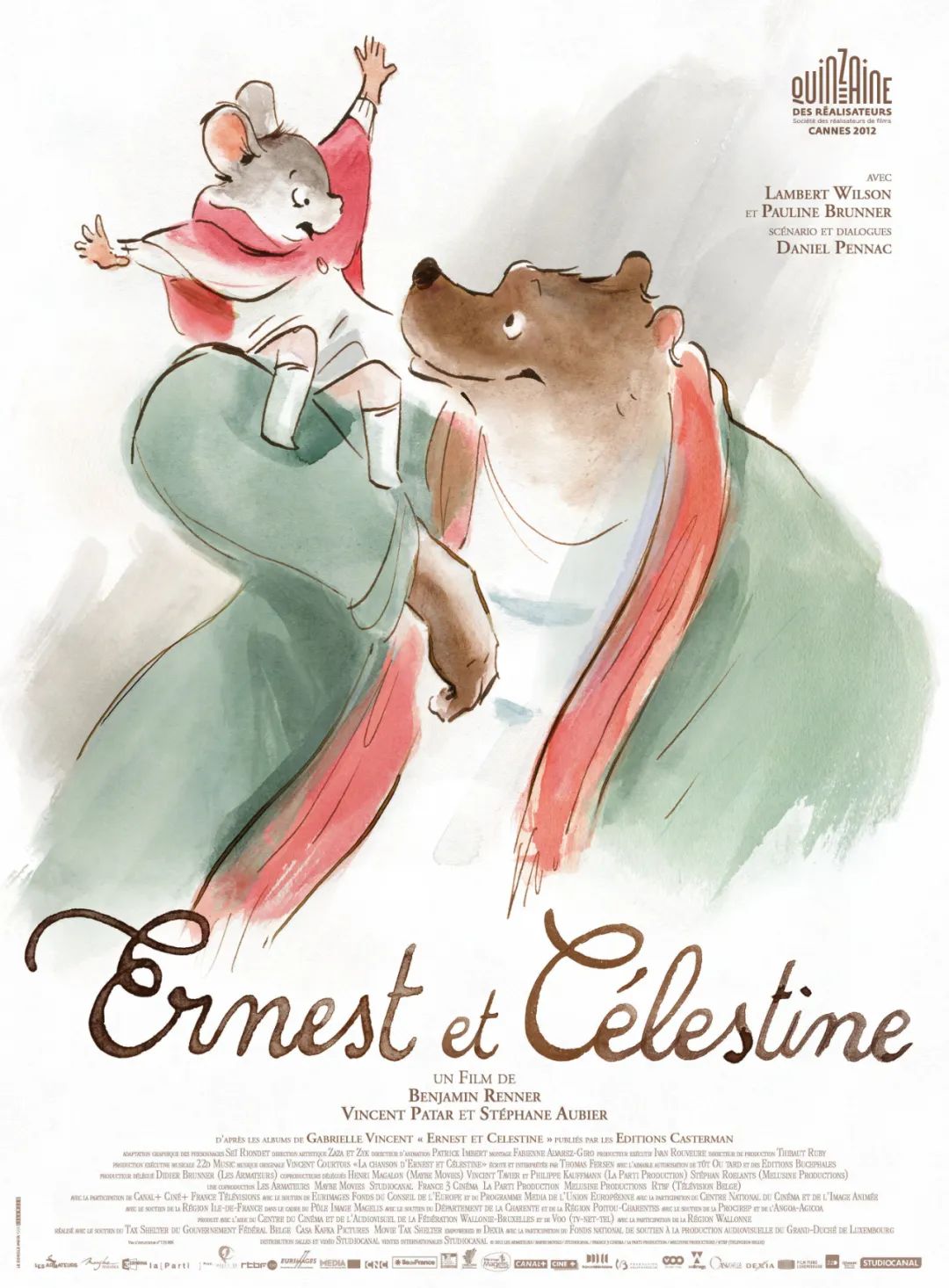
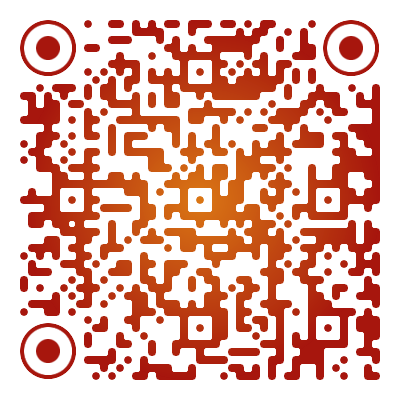
//

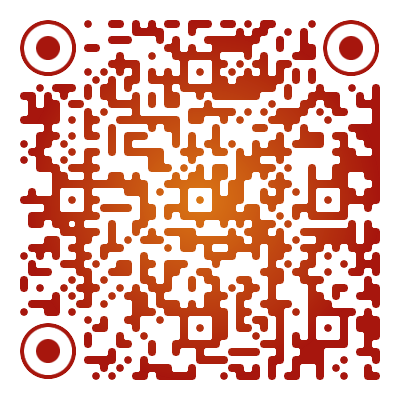
//
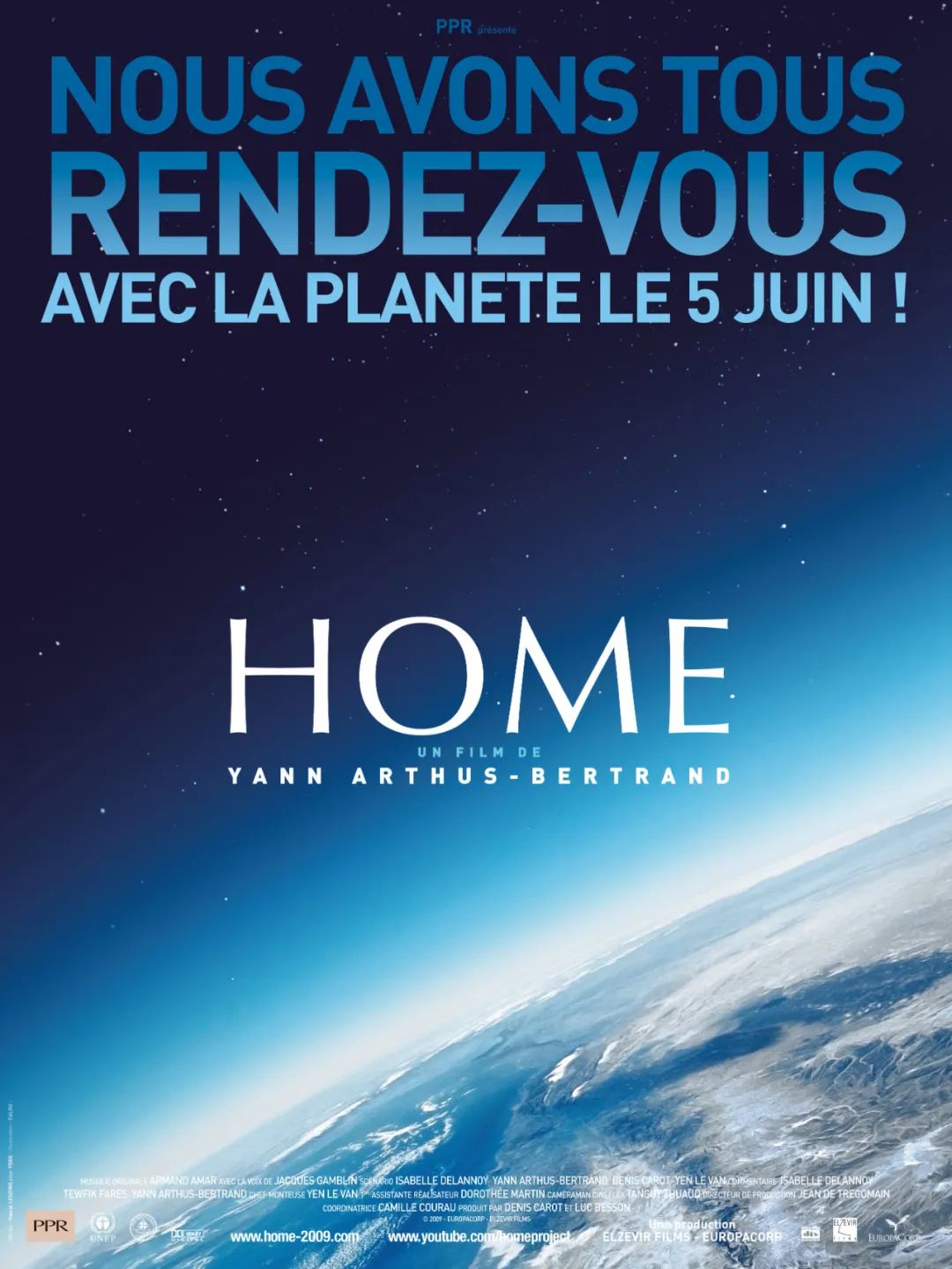
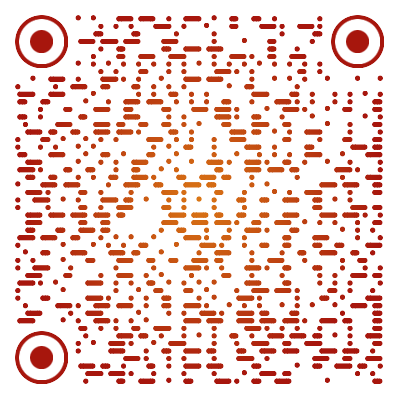
//////////////////
Le concours de la chanson française du Nouvel An vous
attend !
La finale du concours de la chanson francophone 2022 vient à peine d'avoir lieu que le Mois de la francophonie revient déjà pour sa nouvelle édition de 2023 ! Le réseau des Alliances Françaises de Chine, en collaboration avec l'Institut français de Chine, l'ambassade de Suisse en Chine, les représentations du Québec en Chine et Wallonie-Bruxelles International, est heureux de vous annoncer le lancement du concours 2023 de la chanson francophone, ouvert à toute personne d'au moins 18 ans sachant se présenter en français.
Informations
ccf@afchine.org
Découvrez grâce aux codes QR ci-dessous
la liste de chansons et entraînez-vous.
Pour toute demande d'information,
veuillez nous contacter via l'adresse mail suivante :
ccf@afchine.org

Le 15 décembre 2022, Joan Valadou, consul général de France à Shanghai, a remis deux médailles dans l'ordre des Arts et Lettres à deux musiciens exceptionnels et qui ont apporté une importante contribution aux échanges culturels franco chinois.
Xu Zhong, directeur de l'Opéra de Shanghai et chef de l'orchestre de Suzhou, est élevé au rang d'officier dans l'ordre des Arts et Lettres. En 2003 et 2005, M Xu Zhong a assumé à deux reprises les fonctions de conseiller artistique pour la culture française à Shanghai dans le cadre années croisées culturelles franco-chinoises à Shanghai, et a également dirigé en France l'orchestre national de France, l'orchestre de Lille, l'orchestre national de Paris et d'autres ensembles de renom. En reconnaissance de son rôle actif dans les échanges culturels franco-chinois, M Xu Zhong avait été fait en 2010 chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres par le Président Giscard d'Estaing, qui l'avait qualifié alors de "meilleur interprète de la musique française en Chine".
Le violoniste français Guillaume Molko s'est vu remettre les insignes de chevalier dans l'ordre des Arts et Lettres. Guillaume Molko s'est établi à Shanghai en 2013, où il a exercé comme supersoliste de l'orchestre symphonique de Shanghai, ainsi que soliste invité de l'orchestre philharmonique de Shanghai, l'orchestre symphonique du Zhejiang et professeur de violon du conservatoire de l'université de Suzhou. C'est en reconnaissance de sa contribution importante aux échanges musicaux franco chinois que M Molko s'est vu décerner au consulat de France cette importante distinction.
Créé en 1957, l'ordre des Arts et Lettres, qui comprend les grades de chevalier, officier et commandeur, est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde.
Après 3 ans de déplacements fortement limités, ce début d’année 2023 s’ouvre sur le retour à la vie normale et la reprise des voyages !
Nous qui sommes restés loin de nos familles depuis si longtemps et qui avons envie d'ailleurs, nous pouvons enfin prendre la route et retrouver les gens qui nous tiennent à cœur, revoir les paysages qui nous ont manqué et nous réjouir des nouvelles aventures qui nous attendent au bout du chemin.
Pour accompagner les trajets du nouvel an chinois, Faguowenhua vous propose une playlist à écouter « Sur la route » ! (Playlist complète en fin d'article)

La chanson Le Sud, écrite, composée, interprétée et coproduite par Nino Ferrer, est le dernier et le plus grand succès de sa carrière. Dès sa sortie au printemps 1975, elle se classe numéro un des ventes en France durant deux semaines et le disque 45 tours s’écoulé ensuite à 1 000 000 d'exemplaires.
Le sud
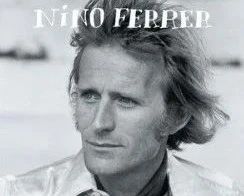
La mer est LA destination privilégiée pour les vacances. Le titre La Mer de Charles Trenet et son adaptation anglaise Beyond the Sea connaissent un succès international en 1946 au cours de la tournée de Charles Trenet en Amérique.
La Mer
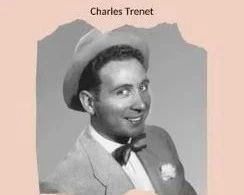
Polo & Pan et L’Impératrice représentent le meilleur son de la scène électronique française d’aujourd’hui. Que vous soyez dans le train, l’avion ou le bus, fermez les yeux et laissez-vous emporter par leur musique aux sonorités créatives, exotiques, imaginatives et colorées.
Plage isolée (soleil levant)
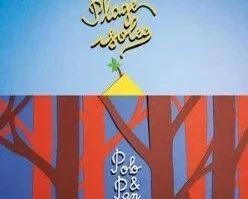
Agitations tropicales

Sous le ciel de Paris
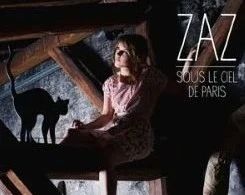
Pour finir, quelle que soit votre destination, comme le dit Jack Kerouac : « Mais qu’importe : la route c’est la vie. » Nous vous souhaitons un très bon voyage !

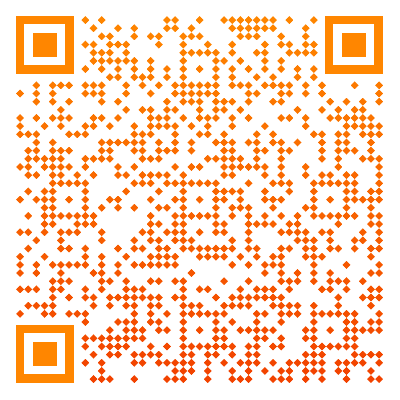
La soupe aux poireaux et aux pommes de terre de Marguerite Duras
 © Lin Yuan
© Lin Yuan
Si les festins de la famille des Jia font l’objet d’abondantes études chez les chercheurs du Rêve dans le pavillon rouge, la gastronomie dans la littérature française ne manque pas de faire saliver ses lecteurs. À tel point que la madeleine de Proust est entrée dans le langage courant pour évoquer tout objet qui rappelle un souvenir d’enfance !
Le potage de lotus de la concubine impériale ou le foetus de mouton cuit à la vapeur et au lait des Jia peuvent peut-être paraître compliqués à reproduire. Ce n’est pas forcément le cas des plats mis à l’honneur par les écrivains français, dont certains sont très simples à cuisiner !
Dans Outside, recueil de plusieurs de ses articles, l’écrivaine Marguerite Duras décrit longuement la soupe aux poireaux et aux pommes de terre. Ce plat, tous les Français le connaissent, soit parce qu’il représente un doux souvenir de leur enfance, soit parce qu’il leur rappelle les affres de la cantine scolaire.
Pourquoi tant de souvenirs si différents à propos d’un plat si simple ? C’est que Marguerite Duras nous explique qu’« on croit savoir la faire, elle paraît si simple, et trop souvent on la néglige ». Prêtons donc à cette recette d’antan tout l’attention qu’elle mérite.

La soupe aux poireaux
Marguerite Duras
Traduit par Yuan Xiaoyi
« On croit savoir la faire, elle paraît si simple, et trop souvent on la néglige. Il faut qu’elle cuise entre quinze et vingt minutes et non pas deux heures – toutes les femmes françaises font trop cuire les légumes et les soupes. Et puis il vaut mieux mettre les poireaux lorsque les pommes de terre bouillent : la soupe restera verte et beaucoup plus parfumée. Et puis aussi il faut bien doser les poireaux : deux poireaux moyens suffisent pour un kilo de pommes de terre. Dans les restaurants cette soupe n’est jamais bonne : elle est toujours trop cuite (recuite), trop « longue », elle est triste, morne, et elle rejoint le fonds commun des « soupes de légumes » – il en faut – des restaurants provinciaux français. Non, on doit vouloir la faire et la faire avec soin, éviter de l’« oublier sur le feu » et qu’elle perde son identité. On la sert soit sans rien, soit avec du beurre frais ou de la crème fraîche. On peut aussi y ajouter des croûtons au moment de servir : on l’appellera alors d’un autre nom, on inventera lequel : de cette façon les enfants la mangeront plus volontiers que si on lui affuble le nom de soupe aux poireaux pommes de terre. Il faut du temps, des années, pour retrouver la saveur de cette soupe, imposée aux enfants sous divers prétextes (la soupe fait grandir, rend gentil, etc.). Rien, dans la cuisine française, ne rejoint la simplicité, la nécessité de la soupe aux poireaux. Elle a dû être inventée dans une contrée occidentale un soir d’hiver, par une femme encore jeune de la bourgeoisie locale qui, ce soir-là, tenait les sauces grasses en horreur – et plus encore sans doute – mais le savait-elle ? Le corps avale cette soupe avec bonheur. Aucune ambiguïté : ce n’est pas la garbure au lard, la soupe pour nourrir ou réchauffer, non, c’est la soupe maigre pour rafraîchir, le corps l’avale à grande lampées, s’en nettoie, s’en dépure, verdure première, les muscles s’en abreuvent. Dans les maisons son odeur se répand très vite, très fort, vulgaire comme le manger pauvre, le travail des femmes, le coucher des bêtes, le vomi des nouveau-nés. On peut ne vouloir rien faire et puis, faire ça, oui, cette soupe-là : entre ces deux vouloirs, une marge très étroite, toujours la même : suicide ».
Texte extrait de Outside © POL
Marguerite Duras
Marguerite Duras est née le 4 avril 1914 à Saigon (aujourd'hui, Ho Chi Minh-Ville). Militante, romancière, scénariste, réalisatrice, auteure de pièces de théâtre, Marguerite Duras fait partie des écrivains contemporains français les plus lus et les plus connus. En 1983, elle est honorée du Grand prix du théâtre de l’Académie française. Son roman L’Amant, couronné Prix Goncourt en 1984, a été vendu à des millions d’exemplaires et traduit dans une quarantaine de langues.
À paraître prochainement chez CITIC Press Corporation, quatre ouvrages de Marguerite Duras, dont les premières éditions en mandarin de C’est tout et Cahiers de la guerre et autres textes ainsi que les rééditions de Outside (Papiers d’un jour) et Le Monde extérieur (Outside II).

© CITIC Press Corporation
Molière fait son cinéma avec les projections de Tartuffe ou l’hypocrite et Le Misanthrope
En janvier, le Beijing International Theatre Center – Cao Yu Theatre poursuit les projections dédiées à Molière avec Le Tartuffe ou l’hypocrite et Le Misanthrope.
Après avoir projeté Le Malade Imaginaire et L’Avare en décembre, le Beijing International Theatre Center – Cao Yu Theatre poursuit les projections dédiées à Molière. S’associant à New Live, la salle diffusera Le Tartuffe ou l’hypocrite le 7 janvier et Le Misanthrope le 8 janvier. Ces deux pièces incontournables, écrites par le plus célèbre des dramaturges français et jouées par la Comédie-Française, seront diffusées sur le grand écran pour offrir une expérience théâtrale unique.

Ces projections clôturent la série de diffusions célébrant Molière à l’occasion de son 400e anniversaire. Né le 15 janvier 1622, Molière est sans doute l’une des plus grandes figures du théâtre français classique, engagé dans son art et dans la société de son temps. Ses œuvres ont été jouées par les plus grandes compagnies théâtrales et sont étudiées par de nombreux élèves dans le monde. Sa vie mouvementée, haute en couleurs et sa forte personnalité ont inspiré de nombreux dramaturges, metteurs en scènes et cinéastes.
Le Tartuffe ou l’hypocrite et Le Misanthrope constituent un portrait vibrant et critique des mœurs sociales et sont considérés comme un exemple de comédie classique dans l’histoire du théâtre mondial. À travers des mises en scène originales et contemporaines, la Comédie-Française, le plus ancien et renommé des théâtres nationaux en France, réinterprète ces pièces du XVIIe siècle pour les dévoiler au cinéma, en collaboration avec Pathé Live. L’occasion de découvrir des chefs-d’œuvre du théâtre autrement !

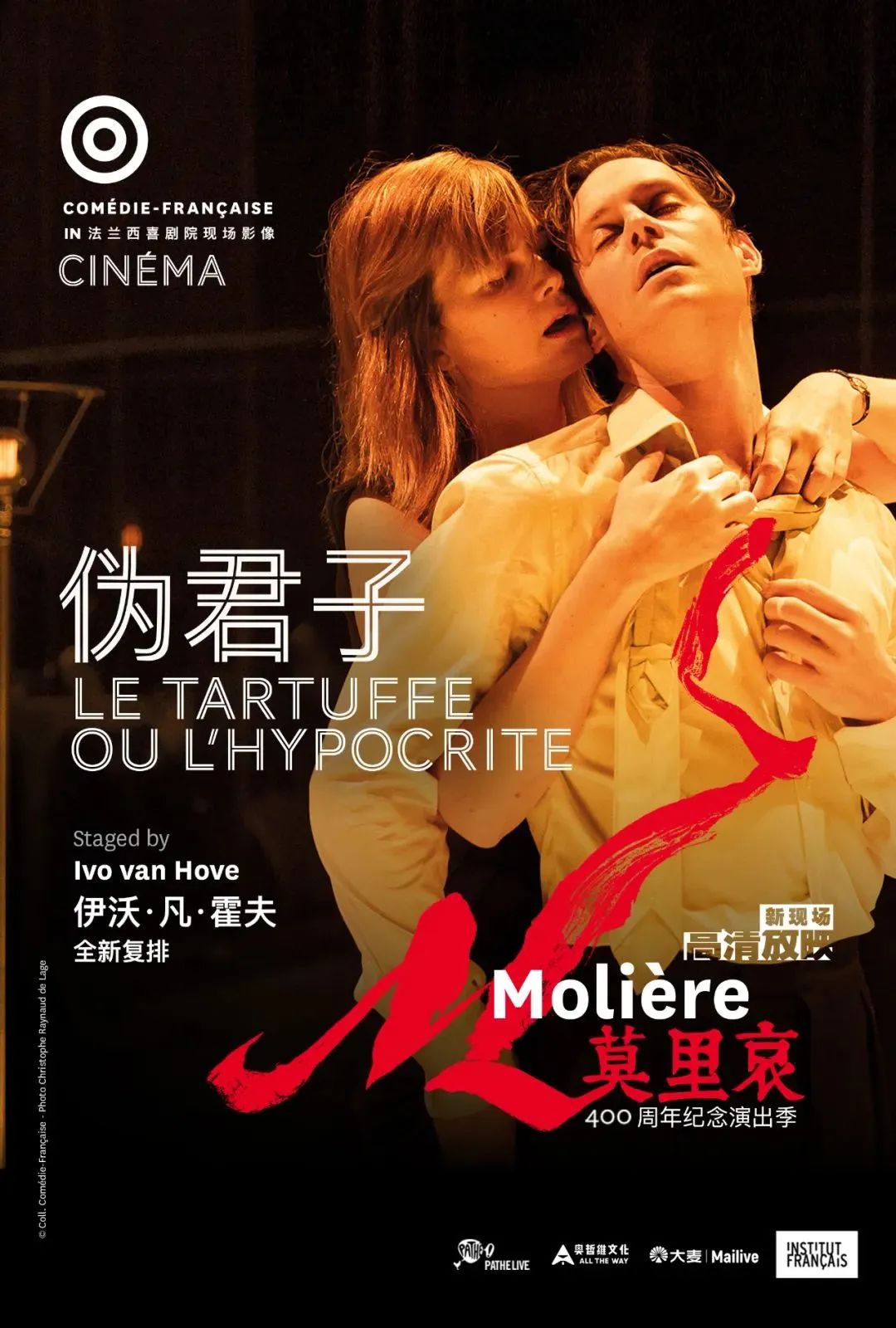
Le Tartuffe ou l'hypocrite
7 janvier 2023 (samedi) – 14:00
Beijing International Theatre Center – Cao Yu Theatre
Durée : 2h18 (sans entracte)
(dialogues en français/sous-titres en chinois)
Jouée et captée en 2022, Le Tartuffe ou l’hypocrite constitue l’une des œuvres les plus satiriques de Molière. Le spectacle surprend d’autant plus que le metteur en scène, Ivo van Hove, dévoile la première version de la pièce, censurée en 1664 par le roi au lendemain de sa première. En effet, le roi ne pouvait pas d’un côté se faire le héraut de l’orthodoxie catholique et de l’autre permettre à son comédien-auteur préféré de représenter sur son théâtre parisien une telle satire des dévots. La pièce que nous connaissons depuis, Le Tartuffe ou l’Imposteur, est une version modifiée en 1669. Dans sa quête de la perfection chrétienne, le riche Orgon a accueilli chez lui le pieux Tartuffe en tant que guide spirituel. Il voit en lui un véritable confident, un sauveur dont il en fait son unique héritier. Mais, l’hypocrite, incapable de résister à la tentation, s'éprend de la deuxième et jeune épouse d'Orgon. Cette version de la comédie de Molière se concentre sur la relation passionnelle de Tartuffe avec la jeune épouse d’Orgon, le conflit entre le père et le fils, ainsi que l’opposition entre une vision progressiste et libertine du monde portée par Cléante et celle, conservatrice, d’Orgon et sa mère.

Le Misanthrope
8 janvier 2023 (dimanche) – 14:00
Beijing International Theatre Center – Cao Yu Theatre
(dialogues en français/sous-titres en chinois)
Durée : 3h04 (dont un entracte de 10 minutes, à partir de la 99e minute)
Avec la captation du Misanthrope réalisée en 2017, le réalisateur Clément Hervieu-Léger réinterprète ce chef-d’œuvre de la comédie classique, dans lequel Molière s’attaque à la société du paraître et au monde de la cour. Alceste aime Célimène, une jeune femme mondaine éprise de liberté, mais rejette la société de bienséance à laquelle ils appartiennent. Hanté par un procès dont il redoute l’issue, Alceste se rend chez elle pour solliciter son aide... Le Misanthrope donne à voir une société libérée de l’emprise parentale et religieuse, dont le vernis social s’écaille lorsque surgit le désir. Poussés à bout par la radicalité d’Alceste, prêt à renoncer à toute forme de mondanité, les personnages dévoilent, le temps d’une journée, les contradictions du genre humain soumis à un cœur que la raison ne connaît point. Avec un regard nouveau, Clément Hervieu-Léger cherche à enraciner les personnages dans le présent tout en faisant vivre les dilemmes sociaux de l’époque. Loïc Corbery, acteur célèbre de la scène théâtrale française contemporaine, incarne Alceste.
Téléphone :6525 0996
Site :www.bjry.com
Scannez le code QR ci-dessous pour acheter les billets.

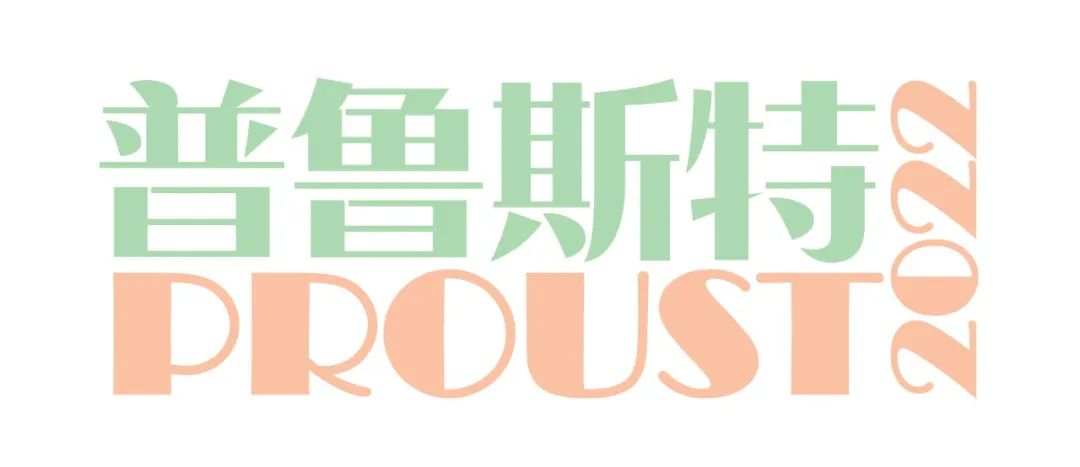
Ancien rédacteur en chef de la revue Shijie Wenxue (Littératures du Monde), Yu Zhongxian est traducteur littéraire, professeur et directeur de thèse à l’Académie des sciences sociales de Chine, membre permanent du jury pour le Prix Fu Lei. Nommé Chevalier des Arts et des Lettres en 2002, il a par ailleurs été lauréat du Prix Lu Xun 2018 dans la catégorie « Traduction littéraire ».
Yu Zhongxian a accepté d’être notre invité spécial en décembre pour répondre au questionnaire de Proust. Voici ses réponses :
1. Le principal trait de mon caractère......
La tolérance et la persévérance.
2. La qualité que je préfère chez un homme......
L’honnêteté et le courage.
3. La qualité que je préfère chez une femme......
La douceur et la compréhension.
4. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis......
Qu’ils me disent la vérité.
5. Mon principal défaut......
Ne pas savoir dire non.
6. Mon occupation préférée......
La traduction littéraire.
7. Mon rêve de bonheur......
Un rêve dont je me souviens quand je me réveille.
8. Quel serait mon plus grand malheur......
Avoir une maladie incurable.
9. Ce que je voudrais être......
Le meilleur moi possible.
10. Le pays où je désirerais vivre......
Difficile à dire, peut-être le sud de la France, en Provence, ou bien à Barcelone.
11. La couleur que je préfère......
Le bleu, le bleu du ciel comme le bleu de la mer, le bleu clair comme le bleu foncé.
12. La fleur que j’aime......
Le narcisse, j’en plante tous les ans.
13. L'oiseau que je préfère......
Le cygne. J'ai lu ce que Buffon écrit sur le cygne, et j'ai adoré.
14. Mes auteurs favoris en prose......
Jean Echenoz.
15. Mes poètes préférés......
Andrea Chénier.
16. Mes héros dans la fiction......
Jean Valjean dans Les Misérables.
17. Mes héroïnes favorites dans la fiction......
Je n'arrive pas à dire, peut-être que je n'en ai pas.
18. Mes compositeurs préférés......
Johannes Brahms.
19. Mes peintres favoris......
Marc Chagall.
20. Mes héros dans la vie réelle......
Henry Norman Bethune, le médecin canadien.
21. Mes héroïnes dans l’histoire......
Jeanne d'Arc, la campagnarde française.
22. Mes noms favoris......
Julien pour un garçon, Véronique pour une fille.
23. Ce que je déteste par-dessus tout......
L'hypocrisie.
24. Caractères historiques que je méprise le plus......
Yuan Shikai, il est le vrai usurpateur du pays.
25. Le fait militaire que j'admire le plus......
Le débarquement des Alliés sur les côtes normandes, connu comme le "jour le plus long".
26. La réforme que j'estime le plus......
La réforme en Chine depuis 1978, j’y ai moi-même participé et en ai bénéficié.
27. Le don de la nature que je voudrais avoir......
Une mémoire extraordinaire.
28. Comment j'aimerais mourir......
Sans douleur.
29. État présent de mon esprit......
J’ai la Covid et je voudrais me rétablir.
30. Fautes qui m'inspirent le plus d’indulgence......
Les fautes de calcul, tellement évidentes qu'on les repère au premier coup d'œil.
31. Ma devise......
Nulla dies sine linea. (Pas de jour sans une seule ligne.)
La Comédie-Française s’invite au Beijing International Theatre Center à travers les projections du Malade Imaginaire et de L’Avare de Molière

Soyez aux premières loges pour découvrir le meilleur du théâtre français !
Le Beijing International Theatre Center – Cao Yu Theatre rouvre ses portes et s’associe à New Live pour présenter des projections de pièces incontournables de Molière. Rendez-vous les 23 et 24 décembre pour visionner les représentations du Malade Imaginaire et de L’Avare sur grand écran.
Ces projections s’inscrivent dans la célébration du 400e anniversaire de la naissance du célèbre comédien et dramaturge français. Né le 15 janvier 1622, Molière est sans doute l’une des plus grandes figures du théâtre français classique. Il incarne l’homme de théâtre, engagé dans son art et dans la société de son temps. Ses pièces ont été jouées dans le monde entier par les plus grandes compagnies théâtrales et sont étudiées par de nombreux élèves. Son œuvre, composée d’une trentaine de comédies, fait de lui l’un des écrivains les plus importants de la littérature et du théâtre français du XVIIe siècle.
À travers la réinterprétation par la Comédie-Française de ses pièces, le public pourra découvrir des personnages comiques et des histoires insolites qui forment un portrait satirique de la société française de l’époque et qui résonnent avec des réalités plus contemporaines.

Ces pièces ont été jouées et réinterprétées par les comédiens de la Comédie-Française, le plus ancien et renommé des théâtres nationaux en France. En collaboration avec Pathé Live, la Comédie-Française s’invite au cinéma pour offrir une manière unique de découvrir et de vivre deux chefs-d’œuvre du théâtre.

23 décembre 2022 (vendredi) 19:00
Beijing International Theatre Center - Cao Yu Theatre
Tarif: 120 rmb
Tarif étudiant : 60 yuan (sur présentation de la carte étudiante)
136 minutes sans entracte
* Projection en haute définition
* En français sous-titré en chinois
Le Malade Imaginaire nous plonge dans l’histoire d’Argan, un hypocondriaque et père tyrannique qui souhaite marier sa fille, Angélique, à un médecin complètement ridicule nommé Thomas Diafoirus. Toutefois, Angélique est amoureuse d'un autre homme, Cléante. En parallèle, Béline, la seconde femme d’Argan a pour objectif de voler la fortune de son mari et tente de saboter le mariage du jeune couple. Mis en scène par Claude Stratz, avec les comédiens Alain Lenglet, Guillaume Gallienne et Catherine Sauval, cette pièce en trois actes est la dernière œuvre de Molière, mais aussi sa plus belle comédie satirique.

24 décembre 2022 (samedi) 14:00
Beijing International Theatre Center - Cao Yu Theatre
Tarif: 120 rmb
Tarif étudiant : 60 yuan (sur présentation de la carte étudiante)
142 minutes sans entracte
* Projection en haute définition
* En français sous-titré en chinois
Dans L’Avare, Molière offre le portrait d’un avare devenu connu : Harpagon. Homme à la fortune pourtant assurée, sa vie n’est que calcul pour prévenir la moindre dépense et paranoïa, tant sa peur d’être volé est grande. Il projette de marier sa fille, Elise, sans dot, à un riche marchand et son fils, Cléante, à une riche veuve. Lui-même veuf depuis peu, il convoite la jeune Marianne. Mais ces machinations ne sont pas au goût des jeunes gens qui ont chacun une personne chère à leur cœur. Dans son adaptation, la metteuse en scène Lilo Baur décide de rapprocher la pièce de notre époque en la situant dans la période d’après-guerre, où l’émancipation féminine, parentale et sociétale est encore un horizon lointain. Les comédiens Alain Lenglet, François Gillard et Jérôme Pouly revisitent cette pièce pour en faire une véritable satire sociale, vibrante d’actualité.
En janvier 2023, pour poursuivre la découverte des classiques de Molière, les pièces Tartuffe ou l’hypocrite ainsi que Le Misanthrope seront diffusées.

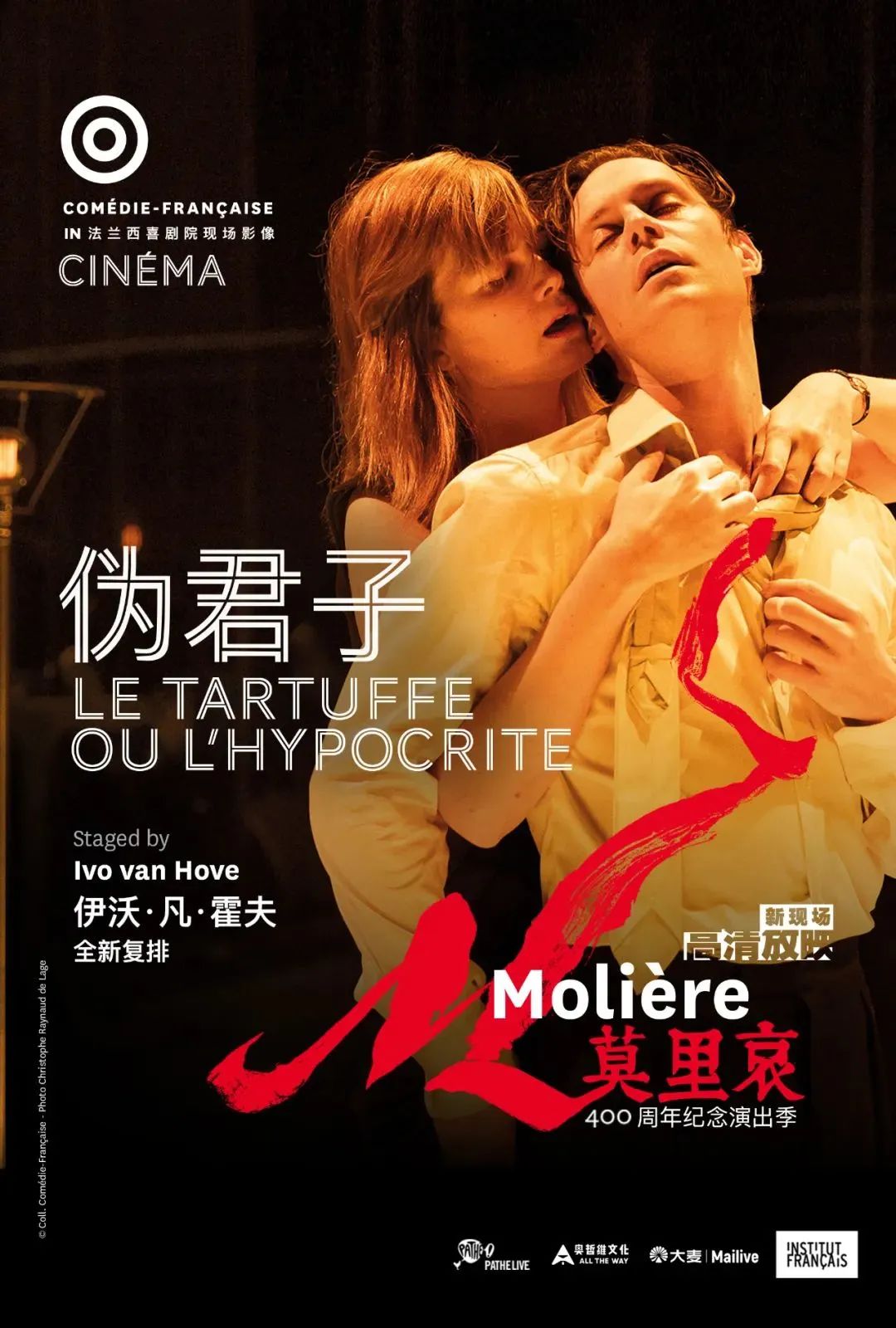
Téléphone :6525 0996
Site :www.bjry.com
Scannez le code QR ci-dessous pour acheter les billets.

Noël, c'est dans 2 jours ! Alors préparez la bûche et l'apéro (ou le chocolate chaud), lovez-vous dans le canapé à côté du sapin, et faites-vous plaisir, en famille ou entre amis, avec des films de Noël plein d'humour ou d'émotion. Faguowenhua vous propose une sélection de longs métrages français à voir ou revoir pendant les fêtes de fin d'année.

C'est parti!
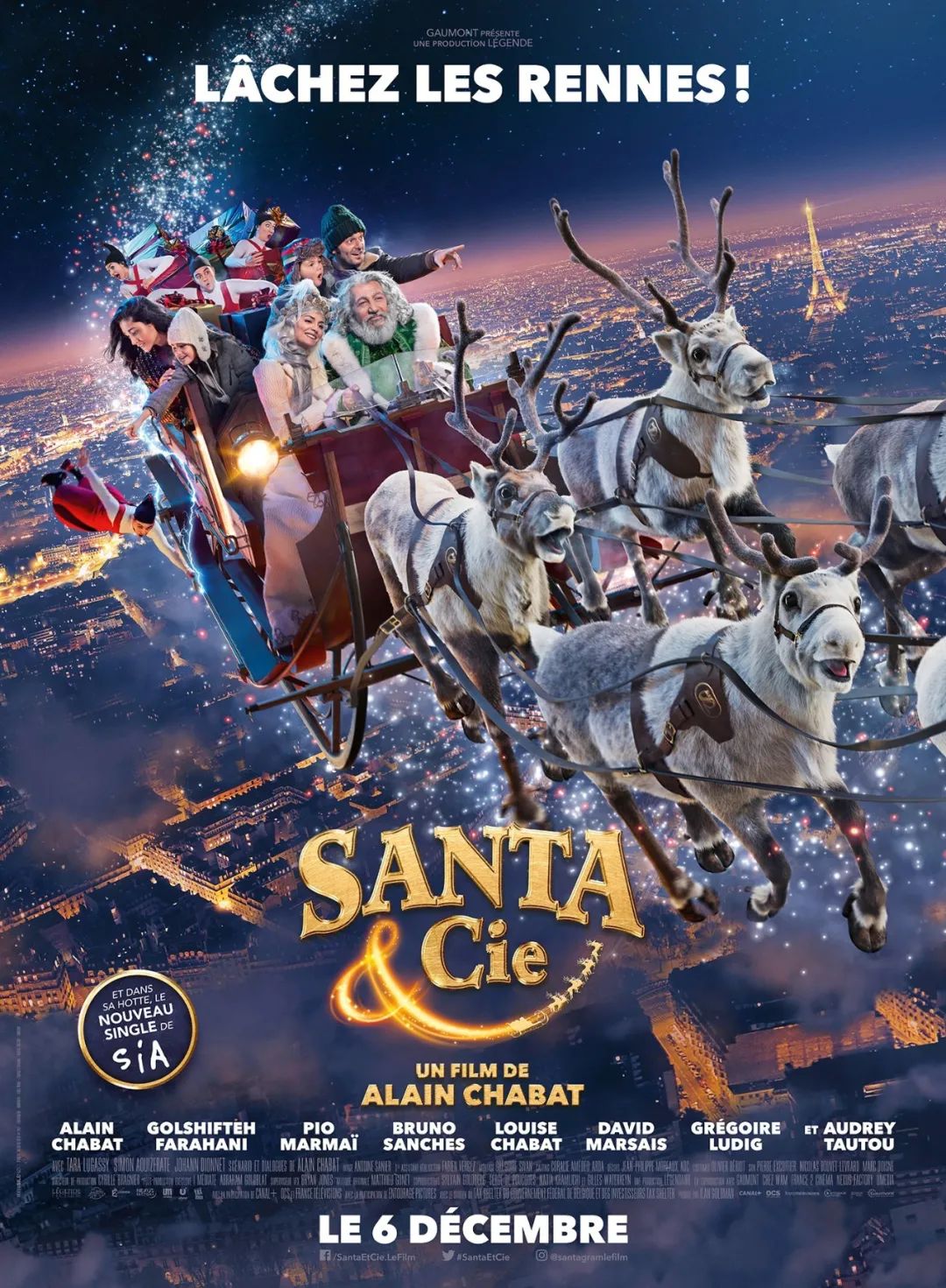
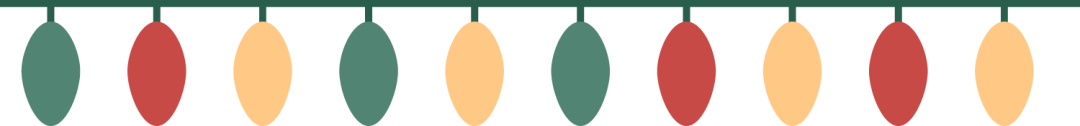
Disponible sur Tencent Video
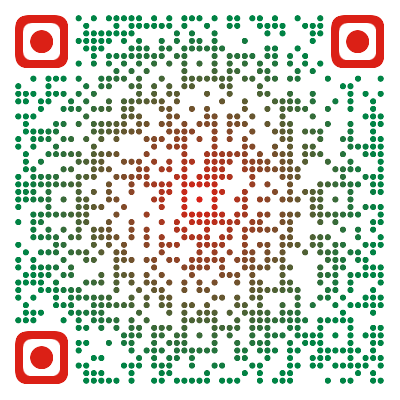

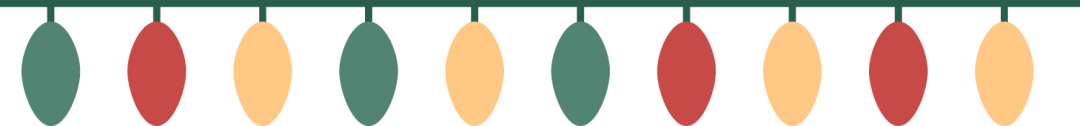
Disponible sur Tencent Video
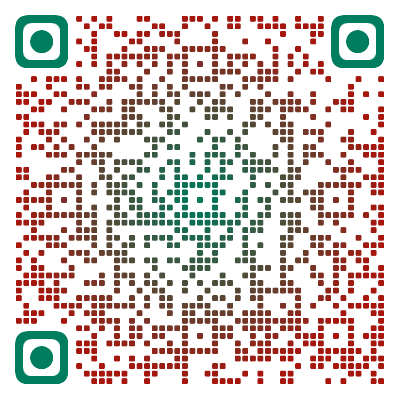
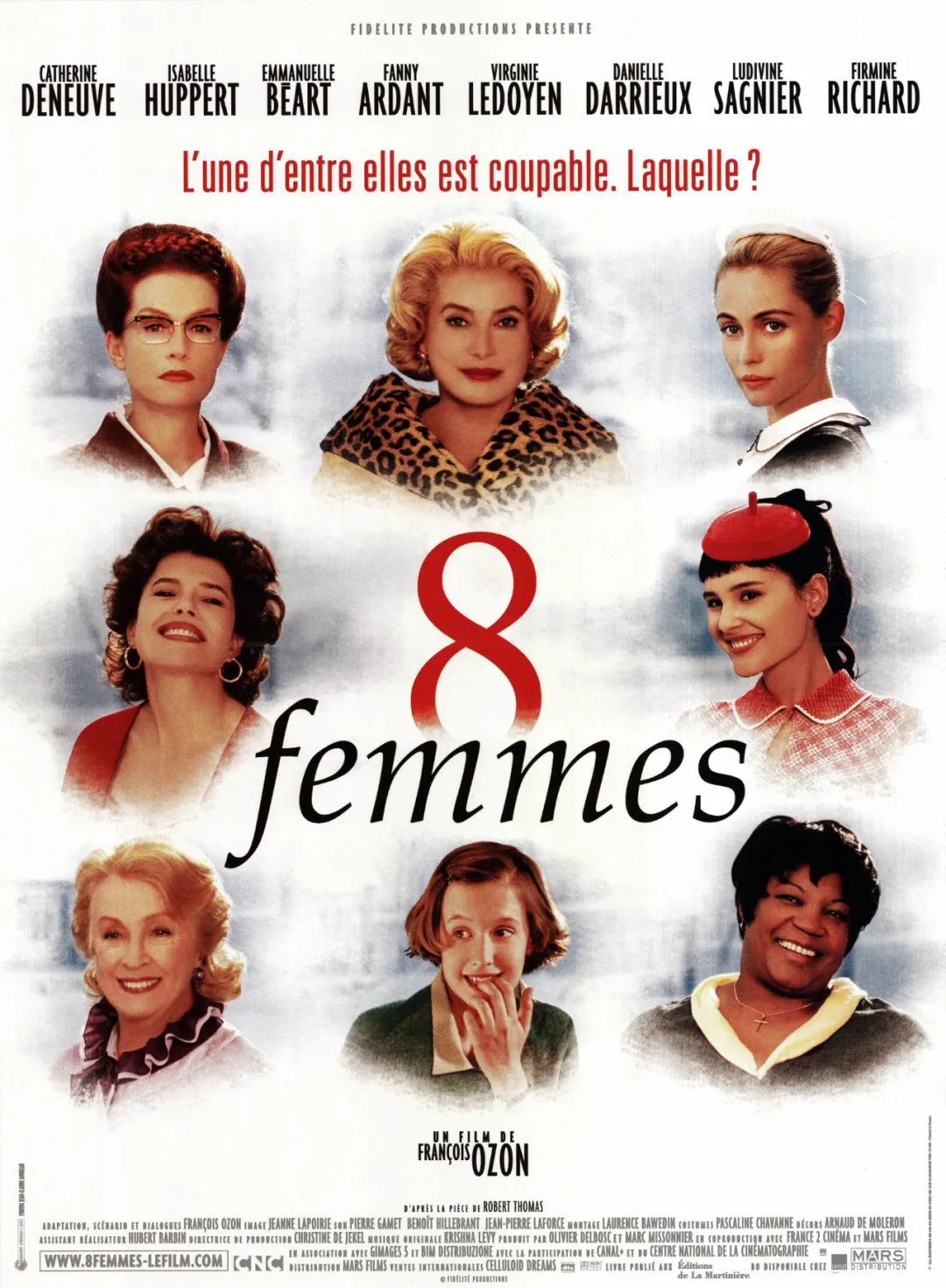
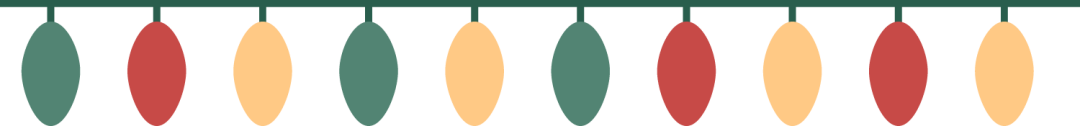
Disponible sur Tencent Video

Petit Papa Noel music: Celine Dion - Celine Dion Chante Noel
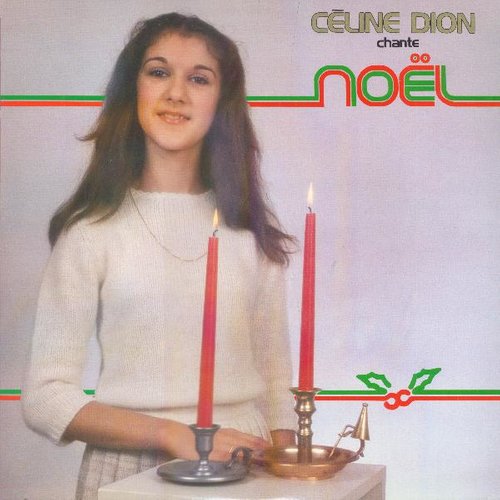
Noël a Paris music: Charles Aznavour - Joyeux Noël 2021
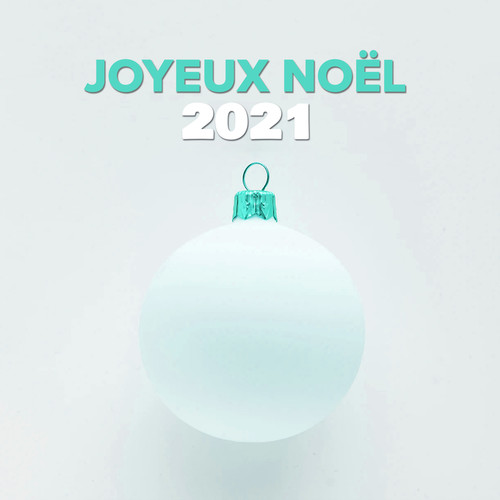
Pour répondre à l'engouement des chansons de Noël en France, la jeune scène musicale française a adapté à sa manière non seulement des chansons traditionnelles mais aussi des tubes anglo-saxons planétaires. En 2011, la maison de disque Barclay réunissait autour du compositeur Michel Legrand et d'un big band un casting comprenant Iggy Pop, Olivia Ruiz, Carla Bruni, Renan Luce ou -M-, pour l'album Noël ! Noël !! Noël !!! album FIRST NOEL en 2021, dans lequel il réinterprète 25 des plus grands classiques de Noël en plus de 3 titres inédits qu'il a composés comme un cadeau de Noël pour les fans de jazz. De quoi passer un moment relaxant dans son uneutete Boisson chaude entre les mains !
o Jolis Sapins music: Carla Bruni - Noël ! Noël !! Noël !!!
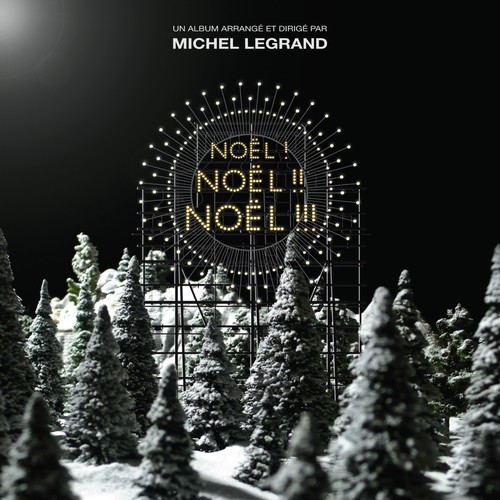
o Mon beau sapin music: Ibrahim Maalouf - First Noel



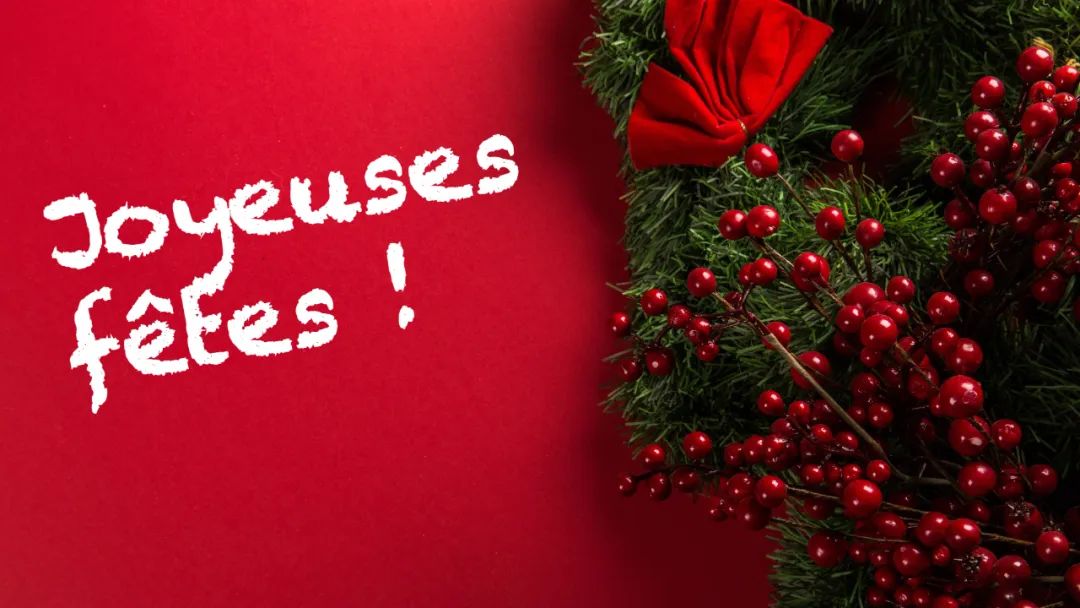
Les fêtes de fin d’année approchent et vous n’avez pas d’idées de cadeaux ? Voici qui devrait vous plaire !
Après le succès de la grande braderie de livres organisée dans le cadre du Mois franco-chinois de l’environnement, quelques livres injustement abandonnés sur nos rayons cherchent encore une nouvelle maison. Afin de prolonger cette initiative éco-responsable, l’Institut français de Pékin vous propose des pochettes surprises de livres bradés à offrir à vos proches.
La magie d’un cadeau est souvent associée à la surprise qu’il procure. On reçoit un beau paquet, bien emballé et coloré, mais dont le contenu reste secret. C’est dans cet esprit qu’a été pensé ce projet.
Chaque pochette comprend 3 livres de poche en français sur une même thématique (littérature, policier, essais, romans jeunesse), au tarif unique de 50 rmb. Il s’agit de livres bradés, dont la couverture peut être légèrement abîmée ou les pages un peu jaunies.
Pour réserver votre pochette surprise, choisissez votre thématique et contactez le club de lecture par courriel à arbreduvoyageur@institutfrancais-chine.com. Vous pourrez ensuite venir chercher votre paquet sur place ou vous le faire envoyer (frais de transport non inclus).
Dans la limite des stocks disponibles.
Coordonnées
arbreduvoyageur@institutfrancais-chine.com
(010) 6553 2627 ext.110
Institut français de Pékin, 18, Gongti Xilu, Chaoyang Qu, Pékin 100020
Du mardi au dimanche, de 14h00 à 18h00*
*horaires aménagés en raison de la situation sanitaire. Merci de votre compréhension.
Bravo à Julien Creuzet, qui représentera la France à la 60e Biennale di Venezia en 2024 !

Julien Creuzet © Virginie Ribaut
Julien Creuzet est un artiste plasticien, vidéaste, performeur et poète,âgé de 36 ans. Il a passé l'essentiel de son enfance en Martinique. Ces premières années dans les Caraïbes, au croisement de plusieurs influences culturelles, imprègnent une œuvre dans laquelle le mélange des imaginaires tient une place centrale. Passé par l’École supérieure d'arts & médias de Caen/Cherbourg et par l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, il est également diplômé, en 2013, du Fresnoy - Studio national des arts contemporains. Il enseigne aux Beaux-Arts de Paris.

Vue d'installation, Prix Marcel Duchamp 2021, Centre Pompidou, Paris, 2021 © High Art
Son travail abénéficié ces dernières années d’une importante visibilité grâce à de nombreuses expositions en France et à l’étranger. Il est par ailleurs lauréat du prix Étant donnés 2022, du prix BMW Art Journey 2021 et nominé du prix Marcel Duchamp 2021. Il est représenté par High Art (Paris), Andrew Kreps Gallery (New-York), Document (Chicago).

Vue de l'exposition Hiding behind the foliage. Search for Mygalia, Document Gallery, Chicago, 2017 © Document Gallery
Julien Creuzet s’intéresse aux questions de colonisation, de migration ainsi qu’à la manière dont ces dernières influencent les individus et leur identité. Explorant différents héritages culturels, il s’inspire du passé et du présent, de l’ici et de l’ailleurs, pour créer des histoires à la fois personnelles et universelles. Ses réflexions sur la créolisation se retrouvent dans la mixité et la diversité des pratiques qu’il utilise. Ses nouvelles œuvres trouveront, au Pavillon français de Venise, une résonance particulièrement importante avec les questions de notre temps.

Vue d'installation Orphée ruminait des mots à l'étouffée (...), LUMA Arles, 2022 © Victor Picon
La Biennale de Venise malgré son grand âge (créée en 1895) reste l’évènement mondial le plus important dédié à l’art contemporain. 800 000 visiteurs (fréquentation historique) ont eu l’occasion de découvrir l’édition 2022 lors de laquelle la France a reçu la mention spéciale du jury avec le projet de Zineb Sedira, Les rêves n’ont pas de titre.
Rendez-vous en mai 2024 pour découvrir le projet que Julien Creuzet imaginera et créera spécialement pour le Pavillon français.

Vue de l'exposition Les lumières affaiblies des étoiles lointaines (...), Palais de Tokyo, Paris, 2019 © Aurélien Mole

S’il a dû attendre ses 57 ans pour obtenir la consécration dans le domaine de la musique de chambre, César Franck a pourtant été un musicien extrêmement précoce. À l’occasion du bicentenaire de sa naissance (1822-1890), nous vous proposons de redécouvrir cette personnalité complexe et humble de grand talent.
Organiste et compositeur français d’origine belge, César Franck est l’un des musiciens les plus importants du XIXe siècle. Il est pourtant bien moins connu que ses contemporains, et occupe une place singulière dans l’histoire de la musique.
Né à Liège le 10 décembre 1822, César Franck grandit dans une famille modeste. La figure paternelle est déterminante dans la première partie de carrière du jeune César Franck. Son père, modeste employé de banque, ambitionne de faire du jeune César Auguste et de son frère Joseph, des musiciens virtuoses. Le modèle à suivre est Liszt.
Après quelques années d’études à l’Ecole royale de musique de Liège, la famille déménage à Paris dès 1835. César Franck suit alors les cours d’Anton Reicha (professeur de Berlioz, Liszt et Gounod) et de Pierre Zimmermann, avant d’intégrer le Conservatoire. Il y suit Zimmermann, pour les cours de piano, mais également les cours de fugue et de contrepoint d’Aimé Leborne. Et l’orgue dans la classe de Benoist.
Particulièrement brillant, le jeune élève révèle rapidement toute sa virtuosité. En 1838, il obtient un «grand prix d’honneur » de piano, puis un prix de fugue en 1840. Cette même année, il s’inscrit dans la classe d’orgue de François Benoist. Il reçoit le second prix d’orgue en 1841.
L’impatience paternelle empêche néanmoins le jeune homme d’aller au bout de ses études. Celui-ci, trop pressé de voir son prodige de fils donner des concerts, le pousse à quitter le Conservatoire en 1842 pour donner une tournée en Belgique et en Allemagne. Ce sera la seule de sa carrière. Le compositeur doit alors satisfaire aux goûts du père, donnant naissance à des morceaux d’une virtuosité technique évidente: Ballade, Fantaisie, Duos à quatre mains. Ce cadre contraint laisse néanmoins peu de place au jeune musicien de s’exprimer pour lui-même.
Ce sont dans ses œuvres écrites à l’insu de son père que se décèlele style Franck : les Trios (1839-1842) ou encore Ruth (1844-1845), églogue biblique pour soli, chœur et orchestre, qui sera son succès de jeunesse. Ces deux parenthèses dans la tutelle de son père laissent entrevoir la recherche formelle d’un musicien en quête de son style propre.
La véritable rupture n’adviendra qu’en 1846. Celui qui s’accommodait jusqu’alors de répondre aux ambitions d’un autre s’éprend d’une de ses élèves, Félicité Desmousseaux. Le père Franck refuse de consentir au mariage. Pour César Franck, ce sera le moment de l’émancipation: il quitte le domicile paternel, pour épouser Félicité en 1848.
Franck devient alors un simple professeur de musique, menant une vie modeste et besogneuse, privé du rôle d’impresario que jouait son père jusqu’alors. En 1847, il devient l’organiste à Notre-Dame de Lorette, puis à Saint-Jean-Saint-François du Marais, en 1851. Il est finalement nommé chef de chapelle à la basilique Sainte-Clotilde en 1857, avant de devenir titulaire du nouvel orgue Cavaillé-Coll, à 46 jeux, installé en 1859. Il occupera ce poste jusqu’à sa mort en 1890. Il devient par ailleurs, à 50 ans, professeur d’orgue au Conservatoire.
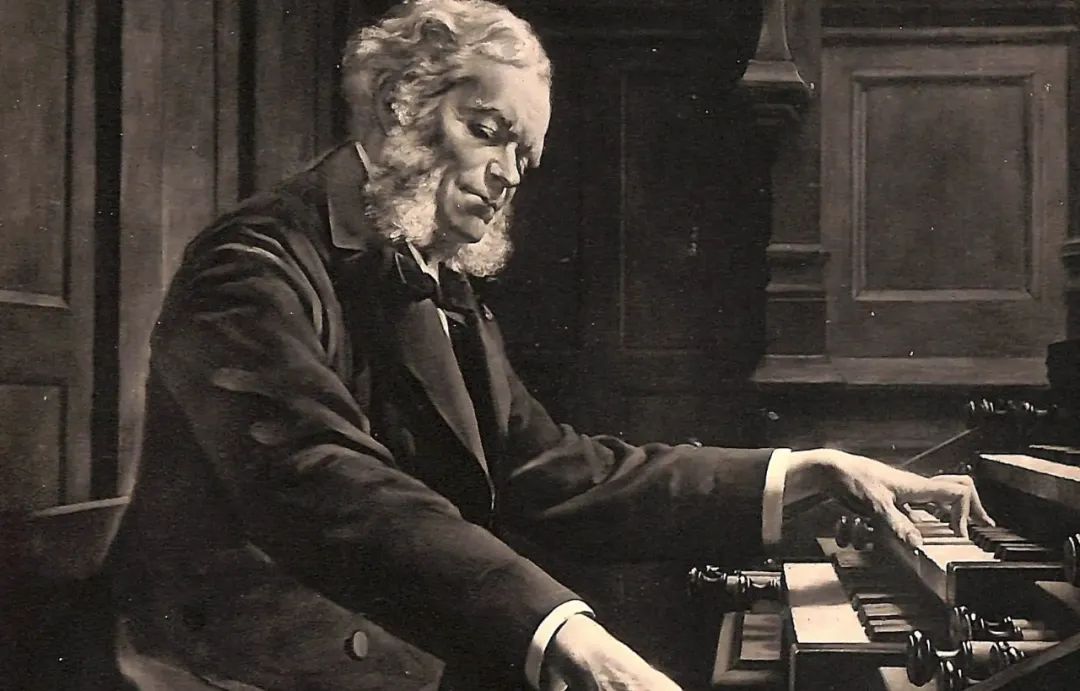
César Franck à l'orgue de Sainte-Clotilde, d'après une peinture originale de Jeanne Rongier
© Palazzetto Bru Zane/fonds Leduc
Réputé bon, humble et trop discret pour rechercher les honneurs et le succès, la vie de Franck reste entourée d’une aura singulière. Un véritable mythe s’est développé autour de lui, et notamment la légende du « Pater Seraphicus ». Franck fédéra effectivement autour de lui une jeune garde, qui dans un Paris fin-de-siècle teinté de symboliste, s’entendent comme des fils spirituels vénérant la mémoire de son maitre érigé en « Pater Seraphicus ». Insistant sur l’improvisation et l’écriture, sur l’expression de la beauté et du lyrisme plutôt que la technique, il forma en effet des artistes d’importance, tels Chausson, d’Indy, Duparc, Vierne, ou encore Guillaume Lekeu qui mirent un point d’honneur à défendre l’héritage de leur professeur.
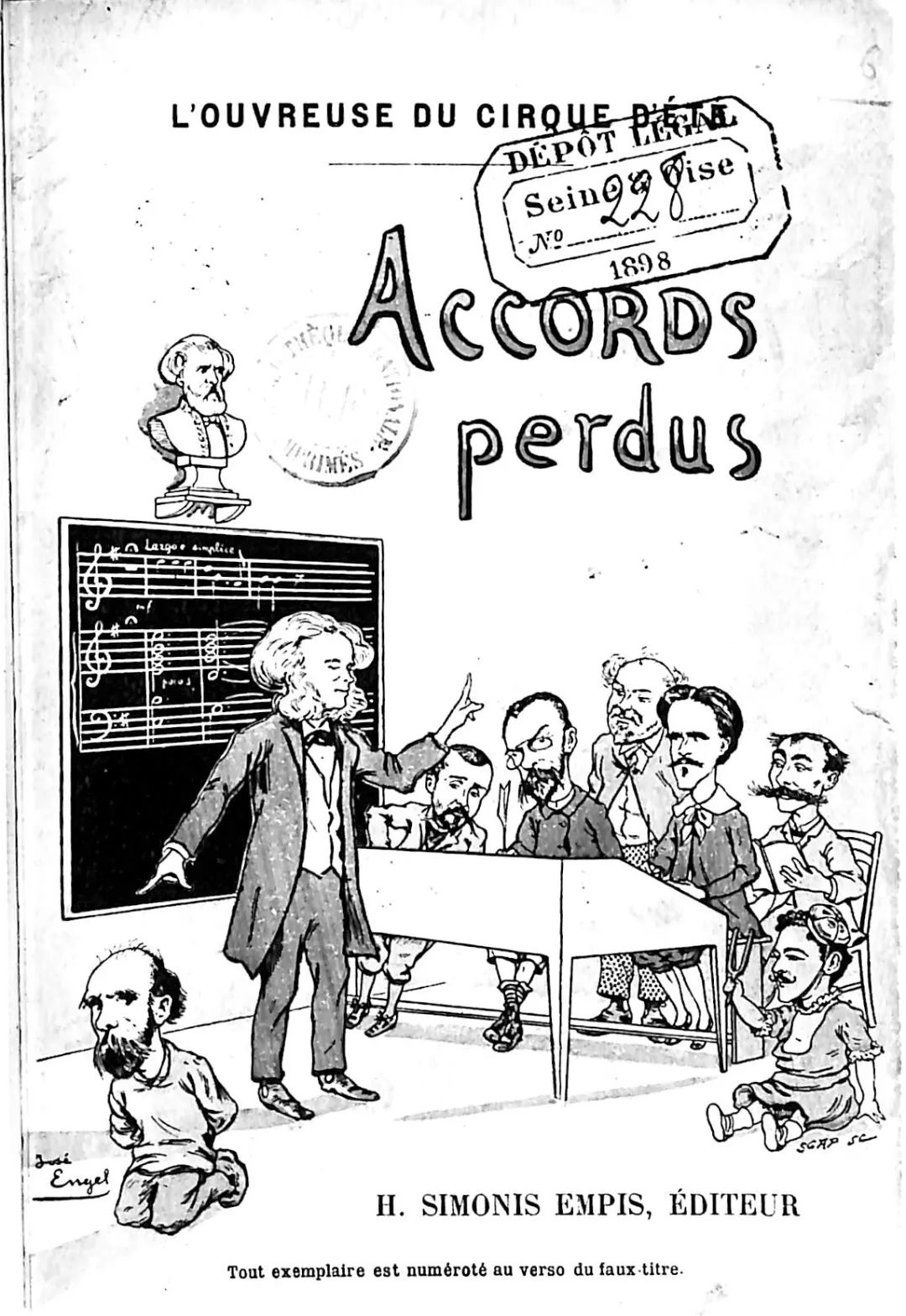
Une couverture d'ouvrage représentant César Franck et ses élèves. On y voit, de gauche à droite : E. Chausson (à genoux), Ch. Bordes, A. Bruneau, E. Chabrier, V. d'Indy, A. Messager, Pierre de Bréville. © Palazzetto Bru Zane/fonds Leduc
Le caractère modeste et effacé de Franck explique son succès tardif. Compositeur de génie, ce n’est qu’à la fin de sa carrière, loin de l’influence asphyxiante de son géniteur, qu’il produit la plupart de ses chefs-d’œuvre. Sa quintette avec piano et les Béatitudes (1879) annoncent ses grandes œuvres, que sont Prélude, choral et fugue pour piano (1884), Variations symphoniques pour piano et orchestre (1885), la Sonate pour piano et violon (1886), la Symphonie en ré mineur (1888) et ses Trois Chorals pour orgue (1890), écrits l’année de sa mort, et considéré comme son testament musical.
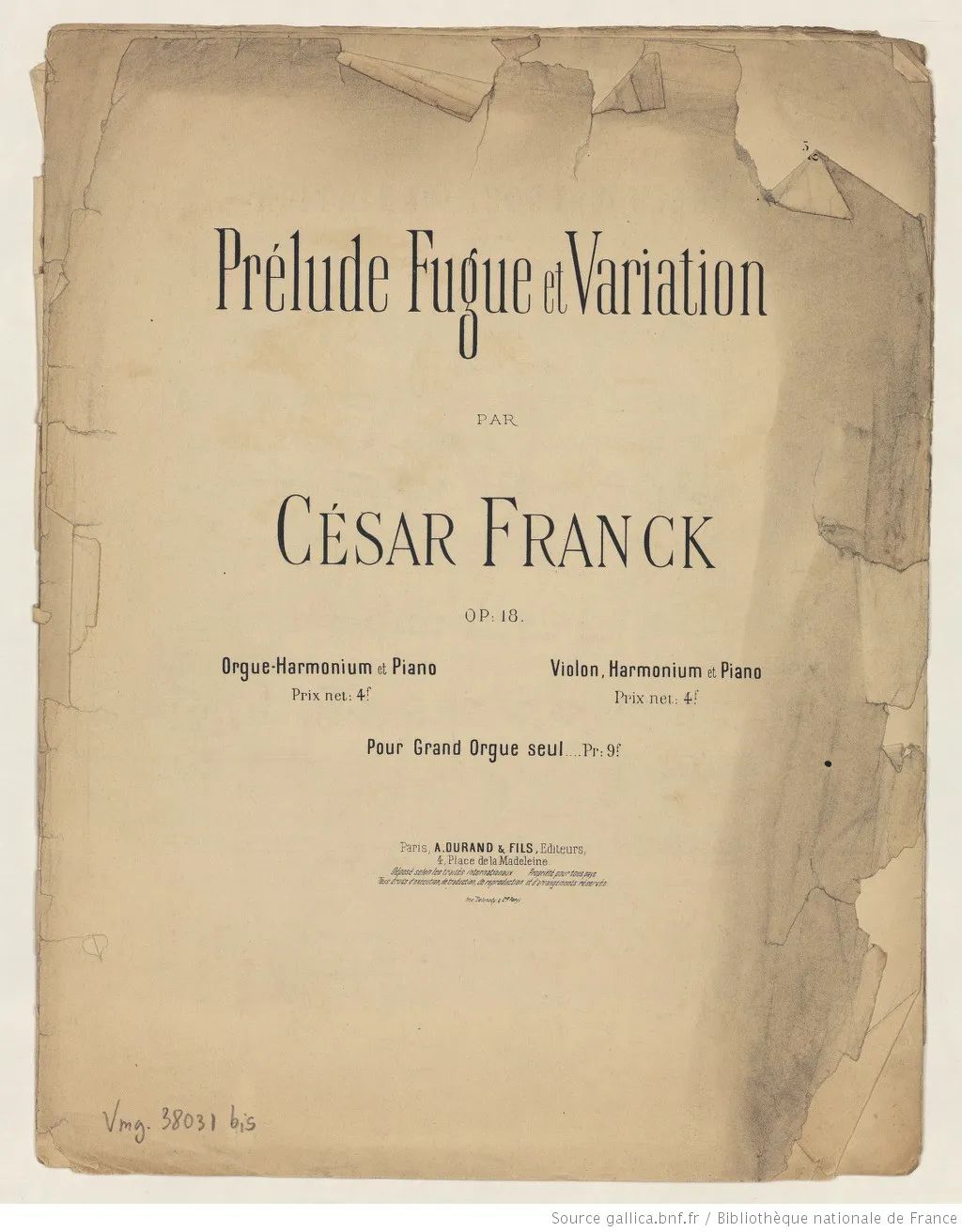
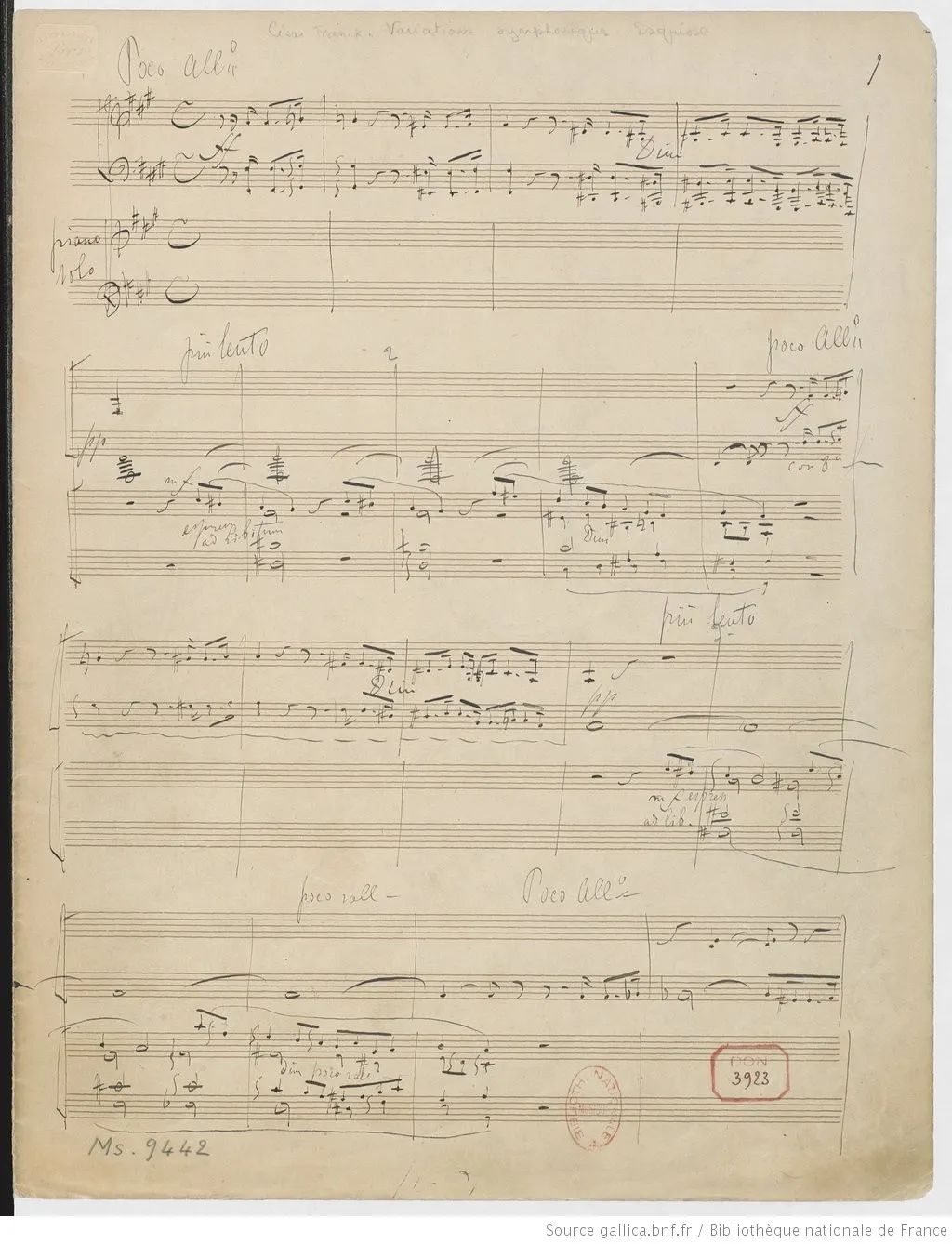
La page de titre des Préludes, Fugues et Variations et une esquisse autographe des Variations symphoniques © Gallica, Bibliothèque nationale de France
Musicien romantique, d’un lyrisme tumultueux, cheminant entre un Bach et un Beethoven, entre virtuosité technique et innovation, César Franck fut ainsi mis à l’honneur dans le cadre du focus que lui a consacré la 16e édition du festival Croisement, par une programmation audacieuse et singulière, à l’image du musicien qu’il fut.
César Franck fut également mis à l’honneur par une série de concerts menés en collaboration avec l’Institut Français, comme le concert exceptionnel de l’Orchestre du Guiyang, qui joua la Symphonie en ré mineur et deux œuvres écrites pour piano et orchestre, dirigé par le chef d’orchestre Zhang Guoyong et en collaboration avec le pianiste Song Siheng le 11 novembre dernier. Le pianiste et compositeur Zhang Shiyue interpréta également Prélude, Fugue et Variation op.18, FWV.30 le 11 septembre 2022.
Egalement programmé dans le cadre de Croissement 2022, le concert Choral No. 2 in B minor FWV 39 pour orgue – interprété par l’organiste Shenyuan associant une création de la danse contemporaine de la danseuse Wang Yabin interviendra en septembre 2023 et sera l’occasion de célébrer, encore une fois, un musicien singulier par une pièce audacieuse.
Hommage bien mérité pour un compositeur qui a marqué un tournant dans l’histoire de la musique.
La baguette est un élément vivant du patrimoine français. Sa mie crémeuse, ses alvéoles aériennes et irrégulières, sa croûte dorée et croustillante ont marqué des générations de gourmands, en France et au-delà.
Le 30 novembre 2022, le comité du patrimoine mondial de l’UNESCO a voté en faveur de l’introduction des savoir-faire artisanaux et de la culture de la baguette de pain de tradition française sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Longue de 40 à 70 centimètres, la baguette est réalisée à partir de quatre ingrédients seulement (farine, eau, sel, levure ou levain). Mais sa confection n’est pas si simple ! Il faut souvent aux boulangers des années de pratique pour trouver leur signature.
Les artisans boulangers sont les garants de la transmission de cette tradition. Ils effectuent un travail exigeant qui demande la maîtrise de gestes méticuleux. Leur savoir-faire est désormais protégé et reconnu par l’UNESCO.

Contrairement aux idées reçues, la baguette est un produit du XXe siècle, apparu en réponse à l’évolution de la demande urbaine. Les gens aisés en ville avaient besoin d’un pain frais plusieurs fois par jour et les grands pains traditionnels - entre 1 et 2 kilos - étaient simplement trop gros.
Malgré sa jeune histoire, la baguette s’est rapidement gravée dans la mémoire collective. Beaucoup de jeunes français font leurs dents en mordant dans un croûton. Et c’est l’un des premiers achats des enfants, à qui l’on donne quelques sous pour se rendre à la boulangerie.

La boulangerie est un lieu de parfums et de senteurs, qui s’inscrivent dans la mémoire collective dès le plus jeune âge. Le boulanger ou la boulangère est un visage familier et participe au maintien du lien social d’un quartier ou d’un village. Régulièrement voire quotidiennement, un membre de la famille va chercher la baguette, qui se mange fraîche.
C’est devenu une image emblématique de la France : des clients sortant d’une boulangerie baguette sous le bras, n’hésitant pas à la mordre à pleine dents lorsqu’elle est encore chaude. Elle est aussi un symbole de l’hospitalité française : c’est un pain de partage, qui se coupe, se transporte et se passe de main en main avec facilité.

Ce produit symbolique entre cette année sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité en même temps que les techniques traditionnelles de transformation du thé, présentées par la Chine. Vert, noir, jaune, sombre, blanc, aux fleurs ou oolong, le thé se décline en couleurs et saveurs diverses qui sont le fruit de savoir-faire centenaires. Il est omniprésent dans le quotidien des Chinois et permet d’échanger, de tisser des liens et de se rapprocher.
De la même manière, la baguette occupe une place centrale dans la culture française et est aussi un symbole de partage, de simplicité et d’échange. Nous nous réjouissons de l’entrée au patrimoine mondial de l’UNESCO de la baguette et du thé et félicitons les communautés chinoises et françaises qui ont œuvré pour ces inscriptions !

Ingrédients
375 g de farine de blé type 55
215 g d’eau
7 g de sel fin
5 g de levure sèche de boulange
Accessoires
Four
Saladier
Torchon
Couteau
Préparation
Je fais tiédir l’eau (environ 40°C).
Dans un saladier, je mélange la farine, le sel et la levure sèche. Je verse l’eau tiède et travaille l’ensemble pendant 5 minutes jusqu’à l’obtention d’une boule lisse.
Je recouvre le saladier d’un torchon et laisse reposer pendant 40 minutes à température ambiante, à l’abri des courants d’air.
Je travaille la pâte pour la dégazer puis la divise en 3 parts. Je roule chaque part en un cylindre, un peu plus long que les empreintes du moule à baguettes.
Je farine une plaque et je dispose les cylindres de pâte dessus. Je laisse reposer 20 minutes, à température ambiante, à l’abri des courants d’air. Je préchauffe le four à 250°C.
Je badigeonne le dessus des baguettes d’eau, en veillant à ce qu’il n’y ait pas d’eau entre la pâte et la plaque. Je fais des incisions assez profondes sur le dessus.
J’enfourne et cuis 25 minutes à 240°C.
Et voilà, vous aurez entre vos mains un morceau de patrimoine mondial bien croquant !
médiathèque
Consignes de sécurité
À l'entrée

Montrez votre HealthKit vert (le certificat négatif d’un test de moins de 48h n’est plus nécessaire).
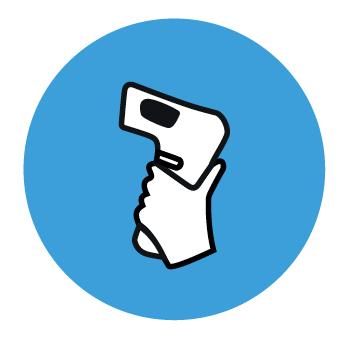
Acceptez la prise de température obligatoire.

Désinfectez vos mains.
À l'intérieur
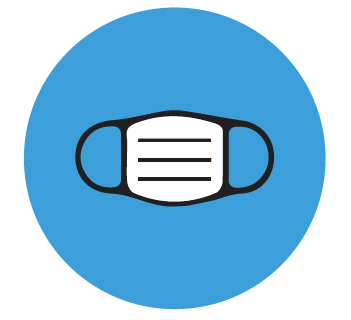
Portez toujours votre masque, couvrant la bouche et le nez. Le port du masque est obligatoire pendant toute la séance de cinéma.
À bientôt à l’Institut français de Pékin !
Prix dans la catégorie « Essai »
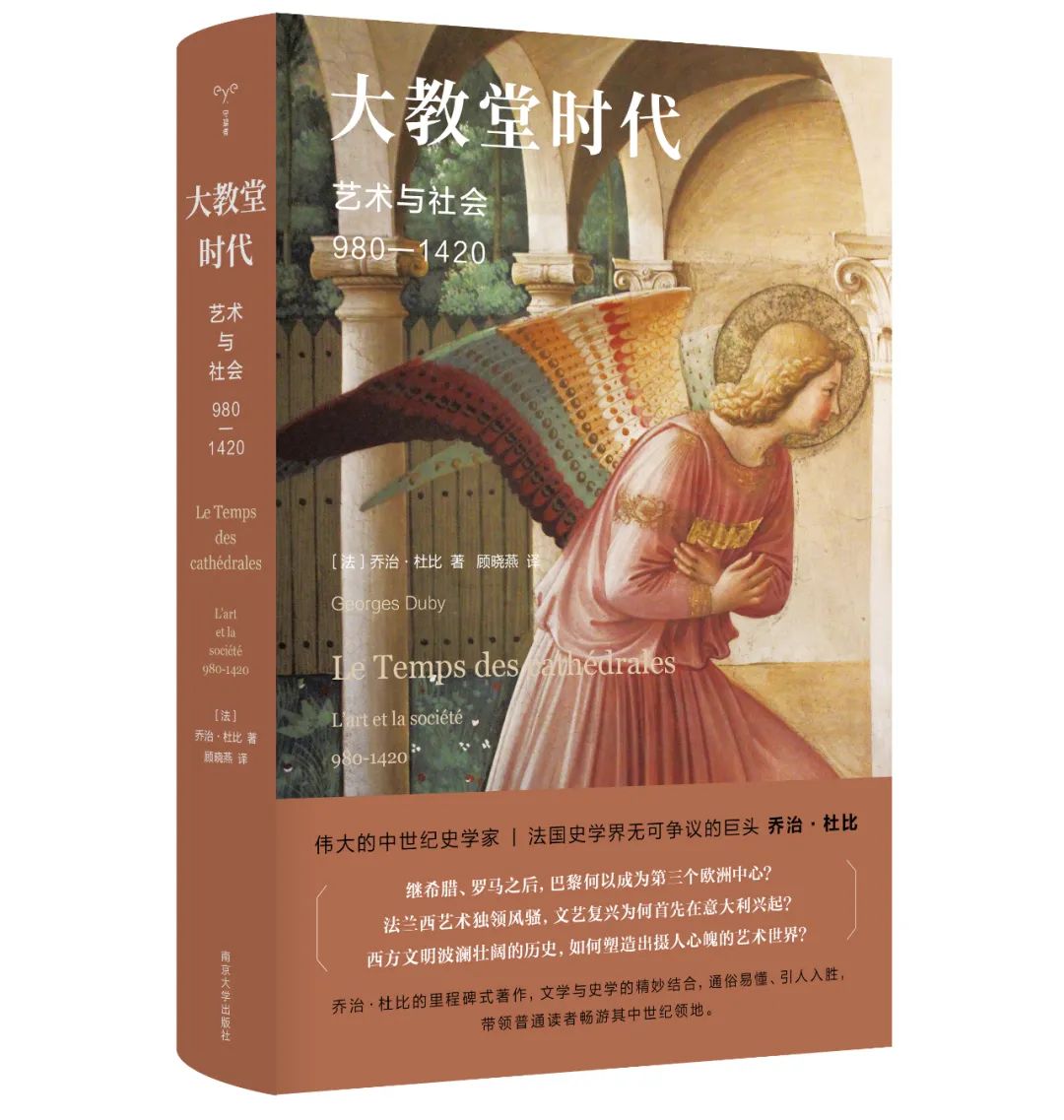
Le Temps des cathédrales. L’art et la société 980 – 1420 de Georges Duby
Traduit par Gu Xiaoyan
Nanjing University Press
Présentation de la traductrice
Docteure en traductologie et diplômée de l’Université de Nanjing, Gu Xiaoyan est professeure de français à l’Université d’économie et de finance de Nankin. Elle a été boursière du Centre National du Livre en tant que traductrice en 2013. Elle a dirigé plusieurs projets de recherches sur la traduction. Elle a traduit, entre autres, Le Dernier des Mozart de Jacques Tournier, Les Femmes de l’ombre de Laurent Vachaud, Clara. S. Les secrets d’une passion de Claude Samuel.
Le mot du jury
Le Temps des cathédrales. L’art et la société 980-1420 est un ouvrage important dans la tradition historiographique française. Sa valeur académique liée aux recherches de la culture médiévale est toujours reconnue aujourd’hui, tant par les spécialistes que par le grand public.
La traduction de Gu Xiaoyan rend fidèlement la pensée de Georges Duby, tout en gardant le style à la fois historique et littéraire du texte original. Elle a aussi effectué un travail pédagogique important à travers ses notes de traduction.
Prix dans la catégorie « Littérature »
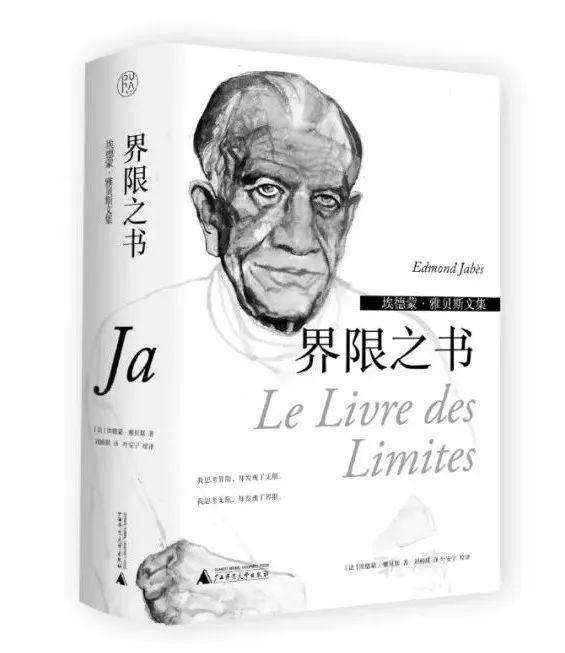
Le Livre des Limites d’Edmond Jabès
Traduit par Liu Nanqi
Guangxi Normal University Press Group
Présentation du traducteur
Né à Pékin, Liu Nanqi est diplomé de l’Université de Pékin (Faculté de Langue et Littérature française, Département de Langue et Littérature occidentales, 1982) et de l’University of International Business and Economics (Faculté de Droit, 2001). Attaché économique près l’Ambassade de Chine en Centrafrique dans les années 1980, il a été investi dans les affaires économiques et commerciales extérieures pendant de nombreuses années. Il est professeur invité et tuteur MBA depuis 2014 à l’University of International Business and Economics. Il est traducteur de Charles Baudelaire (Les Fleurs du mal, Le Spleen de Paris), de Francis Jammes (De l’Angélus de l’Aube à l’Angélus du soir, Le Deuil des Primevères), d’Edmond Jabès (Le Livre des Questions, Le Livre des Ressemblances, Le Livre des Limites, Un étranger avec, sous le bras, un livre de petit format, Je bâtis ma demeure) et de quelques essais poétiques d’Yves Bonnefoy. Il a été finaliste du Prix Fu Lei en 2021 pour sa traduction du Livre des Questions de Jabès.
Le mot du jury
Le Livre des Limites d’Edmond Jabès délivre les réflexions approfondies de l’écrivain sur le monde, la vie, la judaïcité, le soi, le discours, l’écriture. Ce texte au confluent des genres littéraires regorge d’images et de mots aux connotations très abstraites.
La traduction de Liu Nanqi transmet la mélodie et le rythme de ce poème en prose philosophique, avec une musique qui rend la beauté du texte. Il est également très précieux que Liu Nanqi ait traduit l’ensemble des œuvres de Jabès, durant des années, sans relâche.
Prix « Jeune pousse »
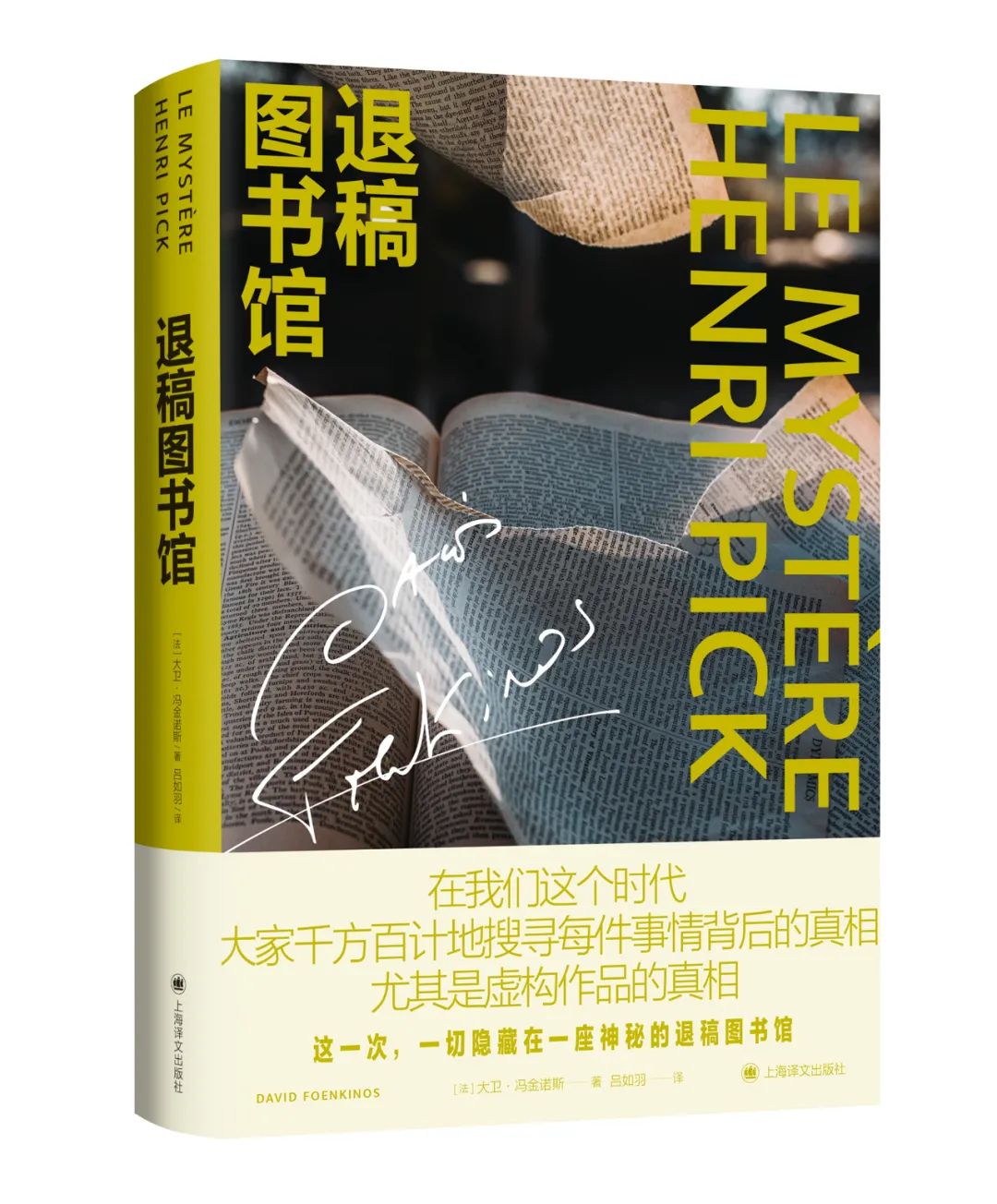
Le Mystère Henri Pick de David Foenkinos
Traduit par Lyu Ruyu
Shanghai Translation Publishing House
Présentation de la traductrice
Après avoir obtenu son doctorat du Département de français de l’Université de Pékin, Lyu Ruyu est maintenant maître de conférences au Département de français de l’Université Renmin de Chine. Traductrice depuis 2013, elle a déjà traduit trois romans de David Foenkinos : La Délicatesse, Charlotte et Le Mystère Henri Pick.
Le mot du jury
Le Mystère Henri Pick de David Foenkinos génère chez ses lecteurs un sentiment de joie, avec beaucoup de suspense et d’humour. Cette écriture apparemment nonchalante et légère provoque pourtant des émotions profondes et une réflexion sérieuse. La traduction de Lyu Ruyu rend formidablement bien le style captivant et humoristique de ce roman.


Miao Wei
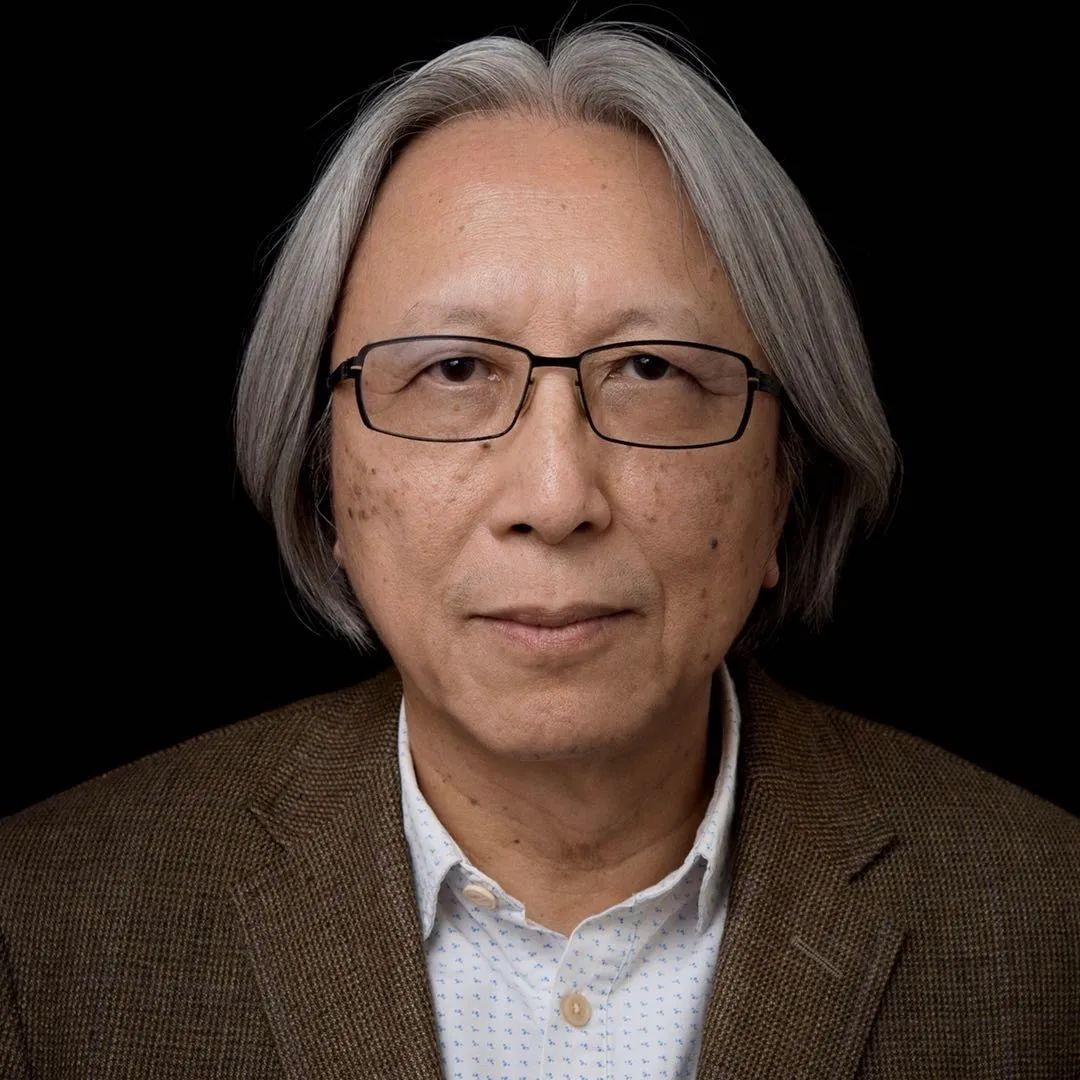
Chan Koonchung

Zhang Wen

Huang Yaqin

Dong Qiang

Yu Zhongxian

Duanmu Mei
Directrice d’études en Histoire de France et de Suisse à l’Institut d’histoire mondiale de l’Académie des sciences sociales de Chine. Mme Duanmu Mei est présidente d’honneur de la Société chinoise d’études de l’histoire de France (SCEHF). Elle a par ailleurs été nommée Officier de l’Ordre National du Mérite en 2011 et Chevalier de l’ordre des Palmes académiques en 2021.

Wang Kun
Titulaire d’un master ès Lettres en langue et littérature françaises (BFSU) et d’un master en sociologie (Sciences Po Paris), Wang Kun est directeur adjoint de la Faculté d’études françaises et francophones de l’Université des Langues étrangères de Beijing et traducteur d’ouvrages en sciences sociales. Il a été nommé Chevalier des Arts et des Lettres en 2019.

Guillaume Olive
Lors de ses études de sinologie à l’École pratique des Hautes Etudes, Guillaume Olive s’est spécialisé dans la poésie classique. Passionné par le répertoire des récits populaires, il a publié de nombreux recueils de contes parmi lesquels Contes de Mandchourie à L’école des loisirs, Contes des peuples de Chine (récemment réédité aux éditions des éléphants), Dix contes de Chine et La Chine en 12 récits chez Flammarion. Il a également adapté en français les grandes poésies de l’époque des Tang (Poèmes de Chine aux éditions du Seuil).

Caroline Puel

Julien Portier
Comme chaque année, le Prix Fu Lei est organisé avec le concours précieux de nos sponsors.

{"preview_thumbnail":"/wp-content/uploads/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/XNTkyNTMxNjQyNA%3D%3D.jpg?itok=liPT44wC","video_url":"https://v.youku.com/v_show/id_XNTkyNTMxNjQyNA==.html","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":1},"settings_summary":["Embedded Video (Adaptatif, autoplaying)."]}


Water System Refuge #3, 2022©CaoMinghao&Chen Jianjun
Avec ce projet comme point d’entrée pour leur création artistique, Cao Minghao & Chen Jianjun mettent en œuvre des pratiques collaboratives, des installations, des images, des documents collectés et des ateliers. Ils mettent en évidence à la fois différentes réflexions sur les systèmes d’irrigation passés et futurs, des pratiques écologiques, des récits individuels et collectifs, des recherches sur une conscience écologique à l’œuvre.
{"preview_thumbnail":"/wp-content/uploads/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/XNTkyMzUwMTQ2MA%3D%3D.jpg?itok=tk577Etf","video_url":"https://v.youku.com/v_show/id_XNTkyMzUwMTQ2MA==.html","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":1},"settings_summary":["Embedded Video (Adaptatif, autoplaying)."]}
Adrien Missika

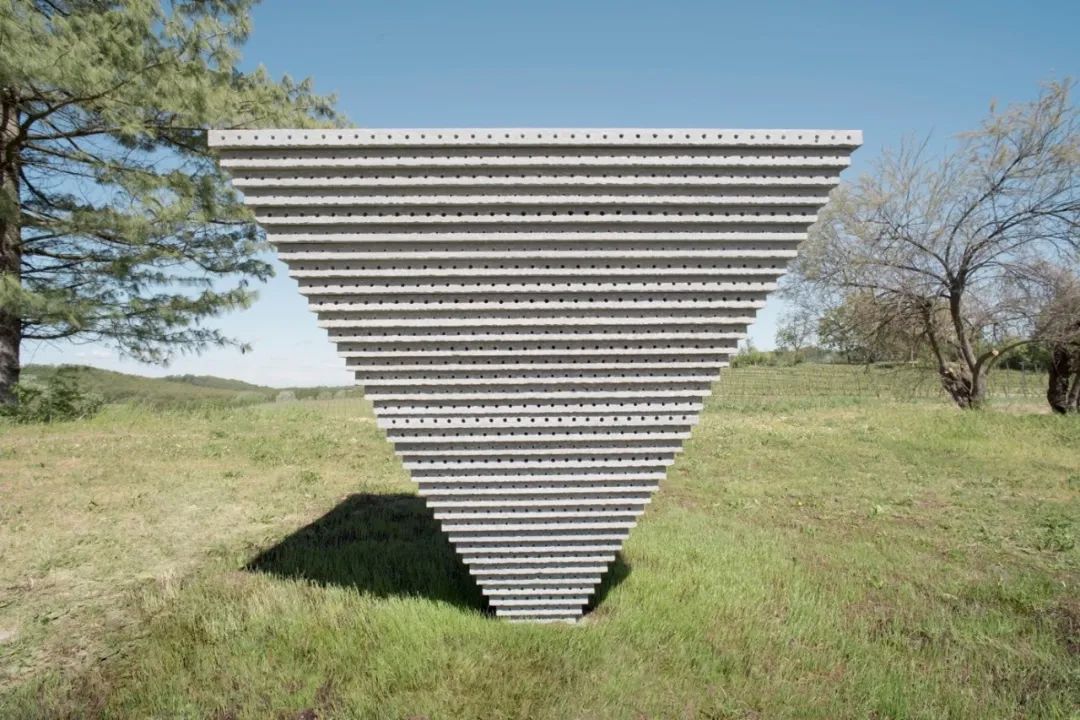
Palazzo delle © Adrien Missika
Depuis des années, Adrien Missika parcourt le monde et travaille sur les phénomènes naturels les plus curieux, pour dévoiler la nature, la mettre en scène, afin de la redécouvrir et de la réadapter au monde d’aujourd’hui. Il travaille également sur la manière dont la nature cherche en permanence à négocier sa présence dans nos architectures et villes contemporaines.
{"preview_thumbnail":"/wp-content/uploads/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/XNTkyNTMyMDgwNA%3D%3D.jpg?itok=zSNnQbo8","video_url":"https://v.youku.com/v_show/id_XNTkyNTMyMDgwNA==.html","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":1},"settings_summary":["Embedded Video (Adaptatif, autoplaying)."]}
Directrice, Inside-Out Art Museum, Beijing

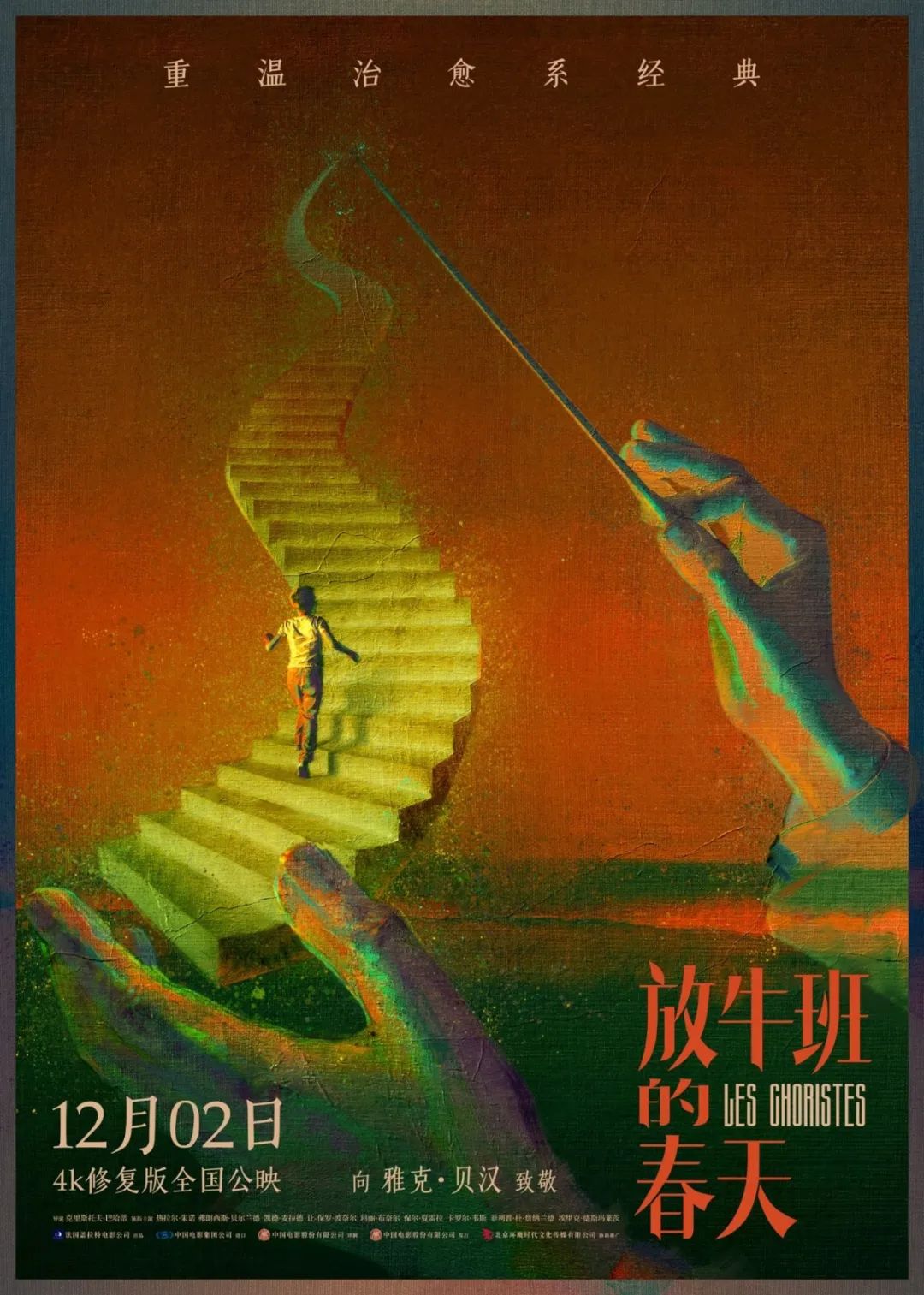
Un film intemporel et réconfortant
Réalisé par Christophe Barratier, Les Choristes a connu un succès phénoménal non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Nommé huit fois aux César du cinéma en 2005, il obtient le César de la meilleure musique et celui du meilleur son. Il a également été nommé deux fois aux Oscars, pour le prix de la meilleure chanson et celui du meilleur film étranger.
L’histoire se déroule en 1949. Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi, accepte un poste de surveillant dans un pensionnat pour garçons nommé « Fond de l'étang ». Le système répressif appliqué par le directeur, Rachin, bouleverse Mathieu. En initiant ces enfants difficiles à la musique et au chant choral, Mathieu parviendra à transformer leur quotidien.
{"preview_thumbnail":"/wp-content/uploads/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/XNTkyMzQ2NzI1Ng%3D%3D.jpg?itok=_bFdyTqR","video_url":"https://v.youku.com/v_show/id_XNTkyMzQ2NzI1Ng==.html","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":1},"settings_summary":["Embedded Video (Adaptatif, autoplaying)."]}
Le film, rempli de tendresse, de drôlerie et d’espoir, est très attendu par le public chinois. Nombreux sont les fans qui ont hâte de redécouvrir en salle la chanson phare du film, Vois sur ton chemin.
Les Choristes est produit par Galatée Films, et importé par China Film Group Corporation.
Venez redécouvrir le film sur les écrans chinois, et laissez-vous envelopper dans une douce nostalgie, bercée par les voix célestes des enfants de la chorale !
Trois autres films de Christophe Barratier
À l’occasion de la sortie des Choristes, découvrez trois autres long-métrages du réalisateur Christophe Barratier disponibles sur des plateformes chinoises. De quoi ravir petits et grands !
Faubourg 36 raconte l'histoire de trois chômeurs qui tentent de faire revivre une salle de music-hall, le « Chansonia ». Un film qui renoue avec le cinéma et la chanson populaires !
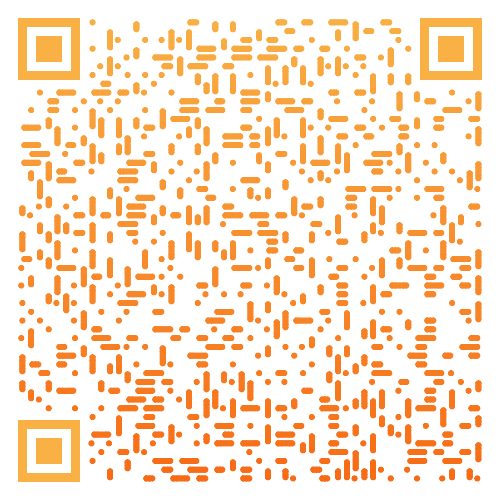

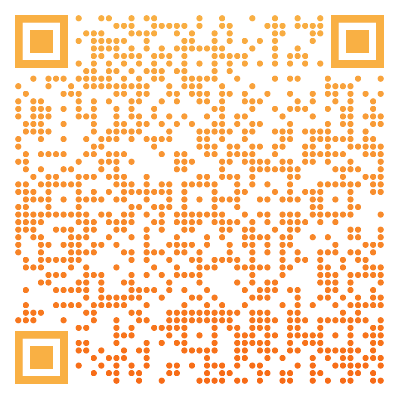
« Les choristes » existent également dans la vraie vie !
Plusieurs chœurs d’enfants existent sur la scène internationale, et notamment française, comme Kids United et New Poppys.
Kids United est un groupe de musique pop français composé d’enfants et de jeunes adolescents. Formé en 2015 dans le cadre d’une campagne de l’UNICEF France, Kids Unitd reprennent « les plus belles chansons célébrant la paix et l'espoir ». Ils ont très vite connu un succès mondial et ont vendu plus de 1,7 million d'albums en 3 ans. En 2018, le groupe a décidé de se séparer pour laisser place à une nouvelle génération. Cinq jeunes talents ont pris la relève afin de continuer à véhiculer leur message de paix à travers le monde et toujours en musique sous le nom : Kids United Nouvelle Génération.
New Poppys est composé d'enfants qui chantent pour rêver. Leur nom vient de Les Poppys, un groupe d'enfants français interprétant des chants dans la mouvance hippie des années 1970, en pleine guerre du Viêt Nam. Leurs chansons mettent en avant l'amour, l'incompréhension face à la guerre et la violence des adultes, la fraternité, la paix, l'écologie mais aussi la religion.
Parmi les lauréats de cette année, nous retrouvons des auteurs déjà confirmés comme Brigitte Giraud, prix Goncourt pour Vivre vite (Flammarion) et Simon Liberati, prix Renaudot pour Performance (Grasset), déjà reconnus par leurs pairs et récompensés pour des livres précédents. Le palmarès des grands prix permet aussi cette année de mettre en lumière de nouvelles voix comme Giuliano Da Empoli qui remporte le prix de l’Académie Française pour son premier roman, Le Mage du Kremlin (Gallimard), ou encore Philibert Humm, autre primo-romancier récompensé par le prix Interallié pour Roman fleuve (Editions des Equateurs).
Découvrons les lauréats !
Prix Goncourt : Brigitte Giraud, Vivre vite (Flammarion)

Le très attendu Prix Goncourt a été décerné à Brigitte Giraud pour Vivre vite, après 14 tours de scrutin. Dans ce récit autobiographique, la narratrice déploie de nombreuses hypothèses pour chercher vainement à expliquer la mort de son compagnon Claude dans un accident de moto, vingt ans plus tôt. Cet égrainage des possibilités tisse la trame narrative d’un roman au rythme oppressant, à la fois portrait amoureux et description d’une époque. Ce prix Goncourt vient confirmer le talent de Brigitte Giraud, déjà récompensée par une mention spéciale du prix Wepler pour A présent en 2001 et du prix Jean-Giono pour Une année étrangère en 2009, et du prix Goncourt de la nouvelle pour L’Amour est très surestimé en 2007.
Prix Goncourt des Lycéens : Sabyl Ghoussoub, Beyrouth-sur-Seine (Stock)
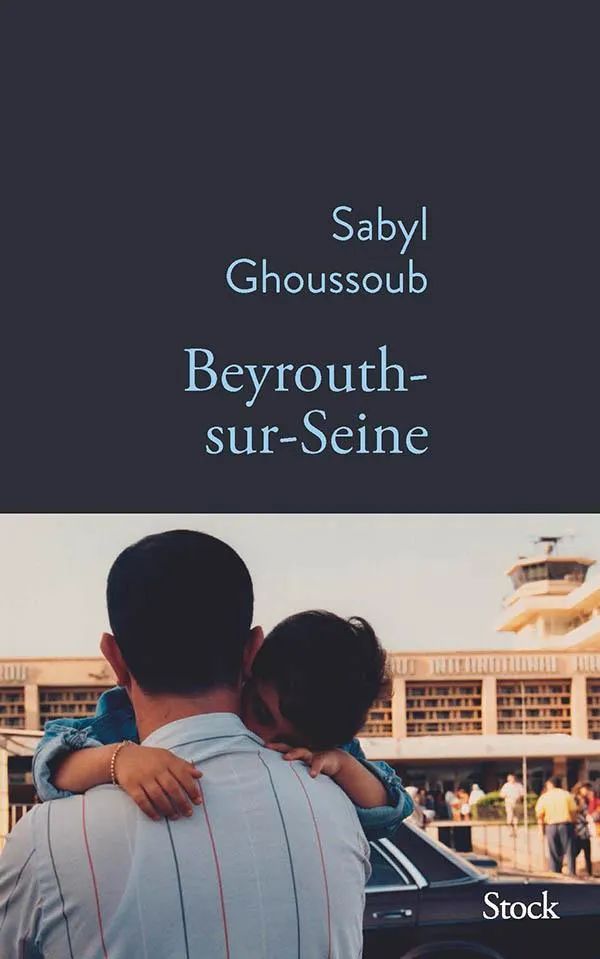
Avec Beyrouth-sur-Seine, Sabyl Ghoussoub a obtenu le 35e prix Goncourt des lycéens, délivré par un jury de douze lycéens représentant 1 500 jeunes français. Ce roman qui retrace le parcours d’une famille libanaise qui émigre en France alors que la guerre éclate au Liban est un récit largement autobiographique. L’auteur, journaliste franco-libanais, a accueilli le prix par ces mots : « Le mauvais lycéen que j’étais devrait remercier les merveilleux lycéens que vous êtes. Ce prix est un énorme honneur».
Prix Renaudot : Simon Liberati, Performance (Grasset)
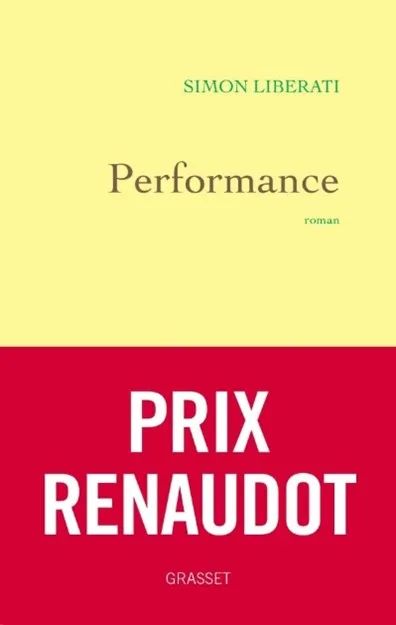
Simon Liberati a été récompensé du Prix Renaudot pour Performance, une autofiction qui prend pour personnage principal un auteur septuagénaire en manque d’inspiration, entretenant une relation amoureuse avec sa belle-fille. Ce roman qui se concentre autour de l’écriture du scénario d’une série consacrée aux Rolling Stones est empreint d’une esthétique que les critiques ont qualifié de punk et romantique. Simon Liberati avait déjà été récompensé par le prix de Flore en 2009 pour l’Hyper Justine (Flammarion) et par le prix Femina en 2012 pour Jayne Mansfield 1967 (Grasset).
Prix de l’Académie Française : Giuliano Da Empoli, Le Mage du Kremlin (Gallimard)
.png)
Cité parmi les grands favoris pour le prix Goncourt, Le Mage du Kremlin de Giuliano Da Empoli a finalement remporté le prix de l’Académie Française. Bien qu’il s’agisse de son premier roman, Giuliano Da Empoli a déjà une longue carrière derrière lui : il a co-fondé le think tank italien Volta, occupé le poste de maire-adjoint à la culture de Florence et celui de conseiller politique. C’est sans doute sur cette expérience politique confirmée qu’il s’est appuyé pour écrire Le Mage du Kremlin, un portrait du personnage Vadim Baranov. Ce dernier emprunte beaucoup à Vladislav Sourkov, l’un des principaux idéologues du Kremlin, qui a joué un rôle de premier plan dans l’ascension de Vladimir Poutine au pouvoir dans les années 2000.
Prix Interallié : Philibert Humm, Roman fleuve (Editions des Equateurs)
.jpg)
Roman fleuve, premier roman de Philibert Humm a été récompensé par le prix Interallié. Ce livre salué par la critique pour son ton décalé et burlesque prend la forme d’un itinéraire sur la Seine de trois amis, qui rejoignent Honfleur depuis Paris à bord d’un canot. Cette aventure ponctuée de péripéties anecdotiques est prétexte à l’auteur de raconter l’amitié de ces trois personnages. Ce récit de la fraternité a sans doute contribué à convaincre le jury exclusivement masculin du prix Interallié.
Prix Femina : Claudie Hunzinger, Un chien à ma table (Grasset)
.jpg)
Le prix Femina, dont le jury est quant à lui composé exclusivement de femmes a décidé de remettre cette année sa récompense à Claudie Hunzinger pour Un chien à ma table. Ce roman prend pour personnage principal une jeune chienne, Yes, qui fait irruption dans la vie d’un couple âgé. Questionnant l’amour de ce couple, Yes est aussi le prétexte pour l’écrivaine d’interroger plus largement notre rapport à la nature. Un chien à ma table compte parmi les livres les plus attendus car il figurait sur les deuxièmes sélections des prix Renaudot, Femina et Médicis.
Prix Décembre : Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafon (Stock)
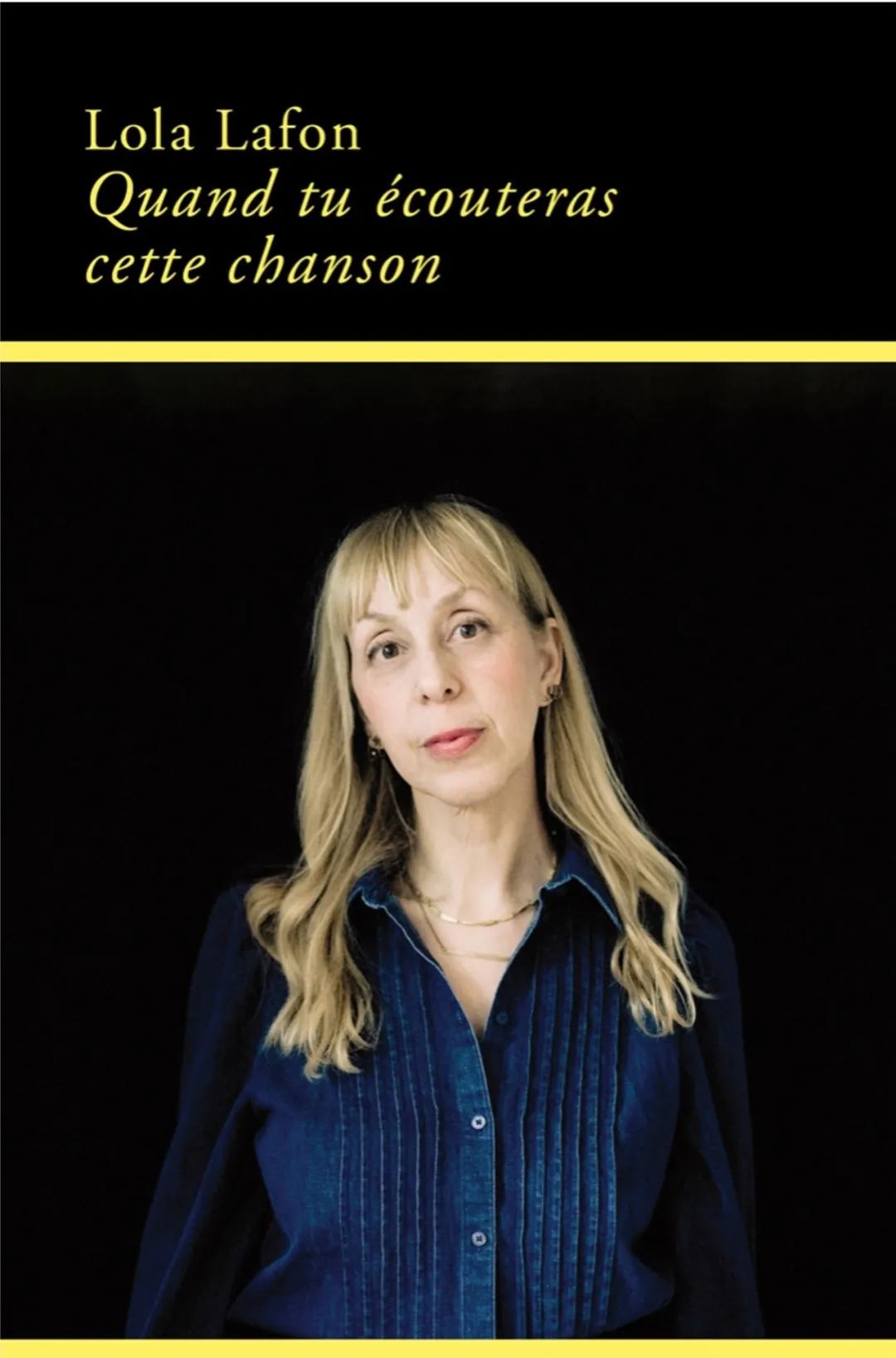
Lola Lafon se voit récompensée par le Prix Décembre pour Quand tu écouteras cette chanson, livre sur Anne Franck qui fait écho à ses drames intimes. Publié dans l’excellente collection « Ma nuit au musée », ce récit raconte sa nuit passée dans l’Annexe du musée Anne Franck à Amsterdam, lieu où la jeune adolescente a vécu cachée avec sa famille avant d’être déportée et assassinée dans le camp de concentration de Bergen-Belsen en 1945. Ce récit poignant de Lola Lafon permet de replacer le journal d’Anne Franck dans son contexte, d’en apprendre la véritable histoire et de le réhabiliter au rang d’œuvre littéraire écrite par une grande écrivaine, qui n’était pas uniquement ce que l’Histoire a retenu d’elle, c’est-à-dire une victime de la Shoah.
Prix Médicis : Emmanuelle Bayamack-Tam, La Treizième heure (P.O.L.)
.jpg)
Emmanuelle Bayamack-Tam remporte le prix Médicis avec La Treizième heure, un roman familial contemporain qui aborde les problématiques du genre, de la transidentité et des nouvelles formes de parentalités dans une narration croisée qui donne voix aux trois membres d’une même famille. Emmanuelle Bayamack-Tam s’était déjà faite remarquer pour Arcadie (P.O.L.), prix du Livre Inter en 2019.
L’océan si nécessaire et pourtant mal connu
Bruno David
PENSER%20L%E2%80%99%C3%89COLOGIE%20%233/640.jpg)
© A. Iatzoura-MNHN
Président du Muséum national d’Histoire naturelle depuis 2015, Bruno David a été chercheur au CNRS. Paléontologue et biologiste, ses recherches l’ont conduit à explorer l’évolution de la biodiversité. Il a participé à de grandes missions océanographiques dans l'Océan Austral, la mer des Caraïbes et dans le Pacifique avec le submersible Nautile. Il tient, depuis septembre 2020, une chronique sur France Culture et il est, entre autres, l’auteur de À l’aube de la 6e extinction paru chez Grasset (2021) et du Monde vivant avec G. Lecointre (Grasset, 2022).
L'océan est immense. Il couvre 360 millions de kilomètres carrés, soit 70 % de la surface de la planète. Il offre à la vie un volume de 1,3 milliards de kilomètres cubes, soit 96% du volume biosphérique. La longueur déroulée des côtes mondiales est estimée à 40 fois la circonférence de la Terre – en suivant les contours des cartes au 1/250 000 –, soit 1 600 000 kilomètres.
L'océan est profond. Sa profondeur moyenne est de 3 700 m et les plateaux continentaux, où se concentre la vie, ne représentent qu'un peu plus de 7 % de sa surface totale. Ces plateaux abritent en effet l'immense majorité des espèces marines qui y bénéficient d'énergie solaire (les récifs coralliens en sont l'exemple le plus flagrant) et ils sont le lieu de l'essentiel de nos activités comme la pêche, l'aquaculture, le tourisme…
L’océan est traversé de courants gigantesques. Le Gulf Stream au large de Terre-Neuve a un débit de 100 millions de mètres cubes par seconde, mais il est dépassé par le courant circumpolaire qui tourne autour de l’Antarctique qui atteint 150 millions de m3/s, soit l’équivalent de 700 Amazone ou encore 120 fois l’ensemble des fleuves du monde.
Les eaux salées de l'océan sont un milieu bien spécifique. La pression y règne en maître : 100 bars à 1 000 mètres de profondeur, 1 000 bars à 10 000 mètres (rappelons que la pression atmosphérique n’est que d'un seul petit bar). La viscosité y est plus de 50 fois celle de l'air, et la densité plus de 800 fois celle de l'air. Les déplacements actifs y sont donc plus difficiles, mais la poussée d'Archimède facilite aussi une vie dans les trois dimensions, permettant de passer des profondeurs à la surface sans avoir à dépenser trop d'énergie. L'oxygène y est rare (30 fois moins que dans l'air à volume égal).
Tout cela fait que l’océan est tout sauf une masse d’eau inerte et homogène. Il n’a pas le même visage selon les endroits et les profondeurs, il change au gré des saisons, des années, des époques et sa géographie s’est modulée au fil des périodes géologiques participant ainsi façonner des contextes plus ou moins favorables à l’essor du vivant..
L’océan mondial est de loin le plus vaste ensemble d’écosystèmes de la planète. Il joue un rôle essentiel dans les processus de transfert et de stockage de matière et d’énergie, notamment à travers des couplages étroits entre ses composantes physiques, chimiques et biologiques au sein des grands cycles biogéochimiques. Il est indissociable de la vie sur Terre qui est née dans l'océan et qui y a trouvé un espace disponible pour s'y épanouir.
La biodiversité marine
L’océan d’aujourd’hui abrite une multitude d'habitats, depuis les littoraux de toutes natures (fonds rocheux, sableux ou herbiers de nos côtes) jusqu'aux grands fonds (plaines abyssales monotones ou oasis hydrothermales), en passant par les récifs coralliens, les mers polaires glacées, les environnements sur-salés des lagunes et des « lacs » salins profonds, ou encore les milieux quelque peu dessalés des fjords, lochs et estuaires. Présente à toute latitude et à toute profondeur, la vie marine se distribue dans l’océan selon différents gradients environnementaux qui influencent également le fonctionnement des écosystèmes marins.
Dans toute sa diversité, la vie marine est extraordinairement abondante : tous les grands groupes sont présents dans l’océan et la plupart y sont nés. Le krill, la petite crevette qui sert de nourriture aux baleines, est dans le top 5 des espèces animales les plus prolifiques sur Terre (des milliers de milliards d'individus). L'océan héberge aussi 1030 virus, soit plus que toutes les étoiles de l'univers connu. Les poissons y pullulent par centaines de milliards, ou du moins y pullulaient avant que des pressions de pêche ne fassent dangereusement décliner les stocks.
Les écosystèmes marins sont largement plus anciens et plus vastes que les écosystèmes terrestres et le recensement de leur biodiversité n’est encore que fragmentaire. De manière globale, on peut estimer que 70% à 80% des espèces marines restent à découvrir et plusieurs « boîtes noires » sont d’immenses réservoirs de biodiversité (vers nématodes, minuscules radiolaires, bactéries, virus, etc.). Dans tous les milieux étudiés à l’aide des nouvelles méthodes de séquençage génétique de la biodiversité, celle-ci se révèle bien supérieure aux estimations basées sur l’observation anatomique des organismes. En effet, des pans entiers de diversité échappent aux analyses morphologiques, essentiellement dans le monde microbien (virus, procaryotes, protistes), tandis que les espèces cryptiques, similaires morphologiquement mais différentes génétiquement, abondent dans les fractions visibles du vivant (protistes, plantes, animaux).
Depuis longtemps, il était acquis que les habitats littoraux étaient fort diversifiés et que les habitats du large, benthiques ou pélagiques, l’étaient très peu. Cette image d’Épinal du monde marin a considérablement évolué ces dernières années. Même si les domaines hauturiers et profonds sont plus homogènes à large échelle que le côtier, ils se présentent néanmoins comme une mosaïque d’habitats. Il convient de prendre en compte leur complexité dans les approches écosystémiques de l’océan, particulièrement lorsque les environnements benthiques sont concernés.
Un exemple. Les oasis hydrothermales découvertes à la fin des années 1970 et qui jalonnent les dorsales ont, dans un premier temps, semblées toutes identiques du Pacifique, à l’Atlantique ou à l’océan Indien. Si ces écosystèmes sont en effet similaires et abritent des communautés (bactéries, vers, crustacés…) comparables, ce ne sont pour autant pas les mêmes espèces qui sont présentes dans chaque bassin. Les « paysages » se ressemblent, mais leur richesse spécifique est bien différente de celle envisagée initialement.
Les humains et la mer
L'humanité ne s'y est pas trompée, les océans peuvent fournir des ressources abondantes (nourriture, sable, gravier, minerais, etc.), si abondantes qu'on les a longtemps crues inépuisables. La mer a été le berceau de nombreuses civilisations florissantes ou conquérantes (les phéniciens, les vikings, les polynésiens, les populations de Carthage, Venise la Sérénissime, Amsterdam, etc.). L'humanité est depuis toujours profondément attachée à la mer, qui lui a donné et permis beaucoup, mais cet âge d'or pourrait bien être révolu tant les pressions deviennent intenses, sur les littoraux comme au large.
Bien que les pressions anthropiques en mer puissent paraître moins intenses et souvent moins directes qu'à terre, elles prennent depuis plusieurs décennies une importance grandissante et elles touchent des environnements de plus en plus divers, y compris ceux qui sont les plus éloignés du cadre de vie de l'espèce humaine, comme les zones profondes ou polaires ou comme l’océan du large où se regroupent nos déchets plastiques dans de vastes gyres.
Les principaux effets de l'action de l'homme y sont la surexploitation des ressources, les pertes d’habitats et l’artificialisation des milieux, particulièrement sensible sur les côtes. Ces impacts conjugués à l’installation massive de populations humaines sur les littoraux (60% de la population mondiale vit à moins de 100 kilomètres d’une côte) a conduit à l’émergence d’environnements au sein desquels la prédominance de l’emprise anthropique est telle, qu’on peut les qualifier de socio-écosystèmes très fortement anthropisés[1], véritables nouveaux biomes qui peuvent être vus comme des systèmes couplés homme-nature. En effet, ces systèmes associent des éléments multiples, interconnectés et interdépendants, dont les deux composantes principales restent d’une part, l’écosystème dans tous ses aspects biotiques et abiotiques, c’est-à-dire un milieu spécifique aux potentialités diverses, subissant ou exerçant des contraintes très fortes et, d’autre part, un système social très prégnant. L’Homme et son action, par une pression pérenne et très forte, affectent de manière prépondérante les différentes composantes de ces systèmes très fortement artificialisés ; ils sont la clef d’entrée majeure de leur compréhension.
Les sciences de la mer
A priori, les sciences de la mer ne relèvent pas de champs disciplinaires qui seraient totalement originaux et exclusifs. Les concepts fondamentaux et cadres théoriques qui fondent les recherches en écologie, systématique, évolution et sciences de l’environnement sont les mêmes pour le domaine marin et le domaine continental. De surcroît, le cadre général (changement global, anthropisation) est assez similaire.
On pourrait avancer que les seules différences portent sur les objets étudiés et non pas sur leur nature profonde d’espèces, d’écosystèmes ou d’anthroposystèmes qui sont les mêmes qu’à terre. Pourquoi, alors, centrer une réflexion sur le marin ?
D’abord, il existe des approches particulières au domaine marin. Du fait même que nous soyons une espèce continentale, ce milieu nous est difficile d’accès : exploration comme expérimentation requièrent des moyens spécifiques (bateaux, sous-marins, capteurs, robots instrumentés étanches, plongée, aquariums…) qui contribuent à structurer la communauté scientifique concernée.
Ensuite, certaines caractéristiques du milieu marin (relative isotropie tridimensionnelle, densité du milieu, pression osmotique, relativement faible contenu en oxygène, effet tampon des masses d’eau, volumes offerts à la vie…) imposent des modalités de fonctionnement ou de réactivité des écosystèmes marins bien différentes de celles rencontrées en domaine terrestre (par exemple la mobilité des espèces sous contrainte climatique est presque dix fois plus rapide en mer qu'à terre). Ces caractéristiques peuvent conduire à des questionnements scientifiques adaptés, voire originaux.
Enfin, les enjeux de société sont spécifiques ; l’usage des ressources marines, comme leur accès, est radicalement différent de celui des ressources continentales : capture d’espèces sauvages, consommation de prédateurs supérieurs, difficulté d’accès, caractère international de l'essentiel de l'océan mondial ce qui implique une réflexion sur l’accès et au partage des ressources.
Bien que le milieu marin soit complexe et riche, les sciences de la mer sont encore une science jeune, du moins dès que l’on s ‘écarte du littoral. Cela du fait des difficultés d’accès ; songeons que la tectonique des plaques date de moins de 50 ans. Songeons qu’il y a moins de 10 ans la navigation de la goélette Tara nous a ouvert les yeux sur une diversité microscopique inconnue. Songeons que les missions d’exploration du Muséum national d’histoire naturelle (La planète revisitée) rapportent chaque année des moissons de nouvelles espèces d’invertébrés. Néanmoins l’histoire s’accélère et on peut constater sans exagération que les sciences de la mer s’apprêtent à ouvrir une nouvelle page véritablement fascinante.
Les développements technologiques de ces dernières années rendent désormais possible une approche globale du système océan, intégrant à la fois les dernières performances des modèles de la physique et de la chimie de l'océan avec les multiples données biologiques fournies par les nouvelles technologies de séquençage (NTS) ou avec l'élaboration des scénarios d'évolution de la biodiversité. La frontière franchie par les NTS offre notamment de nouveaux champs d'investigation tant pour l'évolution biologique, la biogéographie, ou le fonctionnement des écosystèmes. Du côté de l'océanographie physique et chimique, les modèles numériques s’améliorent considérablement et, depuis peu, il est envisagé de construire un jumeau numérique de l’océan. Cette initiative est remarquable car elle permettra de moduler certains paramètres de l’océan et d’en constater les effets de manière quasi expérimentale sans passer par de fastidieuses études de terrain. Certes, celles-ci resteront nécessaires, mais une approche holistique du système océan est désormais à notre portée car les conditions d’une fécondation croisée de l’océanographie et de la biologie marine sont réunies. Le succès de ce rapprochement se mesurera à l’aune des concepts nouveaux qui en découleront. On peut faire le pari de ce succès.
Pour conclure
On ne mesure pas dans notre vie quotidienne tout ce que nous devons à l’océan. On en connait les ressources halieutiques, les ressources d’aménité lorsque nous profitons du bord de la mer en été, les opportunités liées aux transports maritimes. Mais on oublie trop souvent le rôle de cette masse d’eau immense dans la régulation du climat : effet tampon pour la température, stockage du CO2, sans parler de l’importance du plancton dans le cycle de l’oxygène ou dans la formation des nuages.
Dans le contexte du changement global, il est essentiel d’être en capacité de répondre à la question des futurs possibles pour l’océan, pour sa biodiversité marine et pour les services écosystémiques associés. Quels changements en cours ? Quelles évolutions à venir ? Quelles adaptations escompter ? Autant de questions auxquelles la recherche, comme les acteurs politiques ou économiques devront répondre si l’on veut un futur souhaitable pour l’humanité sur cette planète dont la surface est majoritairement aquatique.
[1] On peut qualifier ces systèmes de socio-écosystèmes anthropoconstruits. L'homme est l’acteur prépondérant sur l'ensemble du système et de ses composantes.
PENSER%20L%E2%80%99%C3%89COLOGIE%20%233/640-1_0.jpg)
01

© FRANCK FIFE / AFP
![]()
02


© afp.com/EMMANUEL DUNAND
![]()
03
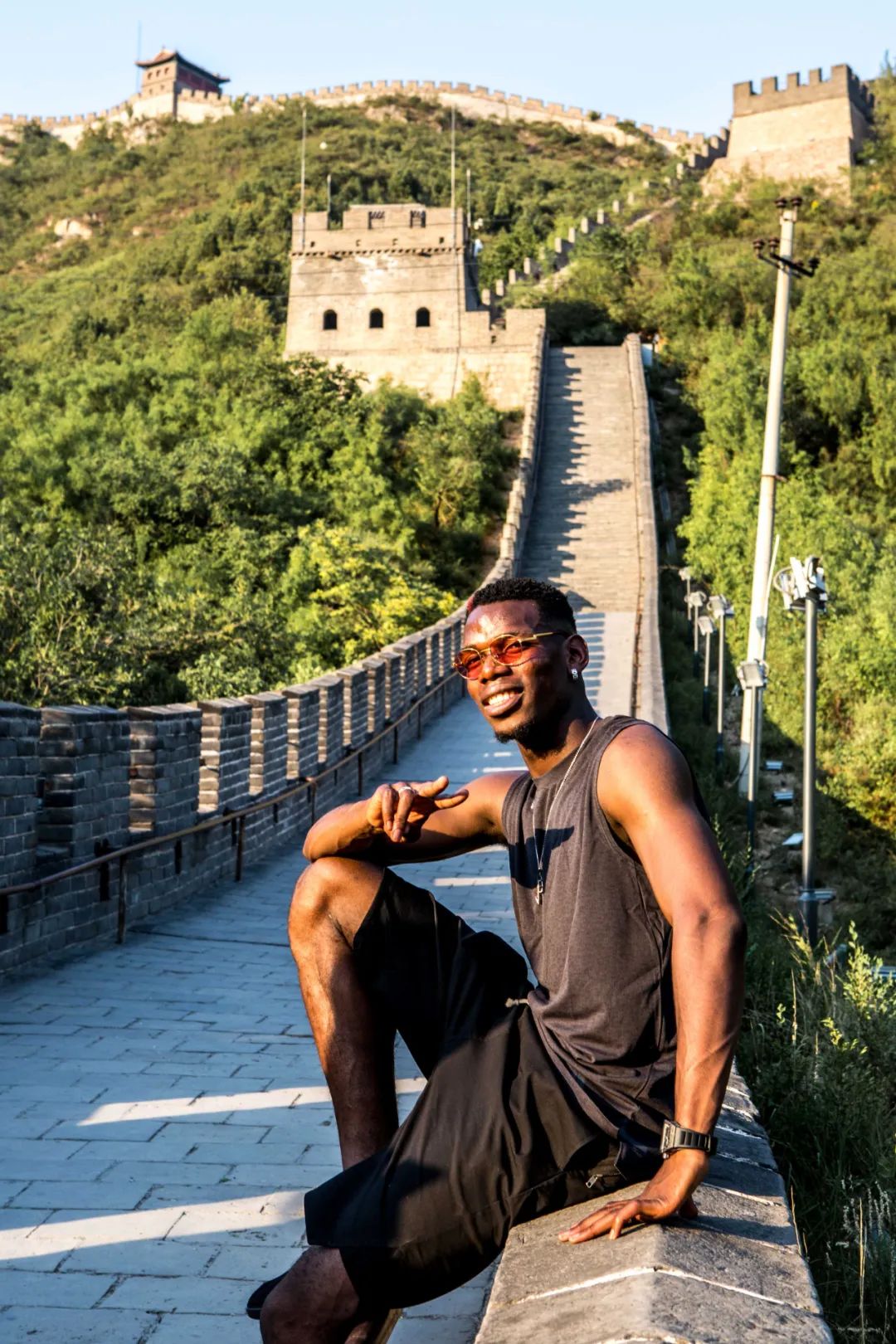

04

En 2019, la France a accueilli pour la première fois de son histoire une Coupe du monde de football féminine. Avec 90 % des licenciés, le football est majoritairement pratiqué par les hommes en France. Cependant, la féminisation du sport est notable : le nombre de licenciées est fortement à la hausse en 2022 avec une augmentation de 15,5% sur un an.
![]()
05

Il n’y a pas une, mais 14 équipes de France de football. Outre les équipes professionnelles masculines et féminines, il faut également compter les équipes « espoirs » qui regroupent les meilleurs jeunes footballeurs, l’équipe de Futsal, l’équipe de « beach soccer » et l’équipe olympique !
![]()
06

![]()
La place des océans dans les sciences de l’environnement
Françoise Gaill

© Torben Schmitz
Les sciences de l’environnement sont récentes : leur reconnaissance institutionnelle date d’une quinzaine d’années. Il s’agit d’un champ scientifique regroupant un ensemble de disciplines et d’approches variées autour de l’environnement. Ce champ scientifique a été institué par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche lors de la création de l’Alliance nationale de recherche pour l’environnement (AllEnvi), en 2010. Cette alliance vise aujourd’hui à coordonner les recherches françaises pour réussir la transition écologique et relever les grands défis sociétaux [1]. Treize thématiques sont identifiées pour relever ceux-ci, dont une seule sur la mer, ce qui permet d’emblée de situer l’importance relative des recherches réalisées dans le domaine marin.
D’ailleurs l’océan constitue-t-il vraiment un environnement ?
Oui, au sens où l’on qualifie un espace au travers de ses propres caractéristiques qui permettent de le définir comme une entité singulière. L’océan borde les continents. Or « ce qui entoure », « ce qui limite » est un des sens étymologiques du terme « environnement » [2]. Cette étendue liquide se différencie bien des parties continentales, qu’elle borde au niveau des littoraux, pour ce que nous en voyons. Ces dernières ne sont d’ailleurs que la partie émergée de l’iceberg, car cette rencontre terre/mer se prolonge jusqu’au plus profond de l’océan, l’océan se situant en réalité au-dessus du plancher océanique qui est la véritable interface terre/mer, même si ce que nous entendons généralement par « couple terre-mer » désigne des zones fortement anthropisées, comme les littoraux.
L’océan et le climat
Le néologisme « océanographie » a été créé en 1854, en Autriche, à partir du mot « Ozean » [2], auquel a été accolé la terminaison « graphie ». Ce nouveau terme nomme l’étude des océans et des mers de la Terre.
L’océanographie, qui est la discipline instituée s’intéressant aux océans, est multidisciplinaire : elle englobe des branches de la physique, de la chimie, des géosciences et de la biologie associée, mais c’est à la physique qu’elle doit son cœur de discipline et sa puissance de modélisation des rapports océan/atmosphère. Ce qui au départ a fait la force de l’océanologie, c’est d’ailleurs l’étude de cette interaction océan/atmosphère qui constitue une composante forte des sciences du climat. Cette vision de l’océan s’inscrit aujourd’hui dans l’étude dites des « enveloppes superficielles du système Terre », les distinguant ainsi des profondeurs terrestres [4].
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) [7] vient de décider la rédaction d’un rapport spécial qui sera intitulé « Climat, océan et cryosphère », correspondant à une des priorités de la plateforme Océan Climat créée en 2014 en France [8] pour attirer l’attention des politiques sur le rôle majeur que joue l’océan dans le climat [9]. On oublie en effet trop souvent l’importance de l’océan pour le devenir de la planète et son rôle décisif dans le système climatique. L’océan couvre 70 % de la surface du globe, il absorbe environ 22 millions de tonnes de CO2 par jour, c’est-à-dire le quart du CO2 émis chaque année par l’homme dans l’atmosphère. L’océan est à l’origine de la moitié de l’oxygène que nous respirons et stocke 90 % du surplus de chaleur dû à l’effet de serre.
En tant que régulateur thermique [10], l’océan interagit de façon dynamique avec l’atmosphère pour assurer l’équilibre du climat, et ce, sur des temps longs. Plus chaudes au niveau des Tropiques, les eaux de surface remontent vers le Nord pour plonger dans les profondeurs après s’être refroidies (par exemple, dans la Mer de Norvège). Elles descendent alors à entre 2 000 mètres et 4 000 mètres de profondeur dans l’Océan Atlantique, le long du continent américain, avant de rejoindre les eaux profondes de l’Antarctique. Puis elles migrent vers les océans Indien et Pacifique, où elles remontent progressivement vers la surface : le cycle complet de ce transit dure près d’un millénaire ! L’excès de chaleur dû au réchauffement climatique absorbé par l’océan pourrait ralentir ce gigantesque tapis roulant, appelé « circulation thermohaline » [11], ce qui aurait pour effet de freiner en retour la capacité de l’océan à absorber ledit excédent de chaleur.
Qu’adviendrait-il ainsi de l’évolution du climat, si l’océan n’était pas là pour jouer un rôle de modérateur et jusqu’à quand sera-t-il en mesure d’assurer un tel rôle ? [8]. Il est encore trop tôt pour le dire, mais les résultats scientifiques montrent que l’océan tempère le changement climatique [12], qu’il est un puits de carbone et un accumulateur de chaleur, mais qu’il est, lui aussi, en train de changer. Depuis une trentaine d’années, les eaux de surface se réchauffent en moyenne de 0,2°C par décennie. Certains indices du ralentissement du « tapis roulant » ont déjà été relevés dans l’Atlantique Nord. Mais on manque de données pour démontrer sérieusement l’existence d’un changement dans la circulation océanique elle-même. Selon Thomas Stocker [13], on s’attend à un accroissement de la fréquence et de l’intensité d’événements climatiques extrêmes, comme les tempêtes, les cyclones ou les moussons. Une conséquence du réchauffement des eaux de surface est en tous cas d’ores et déjà palpable : dans l’une des régions de l’océan qui s’est réchauffée le plus rapidement au monde entre 2004 et 2013, le Golfe du Maine (qui se situe sur la côte Est de l’Amérique du Nord), le stock de morue a brusquement décliné au cours de cette même période.
Le réchauffement de l’atmosphère entraîne mécaniquement celui des eaux salées. En effet, l’océan se dilate, et donc le niveau de la mer s’élève, et ce d’autant plus vite que la fonte des glaces s’accélère. Prendre l’océan en compte dans le système climatique est désormais une des priorités du GIEC, qui avait défriché cette question dans son 5ème rapport, attirant l’attention sur cet environnement majeur dans le système climatique. Les modèles envisageaient, il y a encore peu, une hausse minimale du niveau des mers d’un quart de mètre dès la fin du siècle, avec un maximum de 80 centimètres. Et les dernières publications montrent que si l’on tient compte de la fonte des glaciers de zones non prises en compte initialement dans les modèles du GIEC (pour différentes raisons) comme le Groenland et l’Antarctique [14], l’élévation du niveau des mers pourrait atteindre près d’1,20 mètres à la fin du XXIe siècle. On en voit d’emblée les conséquences catastrophiques pour les populations humaines et leur environnement : érosion, affaissements, submersion partielle (voire disparition totale) de certaines îles. Et les estimations actuelles indiquent que la moitié des espèces marines abritées dans les récifs coralliens pourraient avoir disparu à l’horizon 2050 [8]. On comprend donc aisément l’inquiétude des États insulaires et leur attachement à voir les océans pris en considération dans les questions climatiques.
L’océan et la biosphère
Il est une vision de l’océan qui décentre l’objet visé non plus vers sa partie physique mais vers le vivant, faisant de l’océan un environnement particulier de l’ensemble « biosphère ».
Le World Ocean Assessment publié par les Nations Unies en 2015 [15] (mais trop souvent passé inaperçu) a identifié cet aspect. Mais c’est le programme Tara Océans [16] qui a été le premier à illustrer cette vision de l’océan en s’intéressant d’abord au vivant et à sa biodiversité pour structurer l’expédition éponyme et organiser des coopérations avec des océanographes. Tara Océans est le premier programme de recherche d’envergure in natura à avoir envisagé l’océan tel que l’on peut le voir en tant qu’environnement ou qu’écosystème, car l’écosystème étudié est présenté dans Océanomics [17] comme le plus grand des écosystèmes planétaires.
L’océan est ainsi diversement apprécié par les divers acteurs concernés. Enveloppe fluide du système Terre (si l’on se place du point de vue de l’océanographe), environnement incluant un écosystème planétaire (comme le plancton) pour Tara Océans ou, plus récemment, et plus simplement, « écosystème », puisque le préambule de la Convention de Paris de décembre 2015 (COP 21) mentionne, pour la première fois et de manière explicite, l’existence de l’océan en le considérant non pas comme un environnement, mais comme un écosystème. Et l’océan y est d’ailleurs plutôt identifié comme étant un ensemble d’écosystèmes puisqu’il parle d’océans au pluriel (quand les Nations Unies définissent l’« Océan » comme le système englobant la diversité des milieux océaniques. Le passage mentionnant l’océan dans la Convention de Paris est le suivant : « Notant qu’il importe de veiller à l’intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans, et à la protection de la biodiversité, reconnue par certaines cultures comme la Terre nourricière, et notant l’importance pour certaines de la notion de ”justice climatique”, dans l’action menée face aux changements climatiques».
L’Océan, cet ensemble d’océans spécifiques, serait alors le plus grand écosystème planétaire.
Mais les questions scientifiques qui se posent en milieu marin ou en milieu terrestre sont-elles si différentes ?
A priori, il n’y a aucune raison, du point de vue disciplinaire, à ce qu’il y ait une spécificité des sciences de la mer, si ce n’est la spécificité des approches en elles-mêmes. En effet, l’océan est plus difficile d’accès que l’espace continental et des infrastructures dédiées à son étude se sont fait jour au cours de l’histoire des sciences [18]. Les marins ont eu besoin de navires océanographiques ou de stations marines, et plus récemment se sont développées des instrumentations sous-marines (sous-marins, drones ou gliders) et des approches satellitaires.
Il existe également de nouvelles infrastructures, comme les Observatoires Génomiques (GO, pour Genomics Observatories) [19]. Ces dispositifs ont pour objectif de quantifier les interactions biotiques d’un écosystème et d’élaborer des modèles de la biodiversité pour prédire la qualité et la distribution des services écosystémiques. Ils sont répartis sur l’ensemble de la planète et beaucoup d’entre eux sont marins (Criobe en Polynésie, Roscoff et Banyuls). Organisés en réseau, ils représentent le « pouls de la planète », avec pour objectif de promouvoir un développement soutenable grâce à une meilleure compréhension des interactions entre l’homme et son environnement. Des données génétiques sont reliées aux données biophysiques et socio-économiques, qui permettent d’observer le flux de la variation génétique dans les écosystèmes humains et naturels et d’intégrer ces informations dans des modèles prédictifs.
Quelques questions ouvertes
Mais, en fait, les caractéristiques de l’espace-temps de l’environnement marin peuvent être considérées comme spécifiques, de par les caractéristiques physiques du milieu et de ses dimensions au regard de l’échelle du vivant, en termes de continuité spatiale et de dynamique temporelle. La vie est certes apparue dans les océans. Mais c’est après sa sortie des eaux que sa diversification a explosé à une époque relativement récente [18]. Les dimensions spatiales de l’océan sont gigantesques à l’échelle du vivant et de l’évolution de la biosphère et de la dynamique de ce milieu, ainsi que du point de vue de son importance dans le fonctionnement du système Terre. Elles le sont également du point de vue de leur faible anthropisation à l’échelle planétaire et de leur statut de patrimoine commun de l’humanité [20].
Cette biosphère marine est un ensemble de communautés juxtaposées, dont on ignore encore le fonctionnement et la nature des interactions. 250 000 espèces marines sont identifiées, ce qui est bien peu par rapport au nombre des espèces continentales [18]. Mais y a-t-il de bonnes raisons de penser que le nombre des espèces marines serait inférieur à celui des espèces des écosystèmes terrestres ?
Qu’en est-il de la connectivité en milieu marin et des échanges entre espèces ? Est-elle du même ordre que celle que l’écologie chimique met actuellement au jour dans les écosystèmes terrestres [21] ?
Qu’en est-il des échanges génétiques, des processus symbiotiques, des ensembles biogéographiques, des chemins évolutifs ?
Si ces questions sont abordées en ce qui concerne les écosystèmes littoraux, peu de choses sont connues sur ceux de la haute mer (à l’exception de l’écosystème planctonique exploré par Tara Océans).
On pense, par exemple, aux écosystèmes profonds qui se sont développés autour des dorsales océaniques en utilisant non pas la photosynthèse, mais la chimiosynthèse, dont on ignore encore l’universalité du phénomène à l’échelle des systèmes océaniques [22].
Il en va tout autant de l’espace gigantesque de bio-prospection qui reste à explorer, qu’il s’agisse des ressources génétiques potentielles ou des biotechnologies marines qui pourront être développées.
Le monde marin dans les sciences de l’environnement
Malgré son importance en termes de surface planétaire occupée (puisqu’il représente près des deux tiers de la surface de la Terre et qu’il est le premier volume de biosphère), on voit que l’océan est mineur dans le périmètre d’AllEnvi, qui « fédère, programme et coordonne la recherche environnementale française pour relever les grands défis sociétaux » [1]. Et l’on voit, par la même occasion, que l’enjeu « mer » n’apparaît pas comme aussi déterminant que peuvent l’être d’autres grands défis sociétaux, comme l’alimentation, l’eau, le climat et la préservation des territoires.
En juillet 2009, le Grenelle de la Mer insistait sur « l’abyssal besoin de connaissances ». Cette affirmation reste d’actualité, tandis que se font jour des impératifs internationaux, européens et nationaux relatifs au milieu océanique. L’objectif de l’Union européenne de restaurer et de maintenir un bon état écologique des eaux marines à l’horizon 2020 [23] est ainsi indissociable de l’obtention de données scientifiques et du développement de nouvelles approches [24]. Qu’il s’agisse de l’évaluation de l’état écologique des eaux ou de celle de l’impact environnemental des activités humaines, de la définition d’un bon état écologique, ou bien encore de la définition des objectifs et indicateurs associés et de l’application de programmes de surveillance et de mesure, l’ensemble des recherches actuelles attestent de la vitalité du domaine considéré.
Et depuis la COP 21, quelque chose a changé, en France, dans la manière d’aborder l’océan, notamment avec le vote de la loi Leroy sur l’économie bleue [25] et l’apparition du mot « mer » dans l’intitulé du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer. La décennie en cours marque également une période de prise de décisions importantes au sein du système des Nations Unies et de processus régionaux concernant la gouvernance de l’Océan avec, notamment, à court terme, les négociations pour la définition d’un instrument international de gouvernance de la biodiversité en haute mer (BBNJ) [26]. La notion de bien commun est convoquée, comme celle de patrimoine commun de l’humanité [20].
Le milieu marin est en quelque sorte, pour les sciences de l’environnement, ce que la mer est à la société actuelle, à savoir une inconnue, un territoire ignoré, un continent à découvrir. Mais en dehors de l’exploration elle-même, ce que peut apporter ce milieu aux sciences de l’environnement, c’est une manière de repenser ce domaine, non seulement d’en explorer des espaces inconnus, mais aussi d’en enrichir les problématiques. Car cet environnement sous-évalué du point de vue de la biodiversité et non encore anthropisé (sinon à sa périphérie) peut être source de références pour des questionnements liés à l’évolution ou ayant trait aux processus d’adaptation, aux fonctionnements écosystémiques ou aux structurations des communautés.
Si ces modèles d’une grande diversité restent à explorer, la définition des caractéristiques d’un grand nombre d’écosystèmes, de leurs habitats, de leurs interactions et de leur dynamique est l’un des enjeux majeurs de l’étude du vivant actuel. Et qu’il s’agisse des solutions fondées sur la nature impliquant la mise en place d’aires marines protégées ou d’enjeux économiques basés sur la richesse potentielle des énergies marines, des ressources minérales [27] ou des biotechnologies marines (sans oublier toutes les techniques liées aux sciences de l’ingénieur), il est évident que le fait de disposer d’un espace naturel non encore exploré (et donc non exploité) représente une promesse d’avenir formidable.
Françoise Gaill
1
http://www.Allenvi.fr
2
Pour la définition des termes « environnement » et « océan », voir : https://fr.wikipedia.org
3
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Le-Grenelle-Mer-de-2009-a-2012-.html
4
http://www.fondationdelamer.org
5
http://www.cnrs.fr/inee/ et http://www.insu.cnrs.fr/
6
http://www.ifremer.fr
7
https://ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
8
http://www.ocean-climate.org/
9
http://www.liberation.fr/terre/2015/06/04/cop-21-on-a-oublie-d-inviter-l-ocean_1323052
10
SPEICH (S.), REVERDIN (G.), MERCIER (H.) & JEANDEL (C.), L’océan réservoir de chaleur, fiches scientifiques, Plateforme Océan Climat, 2015, pp. 8-13.
11
MOSSERI (R.) & JEANDEL (C.) (Eds), Le Climat à découvert, CNRS Éditions, 2013.
12
GAILL (F.), « Océan et climat : un inséparable couple », Marine et Océans, n°249, 2015, 22 p.
13
STOCKER (T.F.),”The silent services of the world ocean”, Science, n°350, 2015, pp. 764-765.
14
De CONTO (R.M.) & POLLARD (D.),”Contribution of Antarctica to past and future sea-level rise”, Nature, n°531, 2016, pp. 587-591.
15
http://www.worldoceanassessment.org/
16
http://oceans.taraexpeditions.org/
17
Oceanomics : http://www.oceanomics.eu/
18
DAVID (B.), OZOUF (C.), TROUSSELIER (M.) & al., Mondes marins : voyage insolite au cœur des océans, CNRS Éditions et Cherche Midi, 2013, 182 p.
19
JOLY (D.), FAURE (D.) & SALAMITO (S.), L’empreinte du vivant, CNRS Éditions et Cherche Midi, 2015.
20
LAMY (P.), « Le Bien commun, nouveau paradigme de la gouvernance des océans », Revue Maritime, n°505, 2015, pp. 40-47.
21
HOSSAERT McKEY (M.) & BAGNÈRES-URBANY (A.G.), Écologie chimique : le langage de la nature, CNRS Éditions et Cherche Midi, 2012, 192 p.
22
LEVIN (L.) & LE BRIS (N.),”The deep ocean under climate change”, Science, n°350, 2015, pp. 766-768.
23
GAILL (F.), « Quel devenir pour l’océan et ses littoraux », in Quelles solutions face au changement climatique ?, LAVILLE (B.), THIEBAULT (S.) & EUZEN (A.) (eds), CNRS Éditions, 2015, pp. 148-154.
24
MOULINIER (H.), « La Stratégie maritime de la France et ses perspectives », in Annales des Mines, Responsabilité et environnement, n°70, avril 2013, pp. 81-87.
25
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/economie_bleue.asp
26
http://www.un.org/depts/los/biodiversity/prepcom.htm
27
DYMENT (J.), LALLIER (F.), LE BRIS (N.), ROUXEL (O.), SARRADIN (P.-M.), LAMARE (S.), COUMERT (C.), MORINEAUX (M.) & TOUROLLE (J.) (coord.), « Les impacts environnementaux de l’exploitation des ressources minérales marines profondes. Expertise scientifique collective », rapport, CNRS, Ifremer, 2014, 930 p. : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Expertise-scientifique-collective,38968.html

Xing He est un auteur de Science Fiction et membre du comité Science-Fiction de l’Association Nationale des Ecrivains. Il a publié une vingtaine de romans (Les traces magnétiques manquantes), mais aussi des novelas (Rassembler du fer pour forger une erreur) et des recueils de nouvelles (Nœuds du temps et de l’espace). Il a également dirigé des collections éditoriales, comme Les « Sciences-Fictions des nouvelles générations chinoises ». Il a remporté trois fois le Prix Voie Lactée, célèbre prix chinois dans le domaine science-fiction.
La raison et la bonté.
La sincérité.
La douceur.
Être bien intentionné.
La procrastination.
La création littéraire.
Avoir une famille heureuse.
Que ma santé me fasse défaut.
Une personne ordinaire mais heureuse.
La Chine.
Le vert.
La rose.
Le coucou.
John le Carré, romancier anglais.
Li Shangyin.
Luke dans Star Wars.
Quand j’étais jeune, Lin Daiyu (héroïne dans Le Rêve dans le pavillon rouge), maintenant, j’hésite… peut-être Esmeralda.
Beethoven.
Salvador Dali.
Newton.
Hypatie, mathématicienne grecque.
Je n’ai pas de réponse.
Le mensonge. Et ne pas être raisonnable.
Difficile à dire.
Je n’ai pas de réponse.
L’indépendance des Etats-Unis.
Savoir ce à quoi pensent les autres.
Calmement et sereinement.
Un état normal.
Une faute non intentionnelle pour laquelle la personne exprime des regrets après l’avoir commise.
Je n’ai pas de devise.
Les couleurs de la mer
François Bellec

© David Cormier
François Bellec
de l’Académie de marine
Vice-président de la Société de Géographie.
Si notre planète est bleue vue de l’espace, c’est en raison de la diffusion de la lumière solaire dans l’atmosphère, et en grande partie parce que les océans qui en occupent près des trois quarts sont bleus pour la même raison. Les composants visibles de la lumière blanche, (le spectre de l’arc en ciel) sont des rayonnements électromagnétiques de longueurs d’onde différentes, du rouge (750 nanomètres ou 10-9 m) pour les plus longues, au violet (390 nanomètres) pour les plus courtes. Au-delà règnent, hors de la vision humaine, l’infrarouge et l’ultraviolet. La lumière blanche du soleil est en partie réfléchie par la surface de la mer, et en partie réfractée, déviée en traversant le dioptre séparant l’air et l’eau de caractéristiques optiques différentes. Diffusées par les molécules d’eau, les ondes titulaires d’une couleur pure sont absorbées plus ou moins vite. D’abord les fréquences les plus basses, les tons chauds rouge et jaune, qui ne dépassent pas une trentaine mètres, puis les verts à 60. Le plongeur extrême entre alors dans le grand bleu qui se perd dans la nuit abyssale. Parmi d’autres âneries sur la mer, Jules Michelet a énoncé une hypothèse hasardeuse : Si l’on plonge dans la mer à une certaine profondeur, on perd bientôt la lumière ; on entre dans un crépuscule où persiste une seule couleur, un rouge sinistre. (La Mer 1861) Il est vrai qu’en son temps, personne n’y était allé voir.
D’autres facteurs interviennent dans les couleurs de la mer. En particulier sa teneur en particules organiques en suspension. Les eaux riches en phytoplancton introduisent une absorption chlorophyllienne qui fait virer la couleur dominante du bleu au vert. C’est le cas des eaux côtières riches en algues. Ce qui a permis en 1894 au littoral allant du cap Fréhel à Cancale d’ériger sa Côte d’Emeraude en rivale de la Côte d’Azur imaginée en 1887. Il ne faut pas confondre ce phénomène avec la turbidité due aux sédiments fluviaux, qui donne leur couleur ocre aux mers des peintres hollandais et flamands, et qui fait rêver la Home Fleet territoriale britannique des Blue water Navies océaniques. Parmi les appellations touristiques, la Côte d’Albâtre - élégante alternative à une improbable Côte de Craie - honore les falaises du Crétacé supérieur qui dominent littoral du Pays de Caux, et confirme qu’elles se dissolvent à leur pied dans une mer laiteuse.
Un troisième intervenant modifie fortement les couleurs apparentes de la mer : Le ciel qui s’y reflète plus ou moins selon son agitation de surface. Le ciel profond de la Méditerranée, parce que l’air est très peu humide, renforce sa tonalité bleue. Signac, qui l’avait découverte à Saint-Tropez, s’en exprima dans une lettre à Van Gogh : Maintenant que j’ai vu la mer ici, je ressens tout à fait l’importance qu’il y a de rester dans le Midi. […] Notre vert Véronèse et notre bleu de cobalt sont de la […] à côté de ces flots méditerranéens. D’une certaine manière, les Côtes Vermeille et d’Améthyste de nos Pyrénées Orientales relèvent d’une même intensité des couleurs de la Mer intérieure. Les ciels voilés adoucissent au contraire les tons. Ils enjolivent notre littoral des Côtes d’Opale de la frontière belge à la baie de Somme, de Nacre du Calvados à Ouistreham, et de Jade au Pays de Retz en Loire-Atlantique. Pour s’achever en Aquitaine de Royan à Hendaye par une Côte d’Argent applaudie en 1907 par le Congrès national des sociétés de géographie de Bordeaux. Gauguin n’avait jamais rencontré des coloris aussi ténus, aussi délicats, aussi imprenables qu’en Bretagne. Matisse louait sa lumière argentée et ses ciels de nacres, et Boudin en aimait les beaux grands ciels, tout tourmentés de nuages, chiffonnés de couleurs. Roger Chapelet, Peintre officiel de la Marine (1903-1995) voyait d’un œil d’artiste cette alchimie de la lumière : L’Atlantique est d’un bleu foncé, verdâtre en général. Il peut être plus clair, plus foncé ou plus gris. Cela dépend des heures, du temps, des vagues qui prennent plus ou moins du reflet du ciel parce que l’eau est plus ou moins brassée. La mer du Nord est plus grise que l’Atlantique, avec des couleurs très fines par temps calme, dans les bleus, les roses, les mauves. La Méditerranée est vraiment trop bleue. Yukio Mishima avait une explication : Méditerranée, dont l’azur est foncé d’être tellement antique (Madame de Sade Acte III. 1965) Une Méditerranée qu’Homère voyait parfois violette aux abords de l’île du Trident (Odyssée chant XI) mais plus souvent lie de vin :
Pallas aux yeux brillants leur fit hommage d’un bon vent
Un zéphire qui fouettait la mer vineuse. (Odyssée chant II)
Ce qui s’explique puisque, parfait connaisseur de la mer et de la navigation, Homère faisait appareiller Ulysse le soir, quand se lève la brise de terre qui pousse au large dans le soleil couchant.
La mer Noire, la mer Rouge, échappent aux lois de la réfraction pour entrer dans le labyrinthe de la controverse linguistique. Mer indigo des Scythes, axšaēna, interprétée phonétiquement par les Grecs comme « mer hostile aux étrangers », révisée en « mer accueillante » ou Pont Euxin, mer Majeure des Génois, la mer Noire était au XIe siècle, pour les Turcs d’Anatolie, la mer du Nord. Selon une rose géo-chromatique associant le blanc au Sud, le rouge à l’Ouest, le vert à l’Est et le noir au Nord, elle devint la mer Noire. La mer Rouge ne doit rien ni à un littoral rouge au soleil couchant ni à l’algue écarlate Trichodesmium erythraeum. Ni sans doute à la parenté accidentelle entre le roi Erythrus et le grec erythros, rouge. Elle était pour les Hébreux, la mer d’Édom, au fond du golfe d’Aqaba, le royaume tautologique aux rochers rouges des Edomites descendants d’Esaü « le Roux = Edom » petit-fils d’Abraham. La mer rouge était traditionnellement peinte ainsi sur les portulans.
La bibliographie nautique chinoise fait remonter loin dans le temps la pratique d’un cabotage intense. Les routes côtières sont en effet les plus courtes d’un port chinois à un autre, le long d’un littoral convexe, comme elles l’étaient aux contours de la géode constituée par les cités cristallisées tout autour de la Méditerranée antique. L’espace maritime chinois exigeait un sens marin exemplaire pour maîtriser des eaux dont les traîtrises météorologiques et hydrographiques étaient innombrables. Les plus anciennes informations sur la navigation dans les mers de Chine sont le plus souvent des relations de voyages. Le Meng Xi bitan (Recueil des propos de l’étang des rêves) de Shen Kuo, un mathématicien, physicien et cartographe, constatait vers 1080 : En haute mer il ne tombe pas de pluie ; s’il pleut, c’est que la terre est proche. Ce qui est inexact, s’il est vrai que les hauteurs littorales dévient verticalement les vents humides qui se condensent en pluie, mais Shen Kuo était assez visionnaire pour avoir tenté d’enrayer la déforestation en suggérant l’alternative de brûler du naphte. Le Xuanhe fengshi Gaoli tujing, est un rapport d’une mission en Corée de Xujing vers 1122. Il offre une description détaillée du littoral de la Chine orientale dans le style des livres portulans européens. Xujing décrivit avec beaucoup de poésie tout au long de son itinéraire vers la Corée, l’océan des Eaux blanches, Baishuiyang au vent instable ; Huangshuiyang, l’océan des Eaux jaunes, au large de l’embouchure du Huáng Hé (le fleuve Jaune), dont les eaux sont troubles et peu profondes et à l’entrée duquel on offrait poulets et millet en sacrifice aux âmes des péris en mer ; Heishuiyang, l’océan des Eaux noires. Ses profondeurs sont abyssales, et il est d’un noir d’encre absolu. En le voyant, certains défaillent de terreur. Des vagues furieuses et écumantes se chevauchent, et quand vient la nuit, on voit briller parmi elles des lueurs comme autant de feux [1] [...] Partout alentour, les vagues sont tellement hautes qu’elles cachent le ciel. [...] On s’effondre en vomissant. Il décrivait enfin, autour de Banyangjiao, un rocher redouté des pilotes, près de Zhudao, l’île aux Bambous, la mer comme un miroir couleur d’émeraude foncée.
Blottie sous la presqu’île de Kola, la mer Blanche a depuis longtemps perdu sa virginité. Marées noires, dégazages sauvages et boues rouges maculent la mer. L’océan souffre, et avec lui sa faune et ses écosystèmes, gangrénés maintenant par des continents étrangers à la vieille tectonique des plaques, monstrueuses mers des Sargasses, agglomérats de matières plastiques aux couleurs tendres comme des installations d’un artiste pervers. Depuis que l'océanographe et skipper américain Charles J. Moore a découvert par hasard en 1997 un amas de déchets plastiques en plein océan Pacifique, médias et scientifiques se divisent comme souvent autour du « septième continent ». Contenues par les mesures de prévention de l’Organisation maritime internationale, les marées d’hydrocarbures surmédiatisées masquent des phénomènes prépondérants : le réchauffement des eaux et leur acidification par absorption de CO2.. S’y’ajoute une plaie de la civilisation globale. À raison d’une centaine de millions de tonnes chaque année, la terre se débarrasse en mer de ses déchets plastiques très partiellement collectés et recyclés. Les chiffre s’envolent. Great Pacific Garbage Patch (la grande plaque de déchets du Pacifique) flottant entre Hawaï et le Japon, serait une catastrophe écologique mesurant 3,43 millions de km² soit l’équivalent d’un tiers de l’Europe. Pourquoi ne voit-on pas, depuis l’espace, cet immense reg de synthèse, cette île errante aux dimensions d’un continent ?
La concentration de débris flottants est un effet naturel de la circulation océanique générale et de la rotation de la Terre. De vastes boucles subtropicales tournent dans le sens des aiguilles d’une montre dans l’Atlantique nord et le Pacifique nord, en sens inverse dans l’hémisphère sud. Ces vortex que l’on nomme gyres océaniques entraînent lentement vers leur centre tout ce qui flotte en surface ou entre deux eaux, inexorablement mais sur une échelle de temps de l’ordre du quart de siècle. Ce qui laisse aux déchets plastiques le temps de changer d’état. La quantité totale des déchets flottant sur les océans est estimée à seulement 1 % de leurs rejets annuels. Les champs d’épaves plastiques ne sont pas à photographier dans les gyres subtropicales, mais sur le littoral, sur lequel 5% s’échouent et désolent les opérateurs touristiques. Ou lors de concentrations qui relèvent de conjonctions géographiques et océanographiques locales, ou encore d’accidents spectaculaires. Près de 95% des déchets s’immergent chaque année, ce qui nettoie la surface mais ne supprime pas les nuisances. La seconde raison de la dissipation des poubelles marines est leur émiettement. Sous l’effet des frottements et du rayonnement solaire, le plastique réputé imputrescible se dégrade plus ou moins vite, se rompt en fragments de quelques centimètres, puis en microparticules dont la taille varie du millimètre jusqu’au micron – parmi lesquelles on trouve des fibres textiles synthétiques issues du lavage de vêtements. Encore que leur toxicité réelle soit contestée en raison de leur faible concentration, ces microparticules constituent une véritable menace. Pénétrant le plancton et l’écosystème, elles sont ingérées par les espèces marines avec des conséquences sur leur développement et leur population. On ne peut envisager leur dépollution sans détruire la microflore et la microfaune dans leur environnement. C’est paradoxalement pour cela que le septième continent, qui n’est en réalité qu’une trainée de poussière, a une redoutable capacité de nuisance écologique.
Depuis l’espace et aux yeux des poètes, la Terre qui en a vu d’autres restera la planète bleue jusqu’à la nuit des temps.
[1] Ces lueurs froides qui peuvent être très vives, sont causées par les noctiluques, des protozoaires microscopiques, dont la bioluminescence est excitée par l’agitation de la mer, en particulier par le sillage des navires.
Le droit de la mer : approche zonale et fonctionnelle
de Patrick Chaumette

© DR
Patrick Chaumette est professeur émérite au Centre de Droit Maritime et Océanique (CDMO) de l’université de Nantes. Ses recherches portent sur le droit social international, européen et français, le droit social des gens de mer, puis le droit maritime et le droit de l’océan. Il est l’auteur de nombreuses publications et a récemment dirigé ou coordonné les ouvrages Gens de mer : un marché international du travail (Bilbao, Gomylex, 2016 - halshs-01469625) ; Espaces marins : surveillance et prévention des trafics illicites en mer (Bilbao, Gomylex, 2016 - hal-01525298), Challenge économique et maîtrise des nouveaux risques maritimes : quelle croissance bleue ? (Bilbao, Gomylex, 2017 - hal-01793050) ; Estudio Técnico-Jurídico del Convenio 188 sobre el Trabajo de la Pesca (2007) de la Organización Internacional del Trabajo (avec O. Fotinopoulou-Basurko et Xose Manuel Carril Vasquez, Pampelune, Aranzadi, 2018) ; Richesses et misères des océans. Conservation, ressources et frontières (Bilbao, Gomylex, 2018 - hal-01984841) ; et Le droit de l’océan transformé par l’exigence de conservation de l’environnement marin (Madrid, Marcial Pons, 2019 - halshs-02395852), Droits Maritimes (Paris, Dalloz Action, 4ème édition, 2021, 1910p.).
1 - Définition et origines du droit de la mer
Définition du droit de la mer
Le droit de la mer comprend l’ensemble des règles de droit international relatives à la détermination et au statut de l’océan (surface, volume et fonds marins) et au régime des activités intervenant dans ce milieu marin. Le droit de la mer est une branche du droit international public et désigne les rapports entre les États. Depuis 1945, ce droit international est adopté dans le cadre de l’Organisation des Nations unies (ONU). Au sens du droit international, les espaces marins sont les étendues d’eau salée, en communication libre et naturelle (mer Méditerranée, océans Atlantique, Indien, Pacifique, etc.). Sont exclues les eaux douces (lacs) et les mers intérieures (comme la mer Morte, la mer d’Aral ou encore la mer Caspienne), même bordées par plusieurs États riverains. L’océan recouvre 71 % de la surface du globe, soit 361 millions de km2, et représente 98% des ressources en eau de la planète avec ses 1,33 milliards de km3 d’eau. Les activités en mer sont réglementées dans le cadre de l’Organisation internationale du travail (OIT), de l’Organisation maritime internationale (OMI) ou de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Ce droit maritime international est de moins en moins séparable du droit de la mer, le statut des espaces et le droit des activités se complétant, dans le respect de l’environnement marin, devenu objectif incontournable, et non pas simple contrainte.
2 - L’approche zonale du droit de la mer
Du fait de l'extension des compétences étatiques vers le large, consacrée dans le droit de la mer, les espaces maritimes se trouvent aujourd'hui « fractionnés » en différentes zones, qui ont chacune leur propre régime juridique, puisqu'aucun statut d'ensemble n’a pu être trouvé pour l’océan.
Concrètement, ces zones sont délimitées en fonction de leur éloignement des côtes. Telles que représentées sur les schémas ci-dessous, ces zones comprennent notamment : les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive (ZEE), le plateau continental, la haute mer et la zone internationale des fonds marins.
Délimitation à partir des lignes de base
Les limites de ces zones maritimes sont mesurées à partir des lignes de base de l'État côtier. Il existe deux méthodes principales pour déterminer ces lignes de bases, qui peuvent être combinées.
La ligne de base « normale » est la « laisse de basse mer le long de la côte », telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines « à grande échelle » de l’État côtier. La ligne de base normale est un tracé artificiel qui correspond, en principe, à la ligne marquée par les plus basses marées. Elle correspond donc à la limite des zones toujours couvertes par la mer, quelle que soit la marée. Dans certains cas, la configuration des côtes ne permet pas (ou difficilement) d'appliquer la méthode normale, par exemple du fait de la présence d'îles proches du littoral, d’une côte très découpée, comme la côte bretonne ou la côte norvégienne avec ses fjords. La laisse de basse mer peut alors être remplacée par des lignes de base droites. Cette méthode consiste à tracer des lignes droites (des segments), reliant les reliefs les plus marqués vers le large, voire certains îlots et récifs.
PENSER%20L%E2%80%99%C3%89COLOGIE%20%233/640.png)
Source : J. P. Beurier [Dir.], Droits maritimes, Dalloz Action, Paris, 3ème éd. 2015-2016, p. 95.
PENSER%20L%E2%80%99%C3%89COLOGIE%20%233/640-1.png)
Source : J. P. Beurier [Dir.], Droits maritimes, Dalloz Action, Paris, 3ème éd. 2015-2016, p. 83
Les espaces maritimes sous souveraineté de l’État côtier
Dans les espaces marins adjacents au territoire, l’État exerce sa souveraineté : « la terre domine la mer, pour se protéger » ; cette fiction de territorialité reconnaît des droits aux États tiers. Ces espaces marins sont les eaux intérieures, la mer territoriale.
Les eaux maritimes intérieures sont adjacentes au territoire terrestre, entre la laisse de basse mer et les lignes de base servant au calcul de la largeur de la mer territoriale, c’est-à-dire les eaux des ports et de leurs voies d’accès, les estuaires, les baies, havres et rades, ainsi que le sol et le sous-sol, l’air surjacent des eaux intérieures.
L’expression « mer territoriale » provient de la conférence de La Haye de 1930. La CNUDM de 1982 a uniformisé sa largeur à 12 milles nautiques (22,224 km), à partir de la ligne de base. La souveraineté de l’État riverain s’étend au-delà de son territoire terrestre et de ses eaux intérieures, dans sa mer territoriale. Les lois de police et de sûreté s’appliquent aux navires civils étrangers, qui bénéficient du droit de passage inoffensif (art. 17 à 32 CNUDM). On distingue les passages d’entrée et de sortie et le passage latéral. Le passage cesse d’être inoffensif si le navire porte atteinte à la sécurité, l’ordre public, aux intérêts fiscaux ou commerciaux de l’État riverain (art. 19 et 21). L’État riverain peut réglementer la navigation, mais sans discrimination. Il fixe les règles de l’exploration et de l’exploitation des ressources de sa mer territoriale.
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer comporte des dispositions particulières concernant les baies, les détroits, les îles et les archipels.
Les espaces maritimes où l’État côtier n’exerce que des compétences limitées
La zone contigüe, de 12 milles nautiques au-delà de la mer territoriale, est d’origine douanière, liée à la lutte contre la contrebande. Depuis que la mer territoriale a été portée à 12 milles, même si elle la double, cette zone a perdu de sa portée. Elle chevauche la zone économique exclusive (ZEE) et constitue une aire d’extension de compétences finalisées non économiques de l’État riverain : pouvoirs de police en matière douanière, fiscale, sanitaire et d’immigration (art. 33 CNUDM). L’État riverain peut prévenir et réprimer les infractions commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale, à l’encontre des lois de polices des domaines visés, et exercer un droit de poursuite. Il s’agit donc d’une zone de répression d’infractions survenues géographiquement en deçà.
Dans la zone économique exclusive (ZEE), l’État riverain détient des droits souverains et supporte des obligations quant à la protection de l’environnement marin ; il s’agit d’une zone sous juridiction, non d’une zone de souveraineté. L’État riverain peut réglementer la pêche et devrait fixer des taux autorisés de capture (TAC) et en contrôler l’usage, pour éviter la surpêche.
Les États doivent, dans leur territoire marin ou les eaux maritimes sous leur juridiction (ZEE), prévenir, réduire et maîtriser la pollution provenant de diverses sources, activités terrestres, navigation, exploitations gazières ou pétrolières offshore, exploitation des ressources minérales. Des conventions régionales, dotées de protocoles sectoriels, ont précisé ces obligations et adapté les principes généraux aux diversités régionales.
Le plateau continental s’étend juridiquement à partir des lignes de base jusqu’au rebord externe du plateau continental ou jusqu’à 200 milles marins (soit 370,4 km), même s’il n’y a pas de plateau continental géologique, naturel. Il peut être étendu juridiquement jusqu’au rebord externe de la marge continentale, si le plateau continental naturel, géologique, excède les 200 milles marins, c'est-à-dire là où tout plateau continental cesse géologiquement ; en tout état de cause, l’extension du plateau continental juridique ne peut s’étendre au-delà d’une limite maximale : soit 350 milles marins à partir des lignes de base (648,2 km), soit 100 milles marins (185,2 km) au-delà de l’isobathe 2 500 mètres (c’est-à-dire la ligne reliant les points d’une profondeur de 2 500 m). L’État riverain est libre de choisir entre le critère de distance et le critère de profondeur celui qui lui est le plus favorable. L’extension du plateau continental nécessite une connaissance scientifique des fonds marins et une procédure déclarative auprès de la Commission de délimitation du plateau continental (CLPC, siégeant aux Nations Unies, à New York).
PENSER%20L%E2%80%99%C3%89COLOGIE%20%233/640-2.png)
Principe d'extension juridique du plateau continental : la ligne de référence est le pied de talus continental, l'extension est limitée à 350 milles des lignes de base, sauf circonstances particulières
©Ifremer https://www.extraplac.fr/
Le régime juridique du plateau continental ne concerne que le fond et le sous-sol au-delà de la mer territoriale. L’État côtier dispose de droits souverains relatifs à l’exploitation et l’exploration des ressources naturelles du plateau continental, ce qui porte sur les fonds marins et leur sous-sol (gaz et pétrole offshore, « au large »), à l’exclusion des eaux marines surjacentes.
PENSER%20L%E2%80%99%C3%89COLOGIE%20%233/640-3.png)
Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) 2005
www.extraplac.fr/FR/juridique
Les espaces maritimes internationalisés
La haute mer se situe au large, au-delà des zones économiques exclusives des États côtiers. Elle est l’espace des libertés : liberté de navigation, liberté de survol, liberté de pose des conduites et câbles sous-marins, liberté de construction d’îles artificielles ou d’installations, liberté de pêche, liberté de la recherche scientifique (art. 87 CNUDM). Tous les États peuvent faire naviguer en haute mer les navires arborant leur pavillon, dans le respect du droit international ; chacun doit exercer effectivement sa juridiction et son contrôle administratif, technique et social sur les navires auxquels il accorde son pavillon (art. 94 CNUDM). En cas d’abordage, la convention sur le droit de la mer a ajouté à la compétence de l’État du pavillon, celle de l’État dont le marin a la nationalité (art. 97 CNUDM). Le lien substantiel entre le navire et l’État d’immatriculation reste peu précisé et nullement sanctionné en cas d’absence. Il existe quelques exceptions à la compétence exclusive de l’État du pavillon en haute mer, permettant l’exercice d’un droit de visite sur un navire étranger : en cas de piraterie, d’absence de nationalité ou de dissimulation du pavillon, de transports d’esclaves.
La liberté de navigation s’applique aussi dans les ZEE des États côtiers, dans le respect de l’environnement marin ; elle intervient également dans le cadre du droit de passage inoffensif pour les navires civils, en mer territoriale et dans les eaux intérieures des États côtiers, car les navires doivent atteindre un port. Le régime des navires de guerre est différent en mer territoriale et dans les eaux intérieures des États côtiers ; ils ne peuvent naviguer qu’avec l’autorisation des autorités de l’État côtier.
Il existe en haute mer des obligations de coopération imposées aux États : lutte contre le trafic illicite de stupéfiants ; lutte contre le trafic d’êtres humains ; lutte contre la pollution marine ; conservation et gestion des ressources biologiques.
PENSER%20L%E2%80%99%C3%89COLOGIE%20%233/640-4.png)
La terre en blanc, les ZEE en bleu clair, la haute mer en bleu foncé.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_mer
La zone internationale des fonds marins (appelée la « Zone ») est constituée par les fonds marins, au-delà des plateaux continentaux, et extensions du plateau continental des États riverains. Elle commence là où sombrent les plateaux continentaux. La convention de Montego Bay consacre le principe adopté en 1970 : la Zone échappe à toute appropriation ; « bien commun », elle fait partie du patrimoine commun de l’humanité, avec les corps célestes ; elle doit être utilisée à des fins exclusivement pacifiques et exploitée dans l’intérêt de l’humanité tout entière (art. 133 CNUDM). Si l’appropriation nationale des ressources de la Zone est interdite, la convention instaure un régime d’appropriation collective à travers l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM). Sous la pression des pays les plus industrialisés, l’accord du 28 juillet 1994 a remanié la partie XI de la convention modifiant le gouvernement de l’AIFM et en faveur de l’investissement privé. Depuis 2000, l’Autorité élabore un code minier ; elle a adopté en 2013 des recommandations pour la conservation de l’environnement marin. En 2011, le Tribunal international du droit de la mer a précisé les responsabilités des États concernés. Huit États dont la France ont obtenu de l'Autorité des contrats d'exploration dans la Zone.
Conclusion : l’approche fonctionnelle nécessaire.
La convention de 1982 a créé un dégradé juridique au fur et à mesure de l’éloignement de la côte, allant de la souveraineté de l’État riverain, à l’exercice de compétences finalisées et exclusives par l’État riverain (ZEE), jusqu’à la haute mer internationalisée. La protection de l’environnement marin est devenue une priorité, et non plus simplement une contrainte, de sorte que les prérogatives des États leur imposent des coopérations et des obligations, que le changement climatique accentue fortement.
Un traité sur la protection de la biodiversité en haute mer, au-delà des zones sous juridictions nationales (traité dit BBNJ pour biodiversity of areas beyond national jurisdiction) est en préparation à New-York aux Nations Unies ; la cinquième session de la conférence intergouvernementale en août 2022 a avancé sur un avant-projet. Les premières discussions sur ce sujet ont eu lieu en 2004 dans le cadre de la préparation de la résolution adoptée chaque année depuis 1993 sur le droit de la mer par l’Assemblée générale des Nations Unies. Un groupe de travail s’est réuni à neuf reprises, de février 2006 à janvier 2015. Ses recommandations ont conduit l’Assemblée Générale à convoquer une conférence intergouvernementale visant à élaborer un instrument juridique international contraignant dans le cadre de la CNUDM. Quatre thèmes sont en discussion : les outils de gestion par zone (area-based management tools), dont notamment les aires marines protégées, les études d’impact environnemental, le renforcement des capacités et le transfert de technologie, les ressources génétiques marines.
Septembre 2022
Bibliographie
V. BORÉ-EVENO, « Droit International de la Mer », in P. CHAUMETTE (dir.), Droits Maritimes, Dalloz Action, Paris, 4ème édition, 2021, pp. 57-215.
Ph. VINCENT, Droit de la Mer, Collection de Droit International, Bruylant, Bruxelles, 2020.
J. ROCHETTE, « Gouvernance mondiale de l’océan : un cadre fragmenté », in A. EUZEN, Fr. GAILL, D. LACROIX & Ph. CURY, L’océan à découvert, Éd. CNRS, Paris, 2017, pp. 252-253.
C. GLINEUR (dir.), L’Etat et la mer : approches historiques et juridiques, Coll. « Les hommes et la mer », Presses universitaires de Rouen et du Havre (PURH), 2015.
Extraplac – Programme français d’extension du plateau continental https://www.extraplac.fr/
Portail national des limites maritimes https://limitesmaritimes.gouv.fr/
Cartothèque : https://limitesmaritimes.gouv.fr/ressources/cartotheque
Geoconfluences -ENS Lyon, 2002 – « Frontières, zonages et délimitations maritimes : principes internationaux », http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/frontier/popup/ZEE.htm/@@aws-content-pdfbook
P. CHAUMETTE, « Sensibilisation au système océanique », Neptunus, e.revue, Université de Nantes, vol. 24, 2018/ 1 www.cdmo.univ-nantes.fr
M. MORIN, « BBNJ : It’s a long way to …? », texte en français, Neptunus, e.revue, Université de Nantes, Vol. 28, 2022/2 www.cdmo.univ-nantes.fr
Bibliographie sélective de l’auteur
Gens de mer : un marché international du travail (Bilbao, Gomylex, 2016 - halshs-01469625)
Espaces marins : surveillance et prévention des trafics illicites en mer (Bilbao, Gomylex, 2016 - hal-01525298)
Challenge économique et maîtrise des nouveaux risques maritimes : quelle croissance bleue ? (Bilbao, Gomylex, 2017 - hal-01793050)
Estudio Técnico-Jurídico del Convenio 188 sobre el Trabajo de la Pesca (2007) de la Organización Internacional del Trabajo (avec O. Fotinopoulou-Basurko et Xose Manuel Carril Vasquez, Pampelune, Aranzadi, 2018)
Richesses et misères des océans. Conservation, ressources et frontières (Bilbao, Gomylex, 2018 - hal-01984841)
Le droit de l’océan transformé par l’exigence de conservation de l’environnement marin (Madrid, Marcial Pons, 2019 - halshs-02395852)
Droits Maritimes (Paris, Dalloz Action, 4ème édition, 2021, 1910p.)
{"preview_thumbnail":"/wp-content/uploads/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/XNTkyMTAwNzU4OA%3D%3D.jpg?itok=eYm48IJO","video_url":"https://v.youku.com/v_show/id_XNTkyMTAwNzU4OA==.html","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":1},"settings_summary":["Embedded Video (Adaptatif, autoplaying)."]}
Huang Xuan, né à Lanzhou en 1985 et diplômé de l’académie de danse à Pékin, est un acteur chinois. Il a débuté sa carrière d’acteur en 2007, en jouant le rôle principal du film The Shaft. En 2014, Huang Xuan a remporté le prix du meilleur acteur au 15e Festival du film de Las Palmas et le prix du nouvel acteur au 10e Forum vidéo de la jeunesse chinoise pour son film Blind Massage. De plus, les séries télévisées dans lesquelles il joue le rôle principal - telles que Red Sorghum, Légende de Mi Yue, Les Interprètes, Minning Town, et bien d’autres - ont obtenu un grand succès. En 2021, il a été nominé pour le prix Magnolia du meilleur acteur pour sa série télévisée Minning Town. Dans la même année, Huang Xuan a remporté le Golden Crane Award du meilleur acteur au 34e Festival international du film de Tokyo en jouant l’un des rôles principaux dans le film 1921.
Dès le début de sa carrière, Huang Xuan s’engage très activement pour défendre des causes humanitaires et des œuvres caritatives. Il a été parrain du programme national de Lutte contre le tabagisme et de SEE (Society of Entrepreneurs & Ecology) pour promouvoir la protection de l’environnement et a également parrainé le projet Love Cinema-Barrier-Free Movie Viewing, ayant pour objectif d’aider les personnes malvoyantes à entrer dans les cinémas. Il a participé au projet d'aide sociale Poverty Alleviation- Starlight Action. Depuis 2017, il est parrain de Wild Aid et s'est exprimé à plusieurs reprises pour sensibiliser à la protection de la biodiversité. Pour la journée mondiale de l'océan du 8 juin 2022, il a effectué le doublage en chinois de la vidéo réalisée par WildAid, intitulée Making the promise of Marine Protected Areas Real, diffusée largement en ligne et sur les réseaux chinois.
(Re)penser l’écologie #3

© Philippe Matsas 2019
Jamais l’humanité n’a été confronté à de tels risques mais jamais elle n’a été autant en capacité d’y faire face. A nous de décider. Regardant la majesté des mers, la beauté d’un albatros ou d’une baleine, je ressens aussi l’immense fierté à participer à ce combat pour les océans et pour la vie. Puisque nous sommes tous et partout une partie du problème, ne serait-il pas possible d’être tous et partout une partie de la solution ?

Faut-il encore démontrer l’impact du changement climatique sur nos vies quotidiennes ? Sécheresses, feux de forêt, inondations… Les épisodes climatiques extrêmes que nous avons eu à déplorer cette année sur tous les continents sont une nouvelle et triste preuve des conséquences directes et tangibles du changement climatique que nous mesurons scientifiquement depuis plusieurs décennies déjà.
C’est un défi que nous devons relever ensemble. La France continue d’y travailler avec détermination, en coopération étroite avec la Chine. C’est dans cet état d’esprit que le Mois franco-chinois de l’environnement (MFCE) œuvre, année après année, à la prise de conscience et à la mobilisation collective.
{"preview_thumbnail":"/wp-content/uploads/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/XNTkxNTMzNTEwMA%3D%3D.jpg?itok=hXg-l-oT","video_url":"https://v.youku.com/v_show/id_XNTkxNTMzNTEwMA==.html?spm=a1z3jc.11711052.0.0&isextonly=1","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":1},"settings_summary":["Embedded Video (Adaptatif, autoplaying)."]}
Le 4 novembre, la 9e édition du MFCE a été lancée à l’ambassade de France en Chine. Dédiée à « la planète bleue », son objectif est multiple : présenter au public les merveilles de notre planète, alerter sur les nombreuses dégradations qu’elle subit, informer sur les mécanismes de protection à mettre en œuvre, pousser à une réflexion sur les actions, même les plus modestes, que chacun pourrait mettre en œuvre pour contribuer à préserver un environnement sain et durable.




Cette année, le MFCE est soutenu par l’acteur Huang Xuan. Comédien de talent, engagé pour des causes humanitaires et environnementales, Huang Xuan n’hésite pas à prendre la parole pour sensibiliser à la protection de la biodiversité et porter des campagnes environnementales en Chine et au niveau international.

Huang Xuan
Parrain du festival

Créé en automne 2014, le MFCE propose une programmation pluridisciplinaire originale, qui s’adresse à tous, acteurs publics, entreprises, société civile, et grand public, pour trouver ensemble des solutions adaptées aux défis de notre temps. Durant tout le mois de novembre, auront lieu dans toute la Chine des conférences scientifiques ou pédagogiques, des expositions, projections, ateliers ou même marchés.

Conférence
11.08 Pékin

Conférence et concours
11.05 Pékin
11.17 Shanghai

Publication
(Re)penser l’écologie 3 : La Planète bleue
Novembre. Faguowenhua et NetEase News

Conférence et rencontre
Milieux aquacoles et alimentation durable
11.17 Pékin

Conférence et rencontre
Agir ensemble pour sauver la planète
Trois rendez-vous internationaux majeurs auront lieu en cette fin d’année 2022 : la COP 14 Ramsar sur les zones humides, la COP 15 sur la biodiversité ainsi que la COP 27 sur le changement climatique. Dans ce contexte, une rencontre mêlant des chercheurs, des étudiants, des entreprises ainsi que des associations est organisée à Kunming pour débattre autour du thème « Agir ensemble pour sauver la planète ». Ce moment d’échange privilégié permettra de partager l’engagement de chacun pour la protection de notre planète bleue.
11.05 Kunming

Conférence et rencontre
Urbanisme durable à Wuhan
11.14 Wuhan
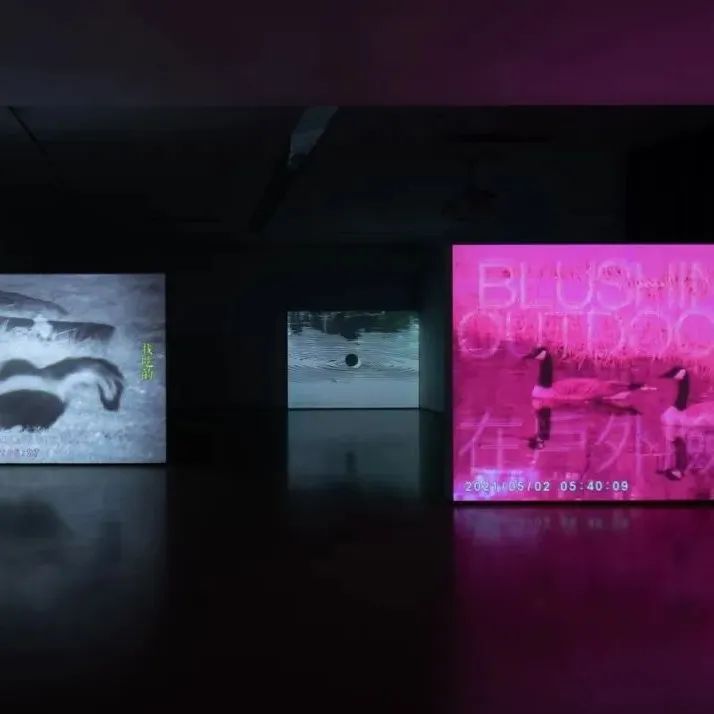
Arts visuels
Prix de la Fondation Choi pour l’art contemporain : 2e édition
11.22 Pékin
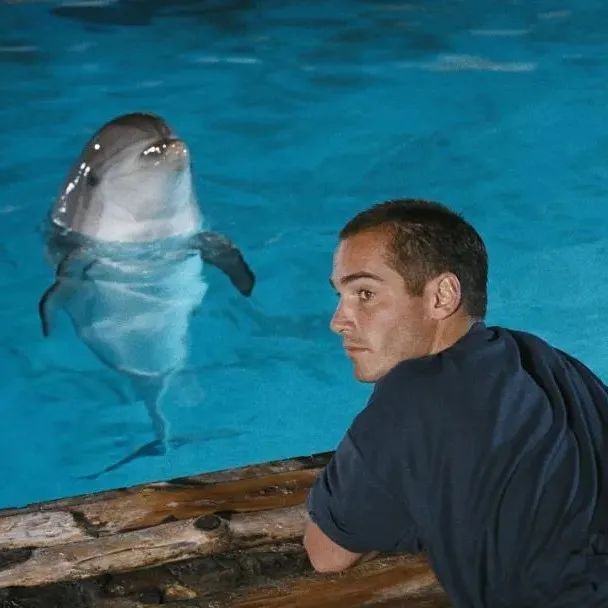
Cinéma
La planète bleue sous l’œil du 7e art
Le 7e art s’est toujours inspiré des océans et des milieux aquatiques. Le regard des cinéastes et des documentaristes sur la crise écologique que nous traversons éclaire sur ses enjeux et alerte sur l’importance de la protection de notre planète bleue. Quatre fictions et une sélection de documentaires vous sont proposées pami lesquels figure le film culte Le Grand Bleu de Luc Besson et le thriller environnemental Goliath.
Novembre. Toute la Chine

Exposition
Voyage au cœur des récifs coralliens
Célébrant la beauté des récifs coralliens avec de magnifiques photos, cette exposition scientifique met en avant leur place essentielle dans le milieu marin. Venez y découvrir l’étonnante biologie du corail, l’exceptionnelle richesse de la biodiversité que recèlent les récifs, leur rôle de protection des littoraux mais aussi les multiples menaces qui pèsent aujourd’hui sur ces écosystèmes.
Nov. – déc. Toute la Chine

Marché
Novembre. Toute la Chine

Visite
Journée portes ouvertes des fermes écologiques
11.05 Toute la Chine

Atelier
Créer, nettoyer, recycler … à vous de jouer !
Novembre. Toute la Chine


La planète Terre a été identifiée comme la « planète bleue » grâce au développement de l’imagerie spatiale dans les années 60. La diffusion de ces photographies a permis d’affirmer l’omniprésence et l’importance de l’eau dans notre environnement, mais aussi la fragilité de cette ressource. À l’occasion du Mois franco-chinois de l’environnement, l’ambassade de France en Chine a sélectionné plusieurs écrits d’intellectuels français qui pensent notre planète bleue à travers leurs regards de théoriciens, d’historiens ou d’auteurs. Cette petite bibliothèque idéale permettra à ses lecteurs de se familiariser avec les spécificités de la pensée française sur ce sujet grâce aux traductions de textes de figures contemporaines françaises vers le chinois. Durant le mois de novembre, cette série d’articles sera partagée sur nos réseaux avant d’être relayée par notre partenaire média NetEase News.
Référence dans le monde franco-chinois du livre, la 14e édition du Prix Fu Lei de la traduction et de l’édition se déroulera à Pékin le 19 et 20 novembre. Lors de la conférence de presse qui s’est tenue aujourd’hui à l’Institut français à Pékin, Dong Qiang, président du comité d’organisation du Prix Fu Lei, a dévoilé les noms des 10 finalistes.
32 ouvrages étaient en lice cette année pour le Prix Fu Lei, à l’équilibre entre les deux catégories : 16 dans la catégorie « essai » et 16 dans la catégorie « littérature ». Du recueil d’essais esthétiques du cinéaste Éric Rohmer Le Goût de la beauté au roman de David Foenkinos Le Mystère Henri Pick, en passant par Le Temps des cathédrales, chef d’œuvre du grand historien Georges Duby, le Prix Fu Lei illustrera cette année encore la grande diversité de la traduction contemporaine en Chine.

La sélection finale sera assurée par un jury présidé par Yu Zhongxian, traducteur et ancien rédacteur en chef de la revue Shijie Wenxue (Littérature du Monde), et composé de sept membres permanents, de deux lauréats de l’édition 2021 ainsi que des deux invités d’honneur, les écrivains Miao Wei et Chan Koonchung. Les lauréats seront révélés lors de la cérémonie de remise du Prix le 19 novembre au Temple, lieu de culture au cœur des hutongs de Dongcheng, modèle d’alliance entre un lieu patrimonial ancestral et une programmation qui promeut l’art contemporain. Le 20 novembre, des conférences littéraires auront lieu à la célèbre Librairie des langues étrangères de Pékin, sur le point de fermer ses portes pour une réhabilitation de deux années avant une réouverture prévue en 2024. Autant d’occasions pour les lecteurs d’échanger avec les finalistes !
Créé en 2009 à l’initiative de l’ambassade de France en Chine et d’intellectuels chinois francophones représentés par Dong Qiang, professeur de littérature française, auteur et traducteur, le Prix Fu Lei a pour objectif de promouvoir la traduction littéraire et la diffusion de la littérature en langue française en Chine. Depuis sa création, le Prix bénéficie de soutiens de nombreux et prestigieux intellectuels, notamment deux prix Nobel de littérature, J.M.G. Le Clézio et Mo Yan. Décerné dans les catégories « littérature » et « essai », le Prix Fu Lei s’est enrichi en 2013 d’une catégorie « jeune pousse » pour encourager la jeune génération de traducteurs.
La Chine est un marché florissant pour le monde de l’édition française, le mandarin étant pour la 9e année consécutive la première langue de cession pour les éditeurs et auteurs français. En 2021, les droits de publication en mandarin de plus de 2000 livres français ont été acquis par des éditeurs chinois. Ces ouvrages ne peuvent être proposés en Chine que grâce au travail des traducteurs, avec une jeune génération de plus en plus présente. 8 des 10 finalistes de cette édition 2022 sont nés dans les années 1980 ou 1990 !
Les 10 finalistes
Essai
Le Goût de la beauté d’Éric Rohmer
Traduit par Li Shuang
Citic Press / Shanghai EP Books

Cet ouvrage est une sélection des articles critiques les plus importants écrits par Éric Rohmer entre 1948 et 1979, dans des publications aussi différentes que Les Temps modernes, Arts, Combat ou, principalement, les Cahiers du cinéma, dont il fut l’un des principaux critiques depuis sa création, et entre 1957 et 1963 le rédacteur en chef. L’essentiel du cinéma est du côté de son ontologie en tant qu’art et non du côté de la spécificité de son langage. Le cinéma ne consiste pas à dire autrement ce que d’autres arts ont pu dire, mais, avec des moyens qui lui sont propres, il dit aussi autre chose : telle est la thèse qui parcourt l’ensemble de ces écrits, jalonnés par la présence constante des noms de Renoir, Murnau, Hitchcock, Rossellini, Dreyer...
Chronique des indiens Guayaki. Ce que savent les Aché, chasseurs nomades du Paraguay de Pierre Clastres
Traduit par Lu Guiye
Shanghai People’s Publishing House / Horizon Media
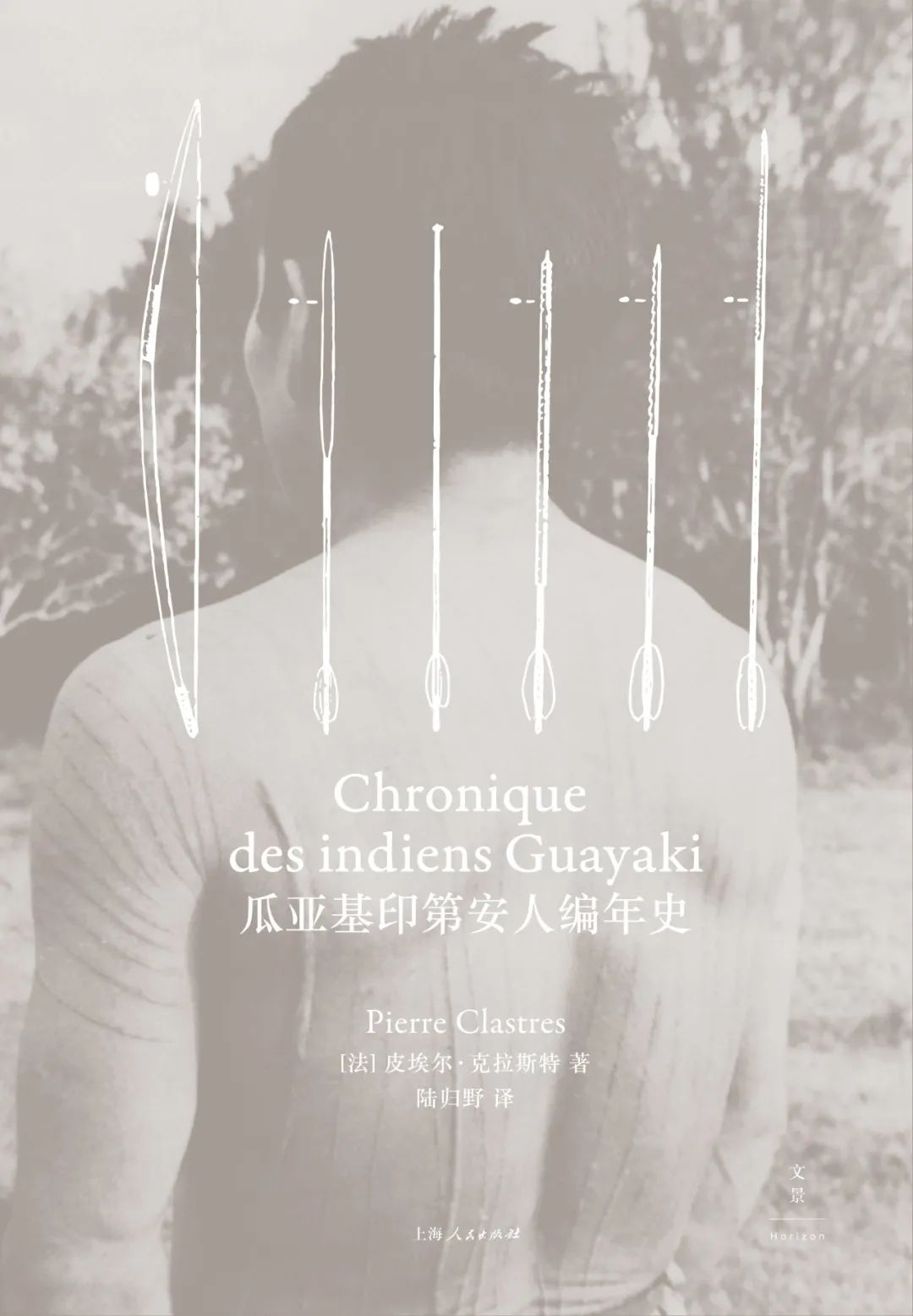
Les Guayaki, Indiens nomades dans les forêts tropicales paraguayennes, ont une langue, des coutumes, des croyances et un système social qui leur sont propres. Depuis le XVIe siècle, leurs territoires sont envahis sans cesse par les colonisateurs occidentaux et les habitants locaux ont dû vivre cachés, se sont battus, et ont fini par être acculés au désespoir. En 1963, l’auteur de ce livre, l’ethnographe Pierre Clastres, est entré dans cette tribu, ses yeux perspicaces observant patiemment. Durant huit mois, il a été témoin de leur vie quotidienne : la naissance et la mort, le manger et la chasse, le mariage et la vengeance, les fêtes et les rites…ainsi que leur plus grand secret : le cannibalisme. Sans aucun préjugé, il a examiné leur comportement pour dévoiler la logique subtile et inconsciente qui s’y cache. Il a gardé vivant, avec un ton juste et personnel, le souvenir de « la gravité de leur présence au monde des choses et au monde des êtres ».
Les Revers de l’amour. Une histoire de la rupture de Sabine Merchior-Bonnet
Traduit par Chen Xiaolin
China Environment Publishing Group
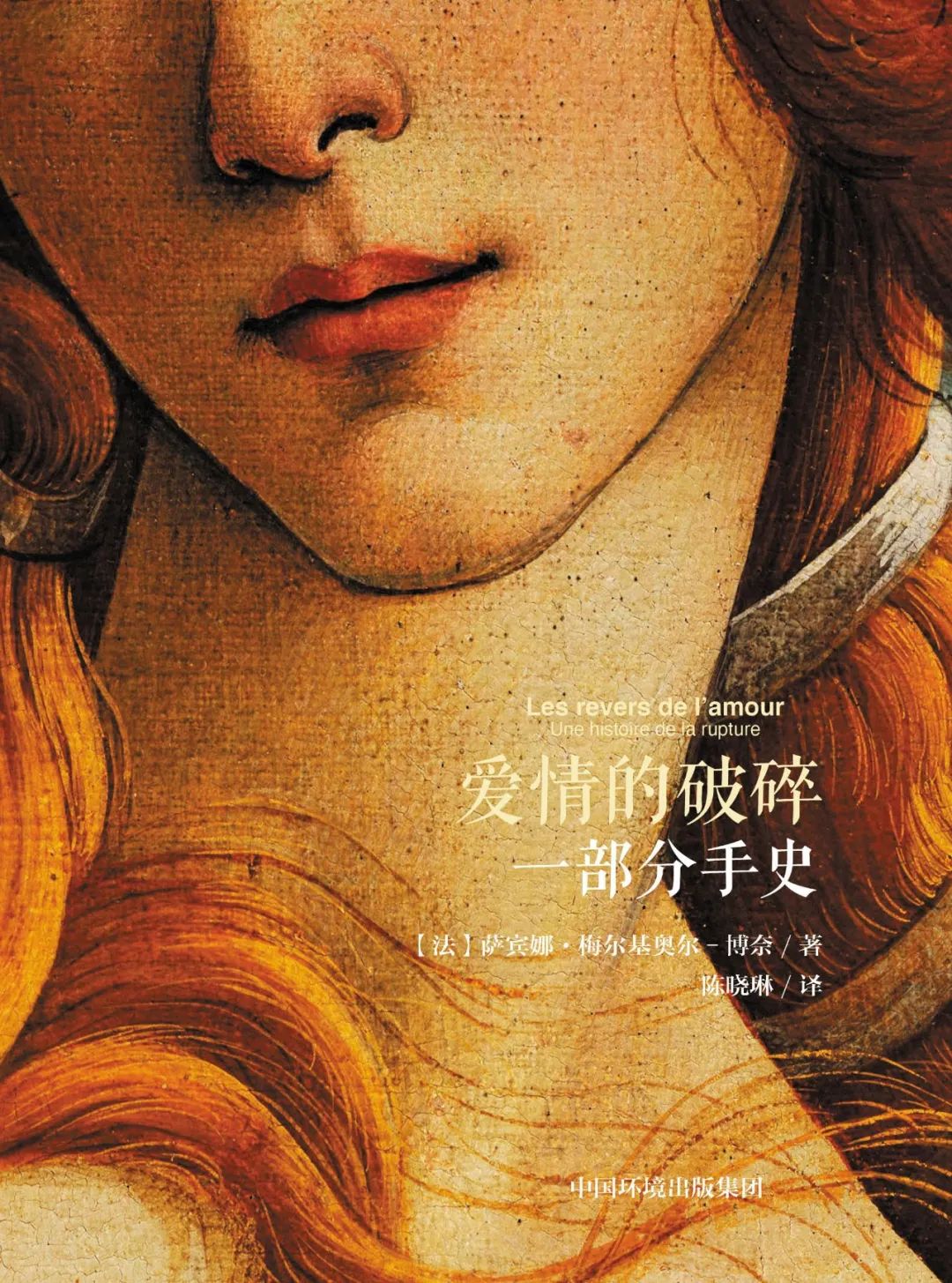
On aurait tout dit de l’amour, et depuis fort longtemps. Pourtant, la rupture amoureuse n’avait pas retenu jusqu’ici l’attention des historiens. Sabine Melchior-Bonnet l’aborde en s’interrogeant sur ce qui fonde l’amour et le désamour, et sur la part que prennent, dans le tragique personnel, les codes de la culture et de la religion, le poids de la morale et l’arsenal des lois.
Le Temps des cathédrales. L’art et la société 980 – 1420 de Georges Duby
Traduit par Gu Xiaoyan
Nanjing University Press
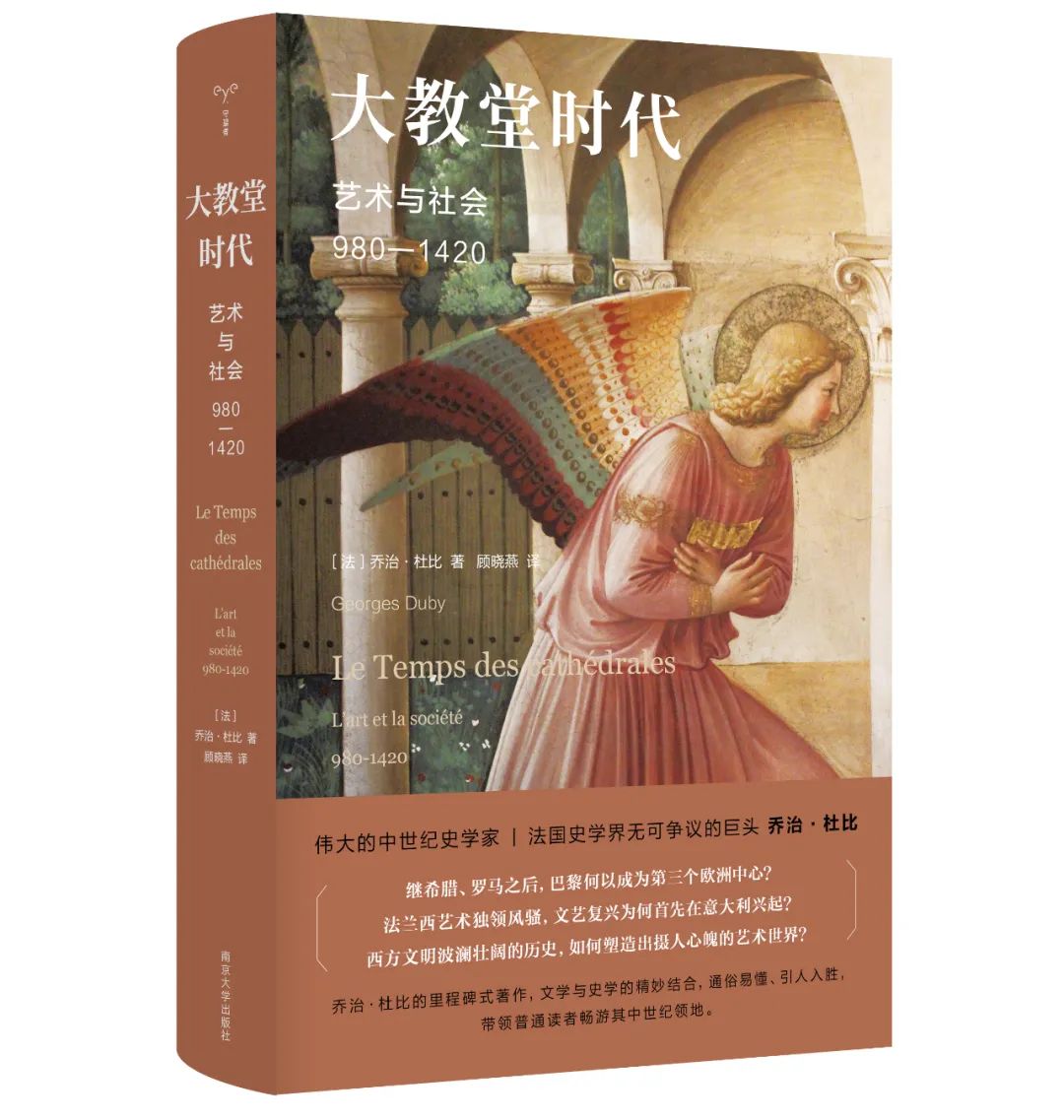
Georges Duby est le premier historien vivant à faire son entrée dans la Pléiade. Il s’est lancé dans la recherche des relations entre la matière et l’esprit. L’histoire des mentalités a pris corps sous la plume du cet auteur à travers ses chefs-d’œuvre dont Le Temps des cathédrales. Il y montre comment, au XIe siècle, ce que nous avons appelé la féodalité est passée des mains des rois à celles des moines, comment, cent ans plus tard, la renaissance urbaine établit la cathédrale au foyer des innovations majeures, comment, au XIVe siècle, l’initiative de l’art monumental revint aux princes et s’ouvrit aux valeurs profanes. Le temps des cathédrales est ainsi encadré, entre celui des monastères et celui des palais. L’influence de cet ouvrage n’a cessé d’être déterminante aux avant-postes de la recherche historique. Auprès du grand public, son succès est considérable.
Les Intellectuels au Moyen Âge de Jacques Le Goff
Traduit par Gao Jianhong
East China Normal University Press
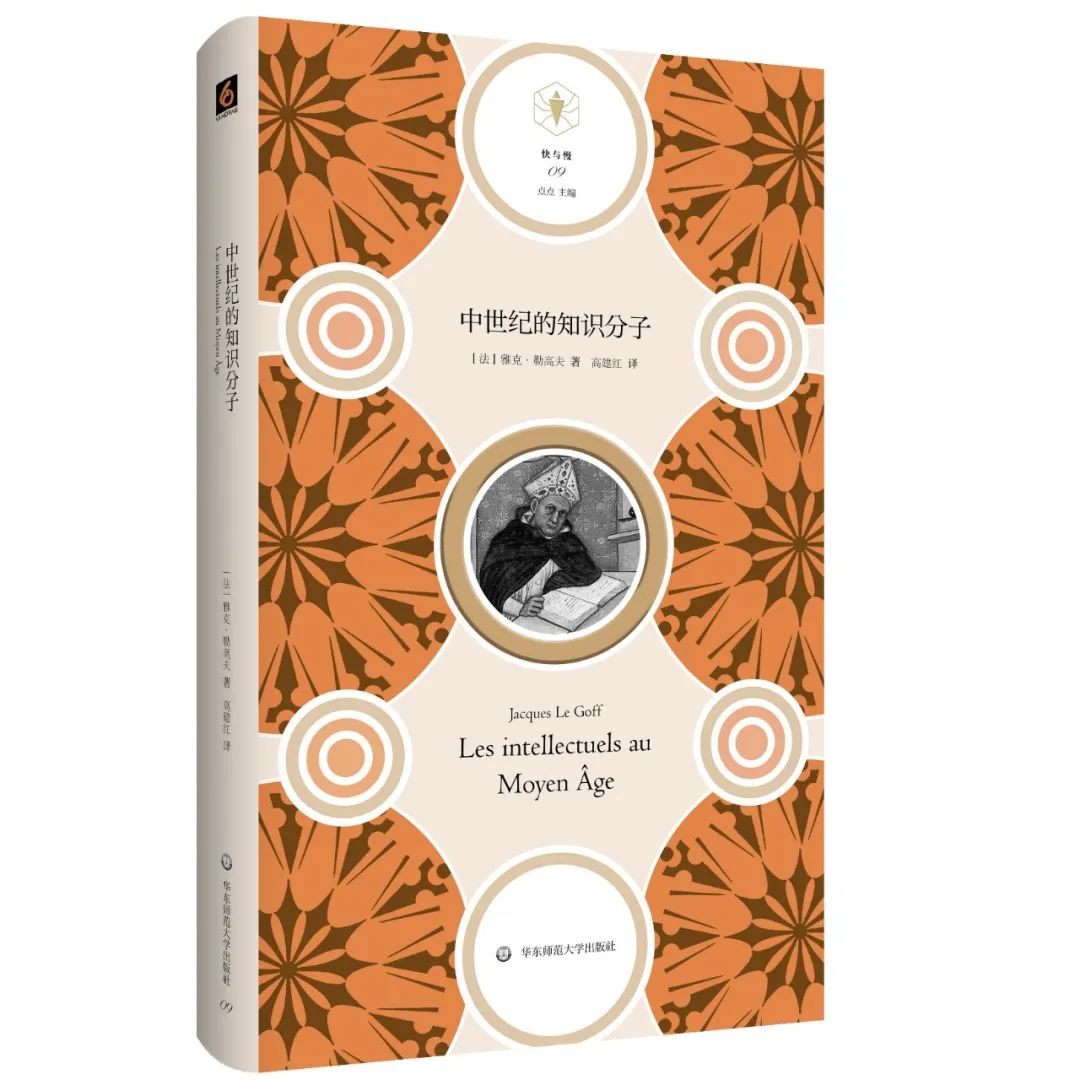
Le clerc, qui ne se confond pas avec le prêtre ou le moine, est le descendant d’une lignée originale dans l’Occident urbain du Moyen Âge : celle des intellectuels. Le mot est moderne, il a l’avantage de désigner à la fois le penseur et l’enseignant, et de ne pas être équivoque. L’enquête de Jacques Le Goff est une introduction à la sociologie historique de l’intellectuel occidental. Mais elle fait aussi la part du singulier et du divers, et devient ainsi une galerie de caractères finement analysés.
Littérature
Le Livre des Limites d’Edmond Jabès
Traduit par Liu Nanqi
Guangxi Normal University Press Group
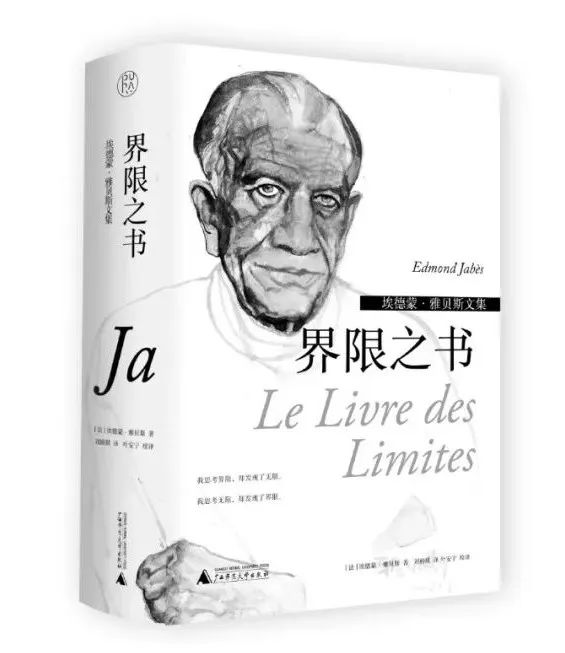
Le Livre des Limites fait partie du cycle du Livre des Questions. Il est divisé en quatre volumes, à savoir Le petit livre de la subversion hors de soupçon, Le Livre du Dialogue, Le Parcours et Le Livre du Partage. Expérience inter-stylistique entre poésie, prose, aphorismes et essais philosophiques, ce livre est autant la réflexion d’Edmond Jabès que son aveu intérieur. En termes de forme, le texte appartient au type de fragmentation, avec une pensée excentrique et un style singulier ; en termes de contenu, il se concentre sur la réflexion et la recherche de l’essence de l’existence humaine, avec une profondeur idéologique et une perspicacité philosophique. Ce livre relate la quête d’Edmond Jabès pour l’indicible et montre ses luttes avec son auto-subjectivité, son identité et son acte d’écriture dans le processus.
Le Mystère Henri Pick de David Foenkinos
Traduit par Lyu Ruyu
Shanghai Translation Publishing House
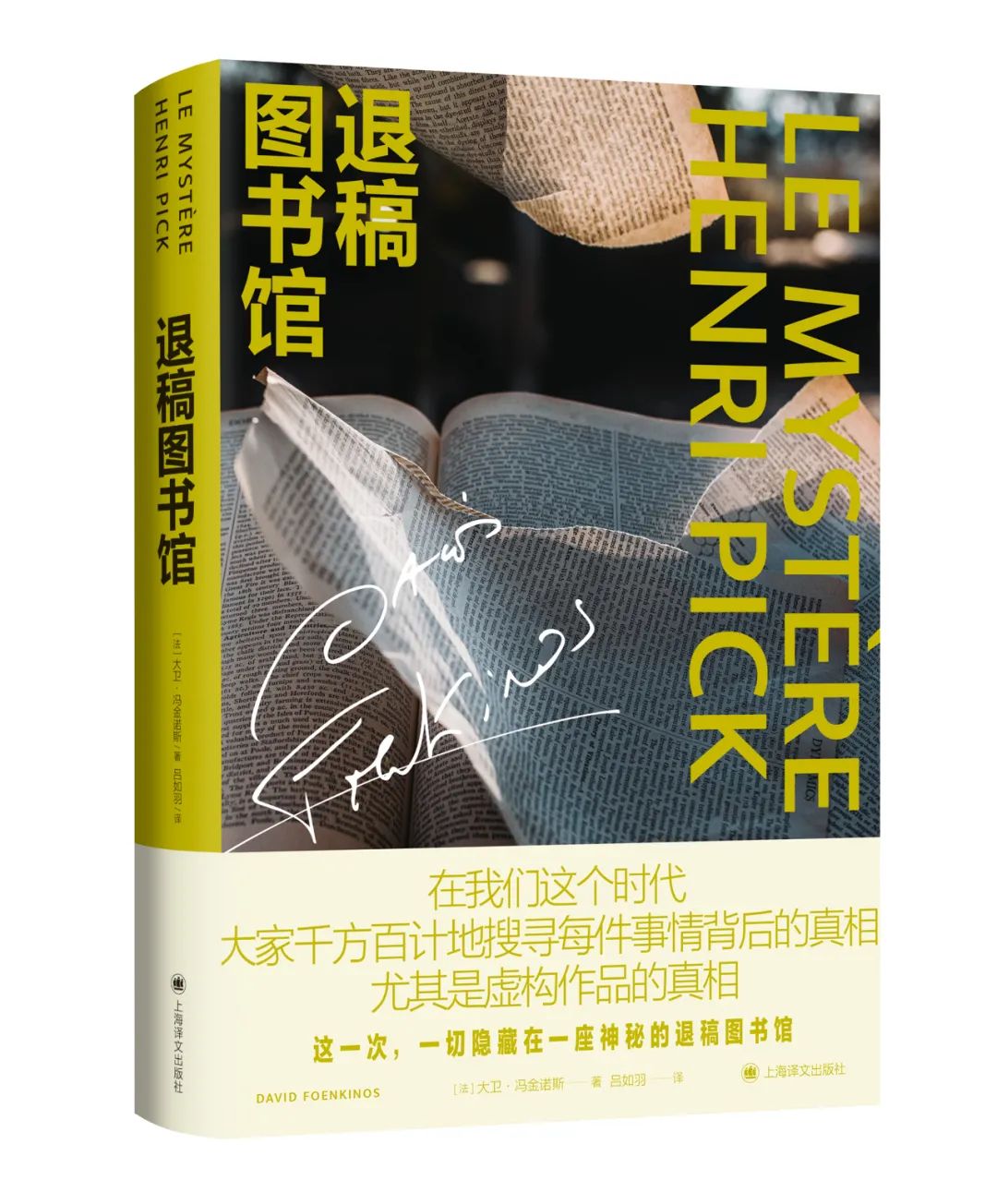
En Bretagne, sur l’initiative d’un bibliothécaire, une bibliothèque des livres refusés recueille depuis plus de dix ans les manuscrits refusés par les éditeurs. Parmi ceux-ci, une jeune éditrice Delphine et son fiancé Frédéric, lui-même écrivain, ont découvert ce qu’ils estiment être un chef-d’oeuvre intitulé Les Dernières Heures d’une histoire d’amour, écrit par un certain Henri Pick. Partis à la recherche de l’écrivain, ils apprennent qu’il s’agit d’un pizzaïolo, mort deux ans auparavant, qui, selon sa veuve, n’aurait jamais lu ni écrit de toute sa vie. Auréolé de ce mystère, le livre de Pick devient un immense succès. Récit d’une enquête littéraire pleine de suspense, cette comédie pétillante démontre qu’un seul roman peut bouleverser de nombreuses existences.
Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ? de Georges Perec
Traduit par Tang Yangyang
Nanjing University Press
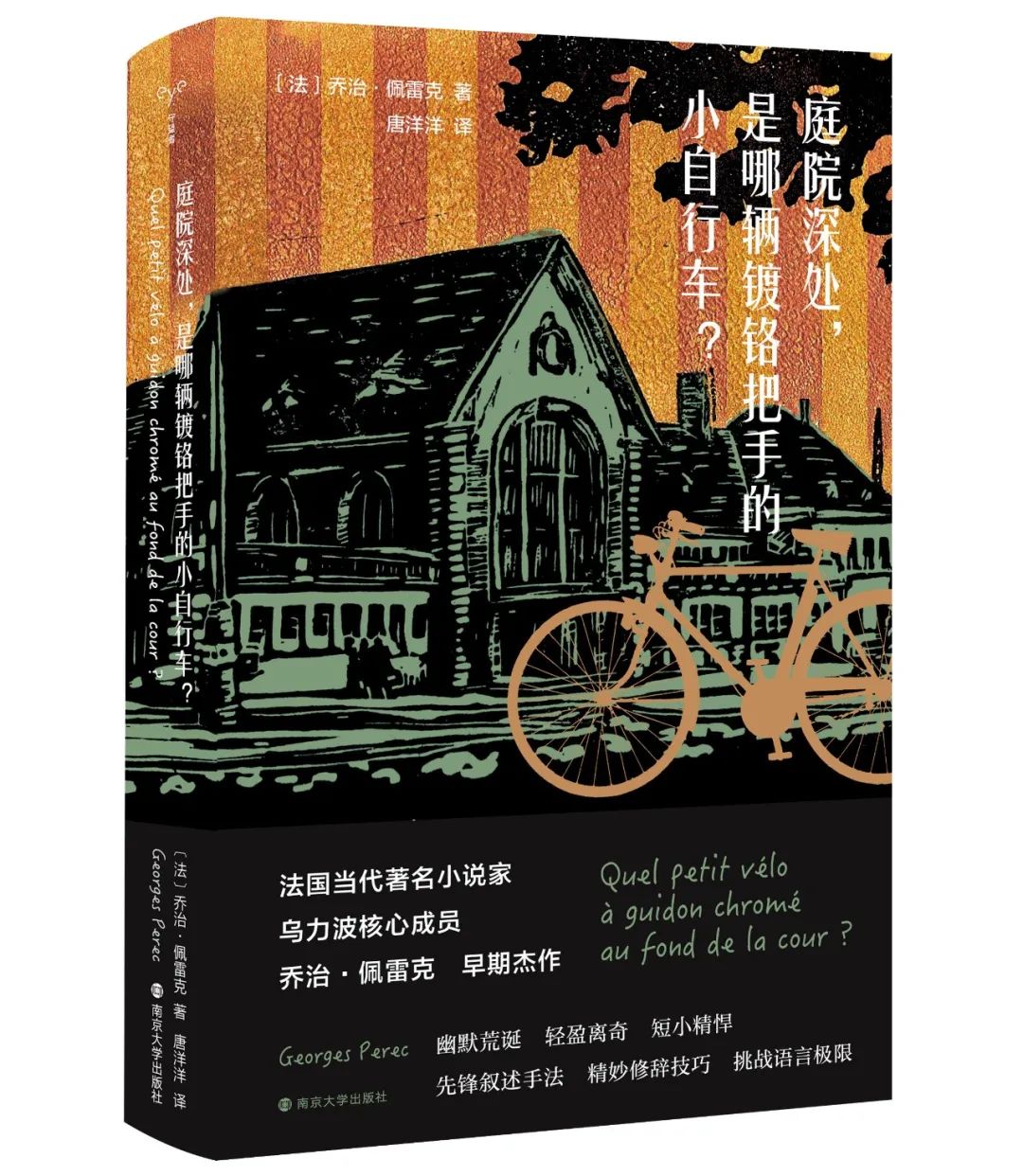
Henri Pollack, un jeune maréchal des logis, remontait chaque jour sur son petit vélo au guidon chromé, refaisait le trajet entre son pays natal Montparnasse et son camp militaire au Fort Neuf de Vincennes. Afin de rester avec sa copine et d’éviter d’aller se battre en Algérie, il tentait avec son bon pote KaraXX et ses amis, de trouver des moyens pour se débarrasser du service militaire. Dans ce roman, Georges Perec a essayé des techniques narratives expérimentales, des références intertextuelles et un grand nombre de jeux de mots. Par exemple, le nom du protagoniste KaraXX a soixante-douze variantes. Un index rédigé par l’auteur à la fin, plein d’humour et d’entrain, donne quelques idées pour l’interprétation de l’œuvre.
Le Roman comique de Paul Scarron
Traduit par Fan Pan
Nanjing University Press
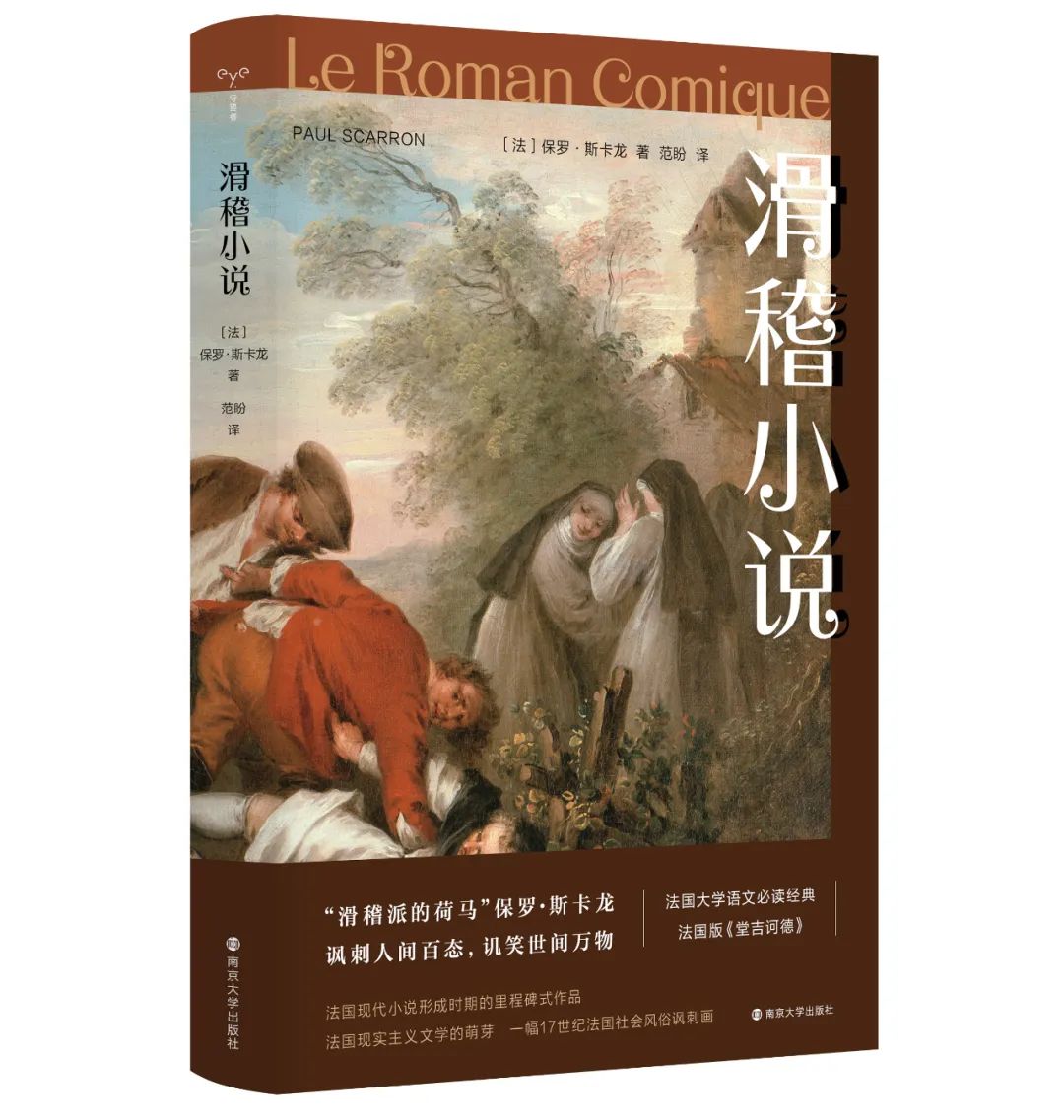
Le Roman comique relate le séjour burlesque d’une troupe de comédiens venus donner des représentations théâtrales autour du Mans. L’auteur fait appel à un important attirail de procédés narratifs, du « retour en arrière » à l’anamnèse, en passant par les récits enchâssés, avec une immense variété de registres. On y redécouvre la vie quotidienne de son temps, transposée dans le domaine romanesque. Scarron se livre à une parodie du roman héroïque ; il prend une commune de province pour scène, la vie réelle pour arrière-plan et son entourage pour matériau romanesque. Faisant fi des intrigues coutumières aux narrations linéaires, et renonçant à faire la peinture affectée de figures héroïques, le fil conducteur de l’ouvrage n’en recèle pas moins un ordre plus profond. À la réserve de quelques récits imbriqués dans l’ouvrage, tout n’y est qu’ironie et persiflage : pas un mot au travers duquel ne transparaisse la verve, l’humour et l’esprit de l’auteur.
Plume précédé de Lointain intérieur d’Henri Michaux
Traduit par Wang Jiaqi
People’s Literature Publishing House / Shanghai 99 Readers’ Culture
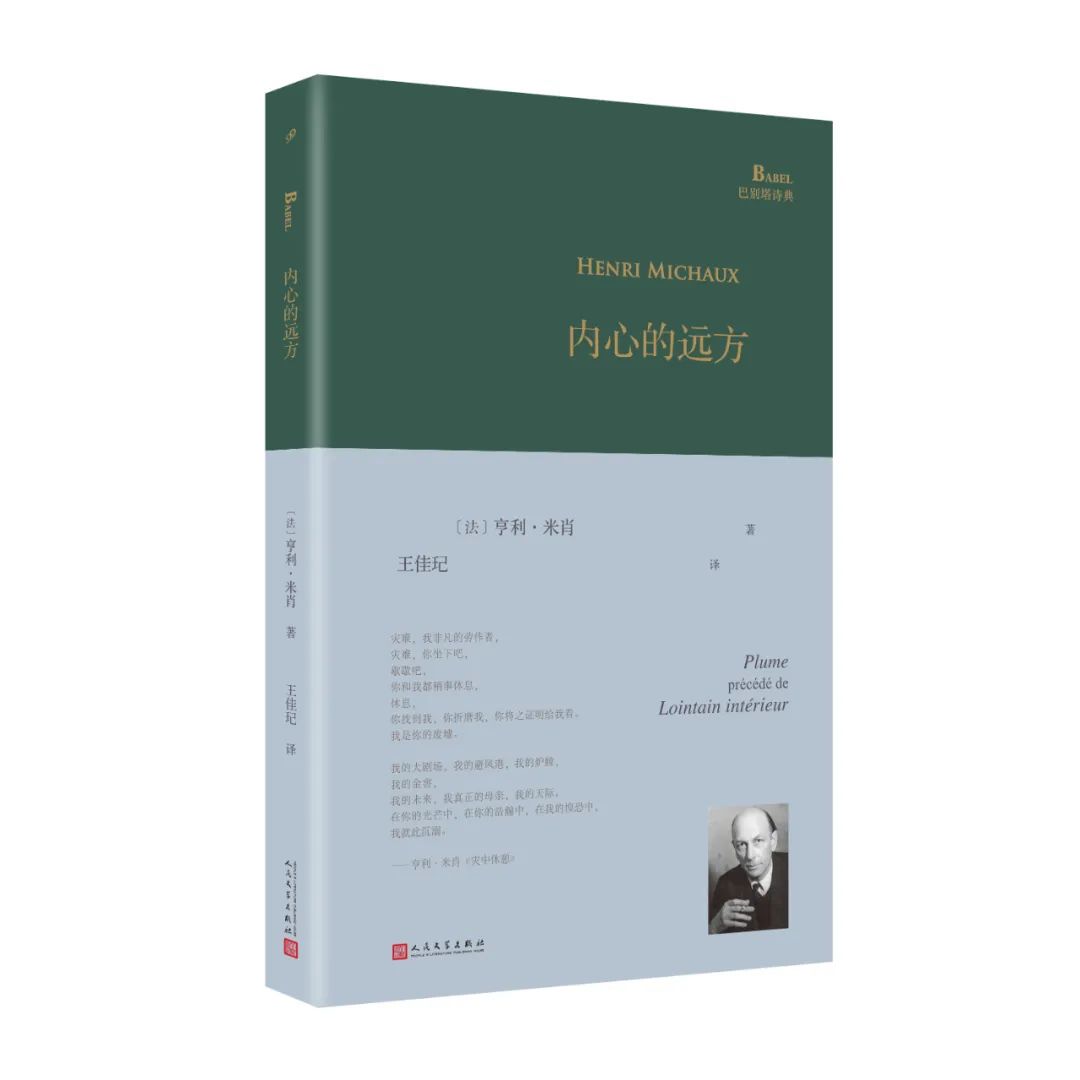
Plume est le recueil où Henri Michaux fait entendre une voix profondément singulière : chaque mot remis à nu, débarrassé de tout artifice, y dévoile un monde loin des apparences quotidiennes, une réalité secrète et souterraine. Les portes de ce Lointain intérieur projettent le lecteur dans les confins du subconscient à explorer, dans un royaume de rêves et de terreurs, dont le fil se déroule suivant la logique implacable du désespoir. Ce monde brutal, pesant, écrase l’homme-Plume, à travers les aventures à la fois plaisantes et amères dont il est le héros, toujours malmené et mal reçu, parce qu’inadapté aux exigences sociales. La poésie de Michaux ne s’embarrasse pas de mélodies. Cri, clameur, puis rumeur, gonflements et sursauts, éruptions puis éboulements. Moderne, à l’écart de toutes les modes, Michaux a su demeurer une référence.
Deuxième édition du Prix de la Fondation Choi pour l’art contemporain : découvrez les 8 artistes finalistes !
Nous avons le plaisir de vous annoncer les 8 finalistes en lice pour la deuxième édition du Prix de la Fondation Choi pour l’art contemporain.
L’ambassade de France en Chine et la Fondation Choi présentent la liste des nominés pour la seconde édition du Prix d’art contemporain franco-chinois. Ce prix vise à récompenser les créateurs contemporains engagés dans les questions environnementales et écologiques. Deux partenaires culturels prestigieux, que sont le Musée d’art moderne et d’art contemporain de Nice et Inside Out Museum à Pékin, sont associés à la sélection des artistes nommés et lauréats.
Les 8 artistes présélectionnés, issus de toutes les générations, répondent à des pratiques singulières et des approches personnelles du sujet environnemental.
Les deux lauréats - un Français et un Chinois - seront annoncés, en novembre 2022, à l’occasion de la clôture du Mois franco-chinois de l’environnement.
Le Prix de la Fondation Choi pour l’art contemporain bénéficie du soutien de l’Institut français de Paris.

Zhang Ruyi (né en 1985) vit et travaille à Shanghai. L'artiste trouve son inspiration dans les matériaux du quotidien. A partir de l’environnement bâti, elle crée des installations et des sculptures qui évoquent une esthétique « post-apocalyptique » du détachement. Son travail a été présenté dans différents centres d’art en Chine et fera l’objet d’une exposition personnelle à l’UCCA en 2023.
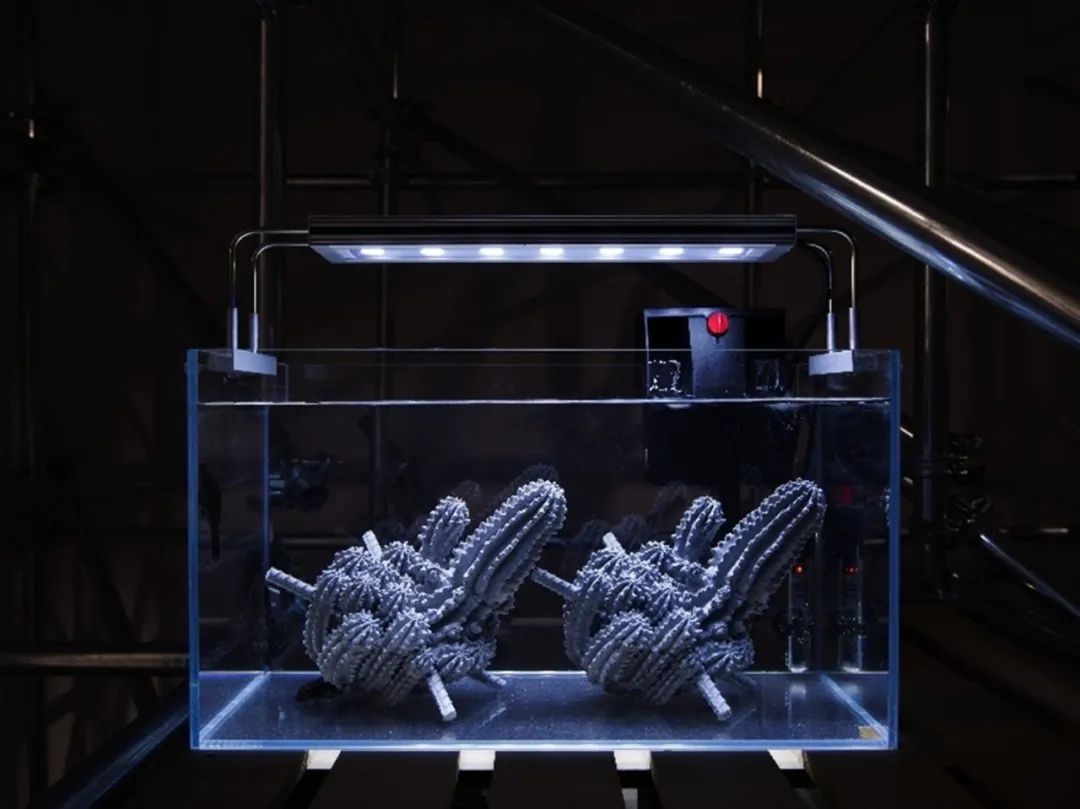

Cheng Xinhao (né en 1985) vit et travaille à Kunming. Il a obtenu son doctorat en chimie à l'université de Pékin, en 2013. Ses œuvres sont généralement basées sur des études de terrain, centrées sur sa ville natale, dans la province du Yunnan. À l'aide de vidéos, d'installations, de photographies et de mots, il étudie les relations polyphoniques entre la logique, les discussions, la connaissance et le rôle qu'y jouent la nature, la société et l'histoire. Son travail a été présenté lors de nombreux expositions en Chine.


Cao Minghao (née en 1982) et Chen Jianjun (né en 1981) travaillent et vivent à Chengdu. Leurs pratiques artistiques sont axées sur la recherche et mettent en évidence la collaboration transactionnelle entre les artistes et leurs partenaires dans les sphères écologiques et socioculturelles. Leur travail a été présenté à la dernière DOCUMENTA de Kassel et lors de biennales et expositions internationales, en Chine comme à l’étranger. Ils ont bénéficié d’une résidence à la Cité internationale des arts de Paris en 2020.


Ren Ri (né en 1984) est un artiste dont le travail se situe à l’intersection de l'art et de la science. Il explore les relations entre l’humanité et la nature. Il « travaille » notamment avec des abeilles depuis plus de dix ans afin d'étudier leur structure sociale auto-organisée. En 2015, il a reçu le Goslarer Kaiserring Stipendium/Kaiser Ring Scholar, qui récompense un artiste émergent.


Adrien Missika (né en 1981) est artiste et jardinier. Son travail explore avec humour le naturel et le culturel. Utilisant l'épistémologie comme base de recherche, son approche conceptuelle dérive vers des récits poétiques et hypothétiques. À travers une variété de médias, de la vidéo, la photographie, la sculpture à l'installation et l'action, son travail creuse dans le large éventail des sciences naturelles et environnementales telles que l'écologie, la biologie et la géographie.
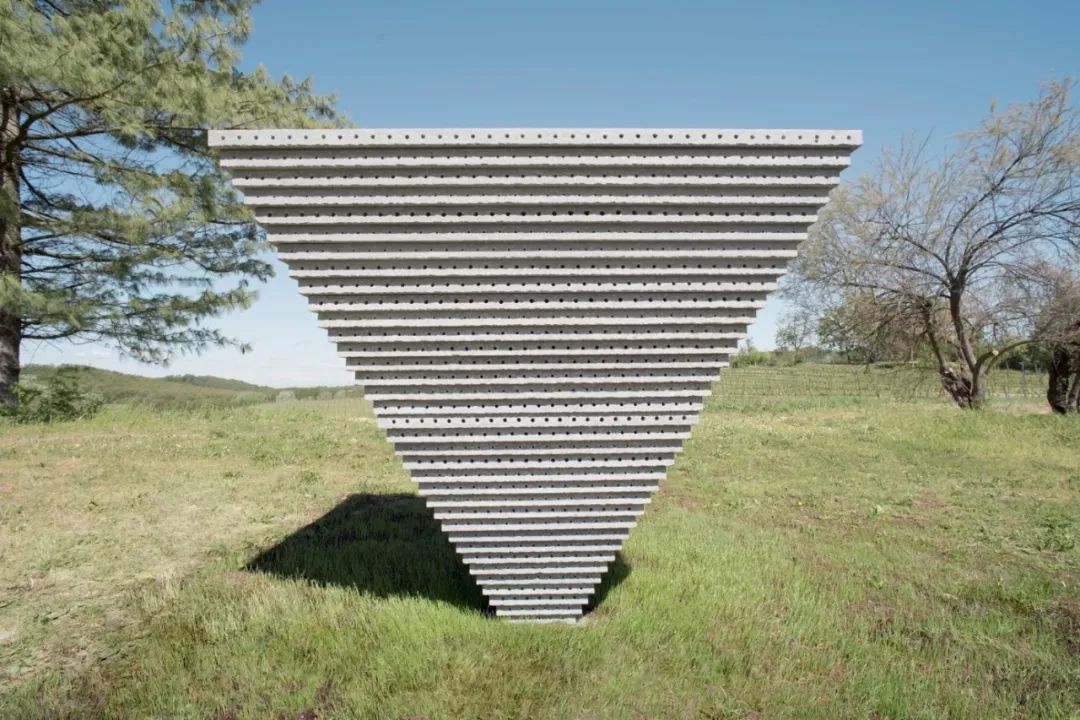

Angelika Markul (née en 1977) vit et travaille entre Varsovie et Paris. Elle a été lauréate du Prix Sam Art Projects (2013), du Prix COAL Art et environnement (2016) et du Prix Maïf (2017). Sa pratique artistique s’est toujours ancrée et intéressée à des lieux disparus, méconnus ou dangereux. Associant les faits réels et la fiction (voire la science-fiction), ses derniers projets de films l’ont emmenée au sud du Japon, sur l’île de Yonaguni, ou encore à Tchernobyl afin d’évoquer cette nature reconstruite sur ses propres ruines.


Marion Orfila (née en 1984) vit et travaille à Berlin. Elle explore les notions de "délocalisation" et d'impermanence à travers des installations architectoniques, des sculptures invasives ou des paysages déracinés. Son travail se développe principalement en dialogue avec des lieux, jusqu'à créer des vidéos in-situ, et réagit plus ou moins directement à l'urgence de la situation écologique et à l'absurdité du comportement humain. Ses œuvres ont été présentées en France, en Allemagne, en Finlande, en Espagne et au Canada, notamment à la Kunstverein Göttingen (2021) et dans des expositions en plein air comme Horizons Sancy (2012) ou Pièce d'Été (2017).


Vivien Roubaud (né en 1986) vit et travaille à Bruxelles. Il interroge les mécanismes logiques qui forgent notre quotidien. Il met ainsi à mal la notion de fonctionnalité et étudie les méthodes et procédés dans l’attente d’un accident. L’apparition d’un dysfonctionnement lui permet d’expérimenter des agencements « contre-nature » composés d’éléments détournés de leurs fonctions initiales. Il a reçu en 2014 le prix Révélations Emerige et a participé à de nombreuses expositions en France et à l’étranger.

Contrairement aux idées reçues, le véritable poumon de notre planète n’est pas l’Amazonie, mais l’Océan. Les phytoplanctons qui le peuplent produisent 50% de l’oxygène mondial par photosynthèse. Ce rôle vital est un exemple parfait de la manière dont la biodiversité rend notre planète habitable. Or, l’érosion globale de la richesse du vivant, en particulier au sein des milieux aquatiques et marins, menace aujourd’hui cet équilibre.
La richesse des milieux aquatiques et marins
Les cours d’eau, lagunes, estuaires et deltas, plans d’eau et eaux souterraines regorgent d’une biodiversité particulièrement riche, même s’ils n’occupent qu’une infime partie du globe : ils sont les lieux de vie de 130 000 espèces sur les 2 millions répertoriées sur notre planète. Par comparaison, le nombre d’espèces reconnues dans le milieu marin représente 13 % de l’ensemble des espèces vivantes actuellement décrites, alors même que les océans couvrent 70% de la surface terrestre. Même si les isolats favorables à la spéciation sont moins nombreux en mer que sur terre, cet écart s’explique aussi par notre méconnaissance des fonds marins et de leur biodiversité : il reste encore beaucoup à découvrir !
Il est important de souligner que la biodiversité des milieux marins et aquatiques ne se limite pas aux espèces dont la majorité du cycle de vie se déroule dans l’eau. Certaines y effectuent l’intégralité de leur cycle de vie, tandis que d’autres y viennent seulement pour s’y reproduire, migrer ou s’y nourrir - à l’image de certaines espèces de chauves-souris venant s’alimenter en insectes volants dans les milieux humides ou d’oiseaux migrateurs qui traversent les océans, font étape sur des atolls et se nourrissent à proximité de récifs coralliens.

Le poumon de notre planète
Cette riche biodiversité rend notre planète habitable, à l’image des phytoplanctons qui produisent la moitié de notre oxygène. Ces planctons sont eux-mêmes dépendants de relations avec d’autres espèces du milieu marin, comme les baleines qui rejettent dans l’eau des nutriments nécessaires à leur croissance. La biodiversité marine dans son ensemble est donc indispensable pour que nous puissions continuer à respirer.
La biodiversité des milieux aquatiques et côtiers est également essentielle. Par exemple, les mangroves, les herbiers et les marais salants stockent jusqu’à dix fois plus de carbone par unité de surface que les forêts terrestres. Ces zones humides protègent également les côtes contre les inondations et l’érosion tout en constituant un habitat privilégié pour les jeunes poissons. Ils assurent ainsi la subsistance et la protection des populations des zones littorales.

Cependant, les dégradations des écosystèmes fragilisent le tissu d’interactions et d’interdépendances qui lie les espèces et leurs milieux. Pollutions, réchauffement climatique, urbanisation sont quelques-unes des nombreuses menaces pesant sur les milieux marins et aquatiques. Ces menaces combinées multiplient les risques d’extinction d’espèces et de destruction des milieux. Ainsi, en 2022, il apparaît que 28% des 147 517 espèces étudiées par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) sont menacées d’extinction. Les écosystèmes aquatiques et marins sont particulièrement affectés : plus de 40 % des espèces d’amphibiens, près de 33 % des récifs coralliens et plus d'un tiers de tous les mammifères marins étaient menacés d’extinction en 2019 selon un rapport de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).

Or, cette perte de diversité réduit en retour les possibilités d’adaptation des espèces et des écosystèmes aux variations de leur environnement, à commencer par le changement climatique. Plus un milieu s’appauvrit, plus il est vulnérable. La création d’aires protégées est une première étape pour faire face à cette situation en créant des zones-refuges à l’abri des perturbations anthropiques.
La multiplication de ces zones de protection doit s’accompagner d’un changement de nos modes de vie. Leur création ne doit pas nous conduire à occulter le maintien de pratiques destructrices dans les espaces non-protégés contre lesquelles nous devons lutter. En effet, la biodiversité fonctionnant comme une toile de relations entremêlées, l’affaiblissement d’une partie d’un écosystème a des fortes conséquences sur l’ensemble de son équilibre et de ses espèces.
Des actions, même modestes, peuvent être réalisées par chacun d’entre nous pour contribuer à préserver cette biodiversité. Le Mois franco-chinois de l’environnement (MFCE) 2022 a pour objectif d’informer sur ces manières d’agir tout en présentant la beauté de notre planète et en alertant sur les atteintes qu’elle subit.
En novembre, expositions, conférences, ateliers et projections seront organisés sur l’ensemble du territoire chinois. Rendez-vous à la 9e édition du MFCE autour du thème « La planète bleue » !
Le saviez-vous ? La France et la Chine travaillent déjà à la protection de la biodiversité.
Les chefs d’État français et chinois se sont engagés à davantage coopérer pour la protection de la biodiversité dans le monde.
Sur le terrain, l’Agence française de développement (AFD) travaille avec les autorités chinoises à la protection de biodiversité. Elle accompagne par exemple la municipalité de Fuding (province du Fujian) dans la préservation de la biodiversité marine et côtière de son territoire, qui est composé de bassins versants, de rivières et d’archipels. Le territoire héberge en effet une biodiversité riche, aussi bien animale que végétale, dont plusieurs espèces sous statut de protection. On y trouve en particulier la mangrove naturelle la plus septentrionale au monde. De multiples pressions anthropiques ont conduit à une forte pollution des eaux de la baie ainsi qu’à la destruction de plusieurs habitats naturels, dont la mangrove qui est aujourd’hui dans un état critique.

Ce projet vise à restaurer et protéger sur le long terme des écosystèmes terrestres, côtiers et marins du territoire de Fuding, à faire évoluer les pratiques de théiculture et d’aquaculture pour qu’elles prennent davantage en compte la protection de l’environnement et à sensibiliser la population et les touristes à la valeur des différents écosystèmes terrestres, côtiers et marins qui composent le territoire, à commencer par la mangrove remarquable qu’elle héberge.

Pour atteindre ces objectifs, l’AFD et la Municipalité de Fuding travailleront à différentes réalisations : construction d’un écomusée, formation des pêcheurs et théiculteurs pour faire évoluer leurs modes de travail et leurs modèles économiques, campagnes de sensibilisation de la population locale, extension des zones protégées.
Source:
Le milieu marin (ofb.gouv.fr)
6.-Océan-biodiversité-et-climat-Fiches-S-2019.pdf (ocean-climate.org)
https://www.ocean-climate.org/wp-content/uploads/2017/02/coraux-2-161024_FichesScientifiques_Oct2016_BD_ppp-6.pdf
Pourquoi la composition des populations et des communautés de poissons diffère-t-elle entre bassins versants? | INEE (cnrs.fr)
La biodiversité dans l’océan | Planet-Vie (ens.fr)
La disparition des animaux marins, l’autre grande extinction qui menace (nouvelobs.com)
Duan Yinghong est professeure de langue et littérature françaises au Département de français de l’Université de Pékin, et directrice du Centre Etiemble de cette même université. Ses recherches portent notamment sur Marguerite Yourcenar ainsi que sur la littérature française du XVIIe siècle. Elle est membre du jury pour le concours de lecture à voix haute « La planète bleue dans l’œuvre de Jules Verne » dans le cadre de l’édition 2022 du Mois franco-chinois de l’environnement (MFCE).
Questionnaire de Proust par Duan Yinghong
1. Le principal trait de mon caractère......
Je ne peux être autrement qu’« un sujet merveilleusement vain, divers et ondoyant » (Montaigne).
2. La qualité que je préfère chez un homme......
La générosité, la douceur.
3. La qualité que je préfère chez une femme......
La générosité, la douceur.
4. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis......
Je les apprécie pour ce qu’ils m’apportent, chacun à leur manière.
5. Mon principal défaut......
Le manque total de sens d’orientation et de notion des chiffres.
6. Mon occupation préférée......
J’aime m’adonner à des choses imprévues et imprévisibles, qui sont peut-être futiles aux yeux des autres. Mais moi seule en connais l’importance.
7. Mon rêve de bonheur......
Je n’en ai pas. Je préfère saisir des moments heureux dans la vie réelle.
8. Quel serait mon plus grand malheur......
Perdre ceux qui me sont chers.
9. Ce que je voudrais être......
Une jardinière, qui passe sa journée en plein air et reste sensible à l’alternance des saisons.
10. Le pays où je désirerais vivre......
J’aimerais vivre dans un pays où les gens de tous les âges, de divers métiers, les gens parlant de différents patois ou différentes langues habiteraient dans un même quartier et pourraient se croiser au quotidien.
11. La couleur que je préfère......
J’aime toutes les couleurs en harmonie avec le cadre dans lequel elles se trouvent.
12. La fleur que j’aime......
La rose, la pivoine, le lotus, le glaïeul, le jasmin … je n’arrive pas à me décider.
13. L'oiseau que je préfère......
Je dirai sans hésitation les martinets pékinois, puisqu’ils sont mes voisins. Ces oiseaux minuscules, légers et énergiques, font fi de la grande distance en accomplissant leur migration annuelle Pékin-Afrique du Sud.
14. Mes auteurs favoris en prose......
Marguerite Yourcenar, Tolstoï.
15. Mes poètes préférés......
Li Bai, et La Fontaine que je regrette d’avoir commencé trop tard à aimer.
16. Mes héros dans la fiction......
Nathanaël dans Un homme obscur de Marguerite Yourcenar.
17. Mes héroïnes favorites dans la fiction......
Natacha dans Guerre et Paix.
18. Mes compositeurs préférés......
Bach, Fauré, Chostakovitch.
19. Mes peintres favoris......
Vermeer, Pieter Brueghel l’Ancien, Degas.
20. Mes héros dans la vie réelle......
Des gens simples, hommes ou femmes, qui sont capables d’actions extraordinairement courageuses aux moments de crise et de danger.
21. Mes héroïnes dans l’histoire......
Marie Curie.
22. Mes noms favoris......
Les noms de lieux qui évoquent l’histoire ou la nature. Les noms de personnes qui sont en accord avec le caractère de ceux qui les portent.
23. Ce que je déteste par-dessus tout......
La lâcheté poussée jusqu’à la cruauté.
24. Caractères historiques que je méprise le plus......
Les puissants ainsi que leurs suppôts qui oppriment les faibles.
25. Le fait militaire que j'admire le plus......
Si c’en est un, ce serait la course légendaire accomplie par ce jeune soldat qui aurait couru de Marathon à Athènes pour annoncer la victoire à ses compatriotes.
26. La réforme que j'estime le plus......
La réforme et l’ouverture de la Chine depuis 1978.
27. Le don de la nature que je voudrais avoir......
Savoir parler avec des choses muettes.
28. Comment j'aimerais mourir......
Dans la sérénité..
29. État présent de mon esprit......
Le souci de voir le monde risquer de sombrer dans l’avidité et l’hostilité.
30. Fautes qui m'inspirent le plus d’indulgence......
Celles commises par crédulité, par naïveté.
31. Ma devise......
Je n’ai pas de devise.
Le concours de lecture à voix haute « La Planète Bleue dans l’œuvre de Jules Verne » est organisé par l’Arbre du voyageur, en coordination avec le secteur Livre et Débat d’idées de l'ambassade de France en Chine, dans le cadre du Mois franco-chinois de l’environnement 2022.
Tout au long du mois d’août, les candidats ont envoyé des vidéos dans lesquelles ils lisent à voix haute l’un des dix extraits proposés, tirés de l’œuvre de Jules Verne. Nous avons reçu un grand nombre de propositions excellentes de nos candidats à travers la Chine. Nous les remercions pour l’enthousiasme qu’ils ont manifesté !
Malgré la concurrence, cinq finalistes ont été sélectionnés par le jury. Nous vous invitons à les découvrir ci-après.
Les finalistes sont présentés par ordre alphabétique :
HUANG Yueyi

Je m'appelle Huang Yueyi. J'ai 16 ans, je suis lycéenne et je vis à Pékin. La littérature, l'art et la gastronomie française m'intéressent beaucoup. En lisant les œuvres de Jules Verne, telles que Vingt mille lieues sous les mers, Le Tour du monde en quatre-vingts jours, j’ai découvert le monde de la science-fiction.
LIU Hao

Je m'appelle Liu Hao. J'ai étudié le français à l'Université Océanique de Chine, avant d'aller étudier en France. Après avoir obtenu un Master en littérature française, j'ai ensuite étudié l'interprétation de conférence pendant un certain temps. De retour en Chine, je travaille à Pékin. J'aime ardemment la langue et la littérature françaises.

Mon nom est Liu Yuxi et je suis professeure adjointe à l’Université ShanghaiTech. Après avoir obtenu mon bac en histoire en Chine, j’ai donné des cours de langue et culture chinoises en tant que lectrice à l’Université Catholique de l’Ouest (France) durant l’année universitaire 2012-2013. Entre 2014 et 2019, j’étais doctorante en histoire à l’Université du Québec à Montréal (Canada) et à l’Université d’Angers (France).
LUO Fangyuan

Bonjour, je m’appelle Luo Fangyuan, j’ai 19 ans, je suis étudiante à l’Université des langues étrangères de Pékin, j’apprends le français et les relations internationales. Depuis toute petite, la mer m’a toujours attirée. Pour moi, elle est à la fois calme et dynamique, comme mon caractère.
MA Quan

Bonjour, je m’appelle Ma Quan, j’ai 21 ans. Née à Shenyang, je suis une étudiante de l’Université des langues étrangères de Dalian. C’est durant mes études que j’ai été attirée par la littérature française, notamment les romans de Jules Verne qui m’ont énormément impressionnée.
Ce concours est coordonné par
Le club de lecture de l’Institut français de Pékin a pour mission de promouvoir la littérature, la langue et la culture françaises en Chine. Il permet notamment à ses membres d’acquérir, sur place ou sur commande, de nombreux livres en français mais aussi une sélection de livres français traduits en chinois. Des ateliers, concours et conférences sont également proposés au cours de l’année, ainsi qu’un groupe WeChat pour suivre l’actualité du club et plus généralement la littérature française en Chine.
Organisé par

Avec le soutien de

Bruno Latour, l’un des plus grands intellectuels du début du XXIe siècle, nous a quittés dans la nuit du 8 au 9 octobre à 75 ans. Au croisement de différentes disciplines en sciences humaines et sociales, sa pensée a marqué les champs de la sociologie des sciences et des techniques, de l’anthropologie des modernes et de l’écologie politique.
De la sociologie des sciences à l’anthropologie des modernes
Après une agrégation et un doctorat en philosophie, Bruno Latour effectue ses premières recherches en anthropologie à Abidjan, en Côte-d’Ivoire, et se tourne ensuite vers la sociologie des sciences pour s’intéresser à la « science en train de se faire ». Pour sa deuxième enquête de terrain à San Diego (Californie), il assiste à la découverte de l’endorphine par l’équipe du laboratoire du professeur d’endocrinologie Roger Guillemin, prix Nobel de médecine en 1977. Cet épisode lui fait prendre conscience à quel point la science est faite de controverses et qu’elle se construit socialement. Pour comprendre la science, et y compris les sciences dîtes « dures », il faut donc faire de la sociologie et de l’ethnographie afin de pouvoir décrire la longue chaine d’actions qui convertissent de petites observations en de grandes théories.
L’intuition de Bruno Latour va plus loin : un fait scientifique, pour être accepté comme tel, est présenté comme « pur » et est systématiquement détaché des éléments sociaux politiques, économiques, culturels qui ont contribué à sa construction. Or, Bruno Latour estime que ces faits scientifiques sont toujours hybrides et ne peuvent être véritablement « purifiés » du contexte de leur production. Ils ne sont jamais « naturels ». Ces réflexions lui valent de nombreuses critiques l’accusant de nier l’existence d’une vérité scientifique. Les propos de Bruno Latour ont été parfois mal compris, l’intellectuel reconnaissait l’existence de cette vérité scientifique mais soulignait qu’elle ne peut exister qu’en relation avec les éléments théoriques, empiriques, sociaux et techniques.
C’est à partir de ces réflexions initiales que Bruno Latour entame une carrière prolifique de chercheur. Au fil de ses publications, il s’attache à remettre en cause les grandes dichotomies classiques de la philosophie : nature-culture, nature-société, choses-personnes, qui sont la marque de la modernité – en développant notamment la « théorie de l’acteur-réseau », méthode hybride de sciences sociales qui étudie ensemble humains, non-humains et discours. À l’image de sa méthodologie, le monde latourien est composé d’hybrides à la fois naturels, politiques et économiques. Il aboutit en 1991 à la publication de l’essai Nous n'avons jamais été modernes. Essai d'anthropologie symétrique qui synthétise son cheminement intellectuel et pose les jalons de son travail en écologie politique.
Nous n’habitons plus la même Terre – La pensée écologique latourienne
Au tournant des années 2000, Bruno Latour réfléchit de à plus en plus aux conséquences de la crise écologique. Son approche pluridisciplinaire lui est précieuse pour penser l’Anthropocène, cette nouvelle « ère géologique » au sein de laquelle l’Homme, par son influence sur la biosphère, est devenu l’acteur central. Il s’intéresse à l’hypothèse Gaïa de James Lovelock qui décrit la manière dont les vivants construisent leurs propres conditions d’existence. En effet, tous les êtres qui peuplent la Terre contribuent à rendre notre atmosphère habitable et sont en conséquence irrémédiablement interdépendants. Il écrit alors qu’une rupture cosmologique s’opère : notre monde et notre rapport aux terrestres n’est plus le même. Alors que le postulat de la modernité séparait l’Homme de ses propres conditions d’existence en distinguant nature et société, la crise écologique met en lumière nos interconnexions avec une myriade de non-humains et met en relief l’équilibre précaire du vivant. La philosophie de Bruno Latour nous invite à « atterrir » sur cette Terre nouvelle afin d’y maintenir la vie.
L’héritage de Bruno Latour est immense. Son travail n’a cessé de s’affranchir des frontières entre disciplines. Il est notamment l’initiateur de programmes de recherche innovants comme le Médialab de Sciences Po, laboratoire sur le numérique et les sociétés, et tenait également en haute estime la capacité de l’art à élargir et à créer la pensée, multipliant les expériences en tant que commissaires d’exposition et les expérimentations théâtrales. Source d’inspiration pour beaucoup, artistes, philosophes, anthropologues et citoyens du monde entier, son travail a marqué toute une génération. En Chine, quatre de ces livres ont été traduits :
Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique, chez Paideia en 2022
Politiques de la nature : Comment faire entrer les sciences en démocratie, chez Henan University Press en 2016
Science in action, chez Oriental Press en 2005
La Vie de laboratoire (coécrit avec Steve Woolgar) , chez Oriental Press en 2004
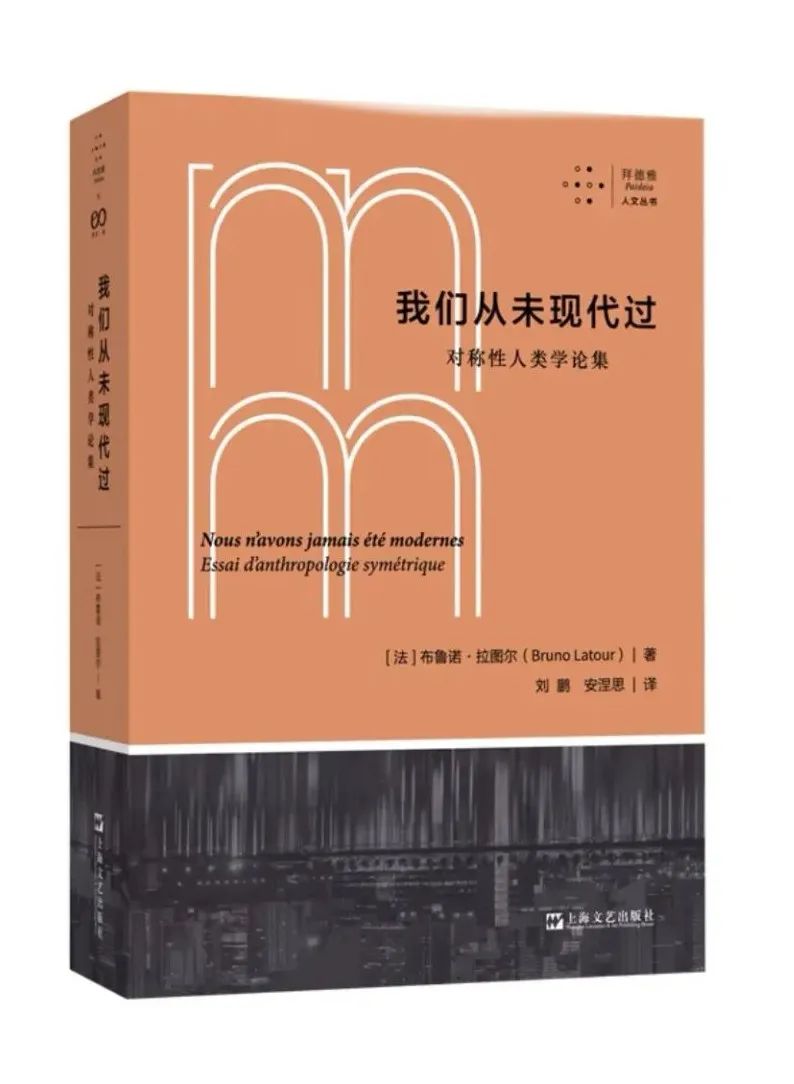
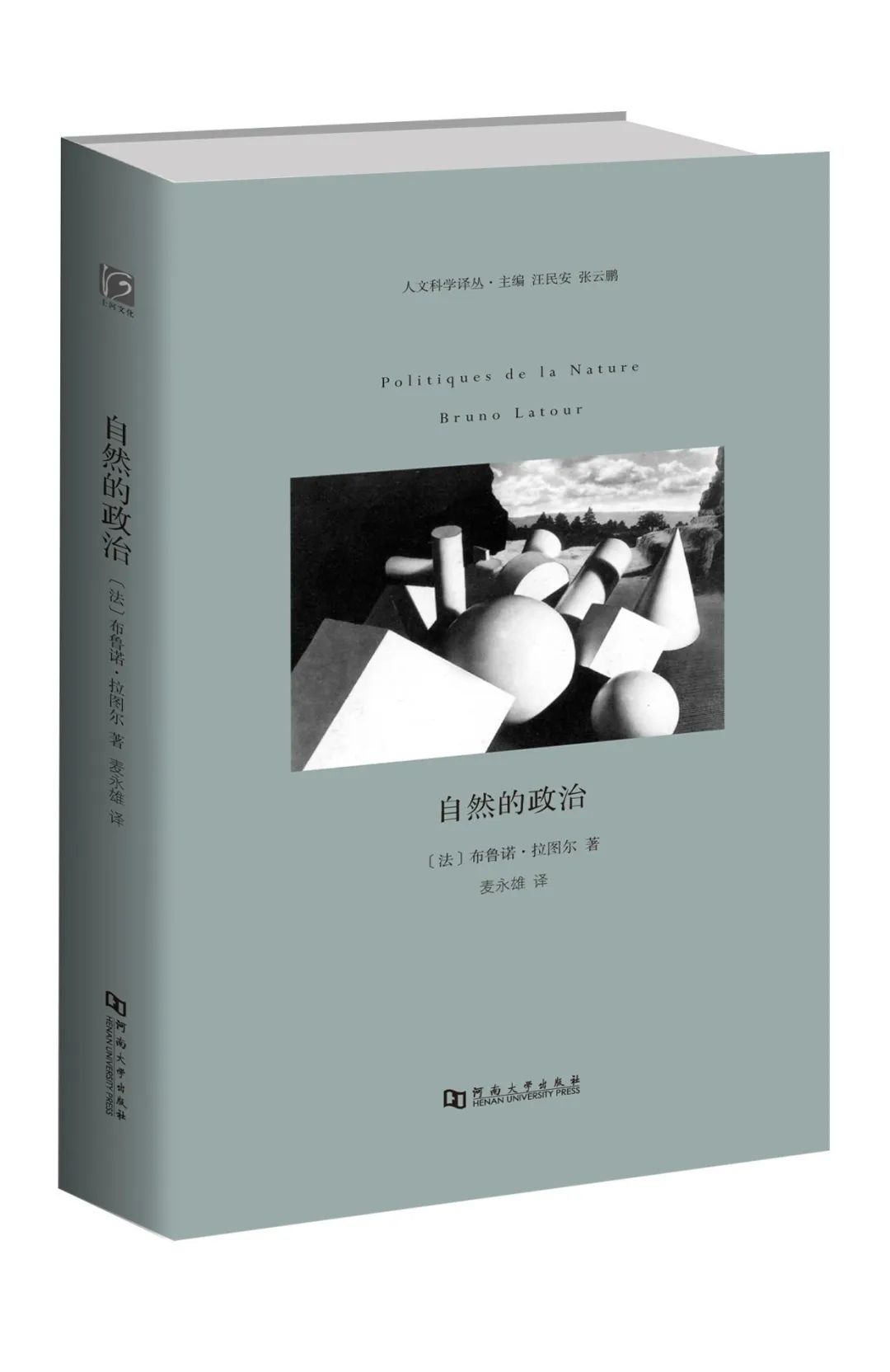
Le travail de la coopération franco-chinoise dans le domaine de l’environnement bénéficiera d’autant plus à la Chine, à la France et au monde qu’il cherchera à s’inscrire dans une démarche de composition et de dialogue pour préserver l’habitabilité de notre planète. Dans ce sens, le mois franco-chinois de l’environnement et la Fête de la Science, festivals intrinsèquement pluridisciplinaires, rendront hommage à ce grand penseur.